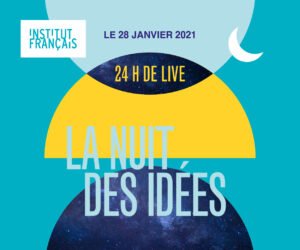Saint-Pierre-et-Miquelon ou l’exotisme anthropocène
De quel monde Saint-Pierre-et-Miquelon est-il le territoire ? Question saugrenue à une époque caractérisée par l’englobement généralisé[1] de l’urbain, de l’économie, du tourisme, du climat, de la santé… Notre temps ne consacre-t-il pas l’appartenance au monde moderne auquel, bon gré mal gré, plus un individu, plus un territoire n’échappent ? C’est négliger le fait que ce même monde, construit à coup d’extraction, de transformation et de consommation de nos espaces de vie, outrepasse les limites planétaires, au propre comme au figuré, avec la conquête spatiale d’un côté et l’épuisement des écosystèmes terrestres de l’autre.
Dans les craquèlements qui s’ensuivent, à ses franges, en ses friches, de ces ruines apparaissent de nouveaux agencements, de nouvelles figures qui se substituent aux canons de la modernité : des territoires s’inventent qui augurent de l’édification encore discrète d’un nouveau monde, le monde anthropocène. Anna Tsing, en explorant les forêts d’Oregon, a magistralement décrit certaines de ces émergences[2] autour des Matsutakes avec ses collectifs, ses patchs. Ce ne sont pas dans ces espaces sylvestres abîmés que j’ai effectué pareille rencontre, mais dans l’archipel tout aussi exotique de Saint-Pierre-et-Miquelon [3].
Convoquer l’exotisme pour qualifier ces îles françaises, et a fortiori les forêts d’Oregon, surprendra. Le caillou, comme on le surnomme, est perdu dans l’Atlantique nord, au large du Canada, dans le golfe du Saint-Laurent, blotti sous Terre-Neuve. Son climat subarctique est si peu clément que, localement, l’emploi de l’expression « Si le temps le permet » tient de la rengaine.
On est loin des représentations communes de l’exotisme. L’archipel est bien doté de grandes plages, mais elles sont plus souvent qu’à leur tour balayées par un océan tempétueux, des vents aussi violents que glaciaux, des trombes d’eau et de neige qui rendent leur fréquentation hasardeuse. Moins de sable fin que grossier et souvent empierré. Point