Rien n’est plus sérieux que l’émotion
« Rien n’est plus sérieux que l’émotion, qui touche jusqu’au tréfonds des dispositifs organiques. » (Pierre Bourdieu)
Nous sommes témoins tous les jours de grandes manifestations d’émotions collectives : dans les stades, les rassemblements festifs, les rituels religieux, les réunions publiques, les meetings politiques, les commémorations, les manifestations de rue, les guerres et les conflits interethniques, les situations de crise, etc. Les émotions qui y sont partagées sont de toutes sortes : joie, fierté, douleur, compassion, rancœur, dégoût, peur, colère, indignation, envie, haine, vengeance, ressentiment, etc. Le partage d’émotions y prend aussi des formes différentes, plus ou moins expansives, plus ou moins débridées, parfois violentes. Il peut relever d’une participation directe à un événement ou à une action collective. Il peut aussi se faire par médias interposés, par exemple dans le cadre d’une focalisation collective sur un événement public (attentat, catastrophe naturelle, etc.).
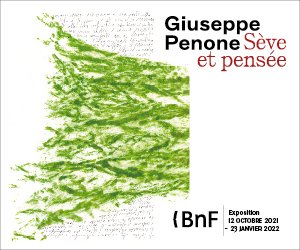
On lit souvent dans les essais sociologiques et politiques récents que, sur le plan politique, ce qui compte désormais de plus en plus c’est d’émouvoir les gens, et que ce qui occupe la scène c’est la mobilisation des émotions. C’est d’ailleurs la définition même de la post-vérité, si l’on en juge d’après la définition récemment proposée par le dictionnaire de l’Université d’Oxford : dans un régime de post-vérité, « les faits objectifs ont moins d’influence pour modeler l’opinion publique que les appels à l’émotion et aux opinions personnelles ».
Il ne faut pas oublier que les mouvements sociaux, les mobilisations politiques et la défense de causes ont toujours eu une forte composante émotionnelle.
Il y a peu, Pierre Rosanvallon a défendu l’idée que l’expression collective des émotions est devenue une fin en soi, et qu’elle n’est plus orientée vers l’action. Il a aussi défini les leaders populistes comme des « entrepreneurs d’émotions » ou des manipulateurs d’affects
