Du darwinisme en sciences humaines et sociales (1/2)
Depuis La Filiation de l’homme, qui fête ses 150 ans cette année, on sait que la biologie de Darwin a des choses à dire sur l’humain. Une large gamme d’approches « évolutionnistes » a progressivement vu le jour[1]: l’économie évolutionniste ou la psychologie évolutionniste, mais aussi la critique littéraire darwinienne et l’éthique évolutionniste. D’autre part les sciences humaines et sociales (ci-dessous et selon l’usage, SHS) sont souvent décrites comme n’apparaissant pas aussi rigoureuses que les sciences de la matière ou de la vie – y compris par leurs propres chercheurs, comme le fait dans ces pages l’éminent sociologue Bernard Lahire. Pour autant, le darwinisme pourrait-il offrir une base d’une rigueur acceptable pour comprendre les activités et faits humains, comme le suggère précisément l’exergue de ce texte programmatique de Lahire ?
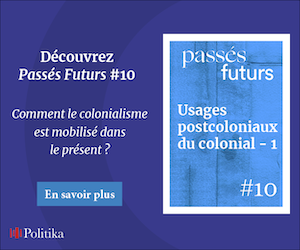
Nombreux sont les exemples d’une telle ambition programmatique unifiante, en particulier depuis le cadre darwinien ; certains marquent justement l’actualité. Ainsi les Américains John Tooby et Leda Cosmides, fondateurs de la discipline qui porte le nom de psychologie évolutionniste, et récipiendaires ce mois-ci du prestigieux prix Jean Nicod, décerné par l’Institut éponyme, haut lieu des sciences cognitives en France, ont conçu un programme de recherche destiné à remplacer la « vision standard » des sciences anthropologiques en général, soit en réalité à remplacer les sciences sociales usuelles.
Ce programme est « naturaliste » au sens où il reconstruit l’anthropologie sur la base des sciences naturelles et leurs méthodes. Le naturalisme impose d’adhérer à la vision darwinienne de l’humain puisque, comme le soulignait l’éminent évolutionniste Theodosius Dobzhansky en une formule régulièrement citée : « nothing in biology makes sense except in the light of evolution » (« rien en biologie n’a de sens si ce n’est à la lumière de l’évolution »). Par exemple, selon ces auteurs et leurs continuateurs, il faudrait accepter q
