Du darwinisme en sciences humaines et sociales (2/2)
Les tentatives pour penser les faits humains et sociaux à la manière darwinienne sont au moins divisibles en deux groupes, selon le rôle donné à la sélection naturelle et l’attention portée tantôt aux dynamiques évolutives possibles, tantôt au résultat actuel de cette dynamique (1/2). Cette distinction est parallèle à la distinction qu’on trace, en biologie évolutive, entre deux pôles théoriques, l’écologie comportementale (science des traits des organismes comme adaptations) de la génétique des populations (modélisations de l’évolution des fréquences de gènes).
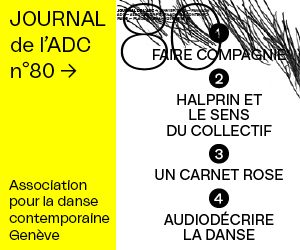
Il s’agit à partir de là de proposer une cartographie des possibles darwinisations des SHS qui permette de concevoir les limites de chacune d’elles en en déterminant les conditions. Nous commencerons par écarter comme unilatérale l’idée que l’évolutionnisme est une réinterprétation du fonctionnalisme en sociologie ou en anthropologie, puis procéderons vers une typologie et une évaluation critique
Fonctionnalisme, adaptationnisme, darwinisme et SHS
La darwinisation des sciences humaines pose la question de la possible naturalisation de certaines fonctions en sciences sociales ou en psychologie, en entendant par « fonction » la raison d’existence d’une caractéristique comportementale ou psychologique dans une société. Ainsi la proposition « X existe parce qu’il remplit telle fonction pour la société » (thèse fonctionnaliste ; par exemple, selon des durkheimiens, les rituels religieux existent parce qu’ils réalisent le sentiment de communauté propice à la vie sociale) devient « X existe parce qu’il est le résultat d’une évolution par sélection naturelle », équivalence d’autant plus plausible qu’en biologie « avoir une fonction» signifie souvent « être un effet de la sélection[1] ».
Cependant, le passage par les modalités des sciences sociales darwiniennes dont la structure ressemble davantage à la génétique de populations (comme on vient de l’établir), nous montre que cette intuition d’une darwinis
