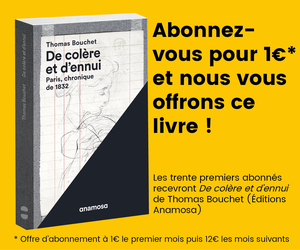La vocation enseignante ou l’impensé de la carrière des professeurs
Le 12 juillet 2012, commentant la non-attribution de certains postes au concours du CAPES, Le Figaro titrait : « Profonde crise de la vocation chez les enseignants ». À ce stade, il faut signaler que cette crise de la vocation est plutôt une crise du recrutement mesurée par les concours nationaux qui se répercute, comme le signalait un rapport récent de l’OCDE. Ce rapport est appuyé sur une enquête PISA de 2015 qui montrait que les classes des établissements les plus difficiles étaient rarement prises en charge par des enseignants issus des concours de recrutement, mais davantage par des contractuels.
La question de l’enseignement n’est pas nécessairement en cause, on peut être contractuel et excellent enseignant, cela n’est pas corrélé. Il s’agit seulement de constater que ceux qui ont choisi par concours la carrière d’enseignant ne vont pas en priorité vers les postes les plus difficiles, actuellement les établissements REP et REP+. Ce constat fait écho à la représentation française du métier d’enseignant, qui participe tant bien que mal d’une mythologie nationale, véritable lieu de mémoire républicain : l’enseignement public est une affaire de vocation.
La vocation enseignante est une figure ancienne de la mythologie scolaire française. Déjà, avec la figure du camarade d’études à l’École normale d’instituteurs du père du jeune Marcel Pagnol, affecté toute sa vie dans un quartier déshérité de Marseille, et qui comptait, nous dit l’auteur, ceux de ses anciens élèves qui avaient été guillotinés. Chez Pagnol, le professeur a charge d’âmes, celle des enfants, des futurs citoyens ; le professeur est décrit comme curé de la République. De cette nature religieuse de la fonction professorale émerge l’idée d’une vocation enseignante comme il y aurait eu une vocation religieuse. Les écoles normales d’instituteurs où l’on entrait à l’adolescence, en internat, souvent loin de chez soi, n’étaient pas sans rappeler les petits et grands séminaires, autrefois nombre