Pour une politique de l’Université
Alors que la campagne présidentielle s’achève, et que se décideront, dans les prochaines semaines, les orientations du pays pour les dix ou quinze ans qui viennent, la question de l’avenir de l’enseignement supérieur et de la recherche (ESR), et de l’université en particulier, ne suscite aucun véritable débat. Cette situation a de quoi alarmer quand on sait leur importance dans la vitalité matérielle et symbolique d’une société.
Le récent rapport du Conseil d’analyse économique[1] pointe en effet tous les bénéfices individuels et collectifs qu’il y a à retirer d’un investissement massif dans l’ESR en matière, par exemple, de santé et d’espérance de vie, d’innovation, d’amélioration des conditions d’existence, et de recettes fiscales par l’effet mécanique d’élévation des niveaux de salaire des détenteurs de diplômes du supérieur. De quoi conclure que les dépenses publiques en matière d’éducation sont de celles qui ont le plus haut rendement socio-économique, et que l’investissement dans l’ESR fait partie des « meilleurs choix possibles »[2].
Ce meilleur choix possible ne semble pourtant pas la priorité des politiques publiques actuelles comme en attestent trois constats majeurs.
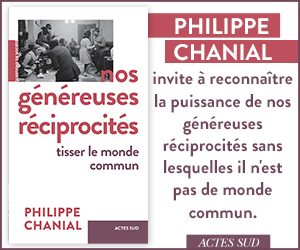
L’Université, grande oubliée des politiques publiques
Le premier est le sous-financement chronique de la recherche publique, qui, en France, avec 2,2% du PIB en 2021 reste très en deçà de l’objectif des 3% fixé par l’Union européenne dans le cadre de la « stratégie Europe 2020 », et en dessous de la moyenne des pays de l’OCDE (2,5% du PIB), quand par comparaison la Corée du Sud y consacre 4,5% de sa richesse nationale, le Japon et la Suède 3,3%, l’Allemagne 3,1%, les États-Unis et la Finlande 2,8%[3]. Pire, la part consentie par les administrations publiques au financement de la recherche (hors entreprise donc) est en diminution constante depuis les années 1990. Elle s’établissait à 0,76% du PIB en 2018 contre 0,85% en 1992[4].
Le second concerne la multiplication, depuis une vingta
