En toute saison – sur la saison 2 d’En thérapie
À la diffusion de la première saison de la série En thérapie, en février 2021, je me souviens avoir été d’abord irritée par le concours de circonstances qui faisait que le hors-champ des attentats du Bataclan de 2015 se superposait au contexte de la pandémie. Celle-ci apparaissait comme l’après-coup d’un premier temps dans lequel nous avons découvert la catastrophe dont nous ne sommes plus sortis depuis. Le phénomène se répétant évidemment dans la diffusion de la nouvelle saison : le monde empirant, une crise s’imprime sur une autre (aujourd’hui la guerre en Ukraine et les élections présidentielles), au risque de faire penser qu’elles se ressemblent, que nous les vivons de la même façon – et que nous sommes tous également malades et fatigués.
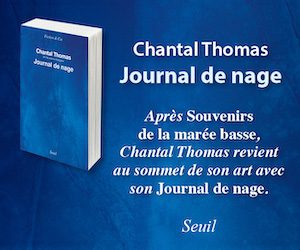
C’est bien toute la question, parmi les nombreuses que m’a posé la série : celle de la réalité collective des événements traumatiques, de la nécessité de leur reconnaissance, et de la nécessité inverse – celle de la réalité psychique singulière, et de l’autonomie avec laquelle on les traverse. On n’est pas tous traumatisés de la même façon – et c’est même à un certain point la production de l’interprétation des faits psychiques en masse, qui est traumatique (et tend à être fasciste) par définition.
Quelque part dans Malaise dans la civilisation, Freud a écrit qu’il n’y avait pas de solution collective ; entendre : pas de solution thérapeutique collective. Pour lui, cela signifiait que chacun devait œuvrer lui-même à l’amélioration de l’humanité. Chacun devait seul, comme un héros tragique, se confronter au destin. Il était plutôt contre la révolution autant que contre les fascismes, mais il croyait aux mythes comme forme d’éducation (qui sont, même dans la forme réactionnaire et patriarcale qu’il leur donnait, une façon efficace de figurer et d’agir sur la pulsion).
Cette phrase de Freud je me la rappelle souvent. Si je crois encore à la volonté générale, et au fait que la révolte puisse s’opposer à la guerre, à la de
