Quelles pédagogies pour quelles subversions de l’ordre social ?
On peut considérer que, dans l’espace académique, les deux champs que sont la sociologie des inégalités socio-scolaires d’une part (qui correspond à peu près à la sociologie de l’éducation), et la pédagogie d’autre part, fonctionnent souvent en vases clos. Les sociologues des inégalités socio-scolaires sont attentifs à la question de la reproduction des inégalités relatives aux classes sociales mais ne rentrent pas toutes et tous dans le détail et la fabrique, pédagogique, de ces dernières par l’école, même s’il existe malgré tout des travaux sur ces points. De l’autre côté, dans le domaine des sciences de l’éducation en particulier, il y a de nombreux experts des pédagogies « alternatives », notamment liées au courant de l’éducation nouvelle, qui, généralement, les défendent, y voyant des moyens d’émanciper les enfants ou de renouveler la relation éducative.
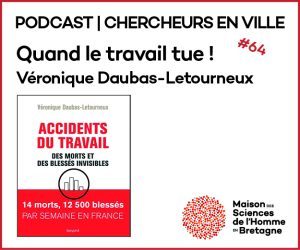
À dire vrai, ces deux sphères dialoguent assez peu. Outre la question des frontières des « mondes » académiques, plus ou moins autonomes, ces antagonismes nous paraissent s’expliquer aussi par des représentations différentes de ce qui fait la valeur d’une pratique pédagogique et sur ce que doit, ou devrait, être l’objectif de l’éducation et de la relation éducative.
Récemment, les pédagogies critiques s’invitent comme un troisième acteur. Visant à bousculer les dominations de classe, mais aussi de genre, de « race », d’âges, relatives à l’héritage colonial ou la prédation environnementale, elles ont des liens avec la sociologie, étant fondée par la critique des inégalités dans la société, mais ne réduisent pas la domination à celle relative aux classes sociales comme c’est le cas dans de nombreux travaux de sociologie de l’éducation, qui leur accordent une place de choix. Par ailleurs, la critique de certaines dominations portée par les pédagogies critiques peut les amener à adopter des points de vue parfois proches de certaines approches (les plus politiques) issues du courant historique de l’éducati
