Les géants tech ou l’avènement de quasi-États
L’image a marqué les esprits. Marc Zuckerberg, fondateur et PDG du F de l’acronyme GAFA, annonce qu’il part en tournée à travers les États-Unis, alors que son entreprise, accusée de toutes parts d’avoir joué un rôle décisif dans l’élection présidentielle américaine et le Brexit, refuse obstinément de prendre acte du pouvoir exorbitant qu’elle possède désormais sur l’attention et les esprits d’un tiers de l’humanité. La contradiction n’est pas anodine et « Zuck » ne peut en être dupe : Facebook n’est plus l’outil de notation des plus beaux étalons du campus de Harvard, ce n’est plus un simple réseau social. Plus encore que ses pairs technologiques, c’est désormais une organisation d’un genre nouveau dont nous ne cessons de mesurer l’indomptable puissance.
La compréhension des ressorts de cette puissance est indispensable pour que les États, démunis face aux preuves quotidiennes leurs propres limites, reprennent en mains leur destin, ainsi que celui de leurs citoyens.
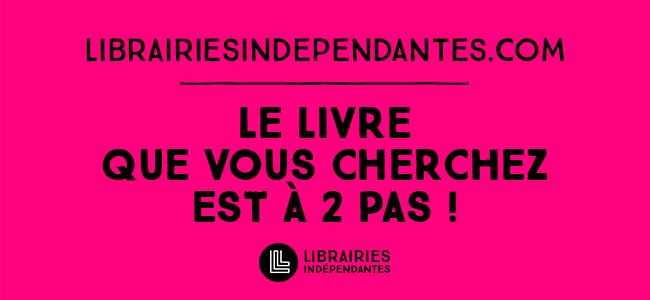
C’est qu’il est maintenant bien acquis que les géants tech sont porteurs d’un projet politique, et qu’il n’est pas forcément progressiste. Que ce soit le transhumanisme incarné par Google ou la destruction systématique de la relation salariale d’un Uber, ils instaurent un horizon politique sur lequel les États, les institutions et les individus n’ont pas de prise directe. Leur pouvoir est immense et ne se limite pas, loin de là, à la sphère technologique. Si c’est par le biais de la technologie qu’ils façonnent le monde qui les entoure, cette technologie répond à un ensemble de valeurs, croyances et opinions normatives sur la forme que devrait avoir ce monde qui est aussi le nôtre.
Les moyens d’actions traditionnels à disposition des États n’ont cessé de se montrer inefficaces, en dépit de leur grandiloquence.
Face à ces tanks politiques, les États ne cessent de prendre acte de leur propre impuissance. Que ce soit en matière de fiscalité, du droit de la concurrence ou encore sur le terrain épi
