A l’ombre de la maison de verre (transparence et désubjectivation 2/2)
La maison de verre invoquée par André Breton dans Nadja est célèbre, elle est l’emblème d’une sorte de parti-pris du surréalisme en faveur de la transparence ou d’une fascination pour celle-ci : « Pour moi, je continuerai à habiter ma maison de verre, où l’on peut voir à toute heure qui vient me rendre visite, où tout ce qui est suspendu aux plafonds et aux murs tient comme par enchantement, où je repose la nuit sur un lit de verre aux draps de verre, où qui je suis m’apparaîtra tôt ou tard gravé au diamant [1] ».
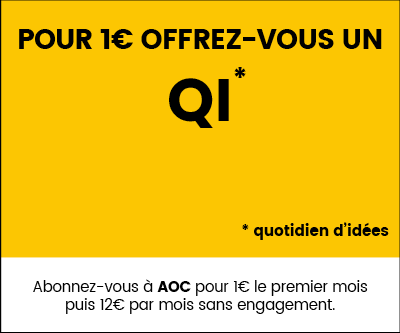
La « maison de verre » est de manière très générale au cœur de l’esthétique surréaliste, qui se présente d’une part comme l’expression immédiate, automatique et donc authentique de la vie, certifiée sans ajout de conscience, de rhétorique et de fiction, fondamentalement autobiographique donc ; et d’autre part, à titre à la fois de cause et d’effet, comme une authenticité immédiatement communicable ou partageable. C’est parce que je me montre au regard de tous tel que je suis que je peux savoir qui je suis, que je suis moi-même. A ce titre le surréalisme fait partie d’une galaxie à la fois utopiste et avant-gardiste dans laquelle de nombreuses expériences avant-gardistes trouvent leur place – des futuristes italiens au Living Theatre en passant par les situationnistes – avec en toile de fond les grands utopistes (Fourrier, Saint-Simon, etc.). Ces derniers ont tous été de grands bâtisseurs de communication transparente, dont témoignent notamment les nombreuses reprises ou applications des discours utopistes dans le domaine de l’architecture ou de l’urbanisme.
On ne reviendra pas sur la « mauvaise foi » des appels de Breton en faveur de la transparence, qui ont été souvent relevés et qu’il faut bien se résoudre à verser au compte d’une rhétorique de la transparence. Qu’il existe des brouillons, publiés maintenant depuis un certain temps, des Champs magnétiques, ça la fiche quand même plutôt mal. Ce qui nous retiendra par contre, c’est le fait suivant, que Br
