Nouvelle-Calédonie : un référendum qui ne clôt pas la lutte pour l’indépendance
La Nouvelle-Calédonie n’a pas fini de nous étonner. Alors que les sondages et les commentateurs politiques tablaient sur une victoire écrasante du « non » sur le « oui » – de l’ordre de 70% contre 30% – lors du référendum du 4 novembre 2018 sur l’accession à l’indépendance de cet archipel du Pacifique Sud, le score s’avère beaucoup plus serré que prévu : 56,4% en faveur du maintien dans la France contre 43,6% pour la pleine souveraineté, soit 18 000 voix d’écart sur un corps électoral de 175 000 inscrits et pour une population totale de 270 000 habitants. À l’issue du scrutin, les vainqueurs « loyalistes » faisaient plutôt grise mine, tandis que les vaincus indépendantistes affichaient leur satisfaction et donnaient d’ores et déjà rendez-vous aux électeurs en 2020 pour la « deuxième manche ».
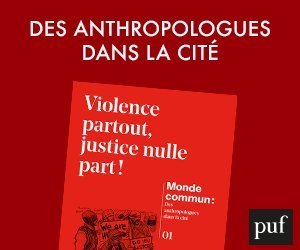
En cas de victoire du non en effet, l’accord de Nouméa qui organise l’évolution politique du territoire – et qui a été intégré à la Constitution française – prévoit la tenue d’un deuxième référendum dans les deux ans, sur la même question et avec le même corps électoral, si un tiers des élus du Congrès de la Nouvelle-Calédonie le demande, soit 18 des 54 membres. Or les indépendantistes, favorables à ce deuxième vote, occupent actuellement 25 sièges et il ne fait aucun doute que les élections provinciales de mai 2019 enverront au Congrès un nombre suffisant d’entre eux pour le déclencher.
Malgré les déclarations des leaders loyalistes demandant l’annulation du futur référendum, on ne voit pas comment cette disposition constitutionnalisée pourrait être contournée, l’État s’étant toujours engagé à appliquer l’accord de Nouméa, garant de la paix, dans sa totalité. Si ce scrutin de 2020 s’avère encore négatif, un troisième référendum sera organisé dans les mêmes conditions en 2022. En cas de troisième non consécutif, l’accord prévoit que « les partenaires politiques se réuniront pour examiner la situation ainsi créée ».
Du colonialisme de peuplement à la décolonisation
On ne peut comprendre ni ce dispositif institutionnel étonnant, ni l’apparent paradoxe de ces vaincus plus satisfaits que les vainqueurs, si l’on ne prend pas en compte la profonde singularité historique, sociale et politique du « Caillou ». Dans cette colonie placée sous souveraineté française depuis 1853, l’ambition de l’État a longtemps consisté à « planter du Blanc ». Au XIXe siècle, il s’agissait de purger l’Hexagone de ses indésirables en les forçant à peupler cette terre des antipodes comme bagnards, tout en construisant une petite « France australe » agricole et industrieuse grâce à de vaillants colons libres. Ce projet colonial de peuplement supposait de faire de la place, donc d’organiser la spoliation massive des terres des Kanak (premiers habitants de l’archipel) et de les enfermer dans des « réserves indigènes » – cas unique dans l’empire français – qui représentaient moins de 8% de la superficie de l’île principale autour de 1900.
L’État a également mis à la disposition des colons une main d’œuvre corvéable à merci, fournie d’abord par les forçats, ensuite par les Kanak réquisitionnés dans le cadre du régime de l’indigénat, enfin par des travailleurs asiatiques et océaniens introduits dans la colonie sous un statut d’exploitation quasi-servile dit d’« engagement ». Particulièrement répressif, hiérarchisé et ségrégué, cet ordre colonial stabilisé dans les premières décennies du XXe siècle a continué à structurer les rapports sociaux en Nouvelle-Calédonie après la fin de l’ère coloniale stricto sensu. L’accession des Kanak à la citoyenneté en 1946 n’a pas fondamentalement changé la donne, en raison de la politique de l’État et du conservatisme des élites blanches locales, mais aussi de l’encadrement étroit du vote kanak par les Missions chrétiennes favorables à des aménagements prudents du système existant, plutôt qu’à un bouleversement radical des relations coloniales.
C’est au tournant des années 1970 que les premiers intellectuels et étudiants kanak formés dans les universités métropolitaines – le premier bachelier kanak ne date que de 1962 –, témoins ou acteurs de Mai 68 et nourris des idéologies tiers-mondistes et marxistes alors en vogue, sont revenus dans l’archipel et ont dénoncé haut et fort le « colonialisme » subi par le « peuple kanak ». Contre le racisme et les discriminations, la négation culturelle et la marginalisation socio-économique, les spoliations foncières et l’enfermement dans les réserves, ils ont exigé la décolonisation et l’indépendance de la « Kanaky ».
Au même moment, l’État a favorisé une nouvelle vague de peuplement français dont l’enjeu était explicité en ces termes par le premier ministre Pierre Messmer dans une lettre du 19 juillet 1972 : « La présence française en Calédonie ne peut être menacée, sauf guerre mondiale, que par une revendication nationaliste des populations autochtones. À court et moyen terme, l’immigration massive de citoyens français métropolitains et originaires des départements d’outre-mer devrait permettre d’éviter ce danger, en maintenant et en améliorant le rapport numérique des communautés. À long terme, la revendication nationaliste autochtone ne sera évitée que si les communautés non originaires du Pacifique représentent une masse démographique majoritaire. »
Les Kanak sont effectivement devenus minoritaires à cette époque : ils représentent depuis lors environ 40% de la population calédonienne. L’hostilité de la quasi-totalité des non-Kanak à cette revendication d’indépendance a conduit à une opposition violente entre les deux camps pendant les années 1980 – pudiquement surnommée « les événements » – qui a fait plus de 80 morts dans l’archipel, dont ceux de la fameuse grotte d’Ouvéa en avril-mai 1988.
Contre toute attente au lendemain d’Ouvéa, la paix civile est finalement revenue à l’occasion de la signature des accords de Matignon-Oudinot en juin et août 1988. Négocié sous l’égide du premier ministre Michel Rocard, ce compromis politique inédit entre indépendantistes et loyalistes a repoussé la question de l’indépendance à dix ans, organisé un réel partage du pouvoir et initié d’importantes mesures de rééquilibrage social, économique et culturel en faveur des Kanak. En 1998, les signataires dans leur ensemble ont préféré repousser à quinze ou vingt ans le référendum d’autodétermination initialement prévu et signer à la place un nouveau compromis, l’accord de Nouméa. Celui-ci a poursuivi la dynamique de Matignon en y ajoutant le transfert progressif et irréversible de toutes les compétences non-régaliennes à un gouvernement local obligatoirement collégial (composé d’indépendantistes et de loyalistes), la création d’une citoyenneté calédonienne à l’intérieur de la citoyenneté française ouvrant à des droits sociaux et politiques particuliers, et la reconnaissance officielle de l’identité kanak. Le ou les référendums de fin doivent statuer sur le transfert des compétences régaliennes (défense, police, monnaie, justice, relations internationales) et donc sur la création d’un État souverain et indépendant de la France. Nous en sommes là aujourd’hui.
Un référendum historique
Le scrutin de dimanche dernier est historique à plus d’un titre. Depuis l’émergence de la revendication indépendantiste kanak dans les années 1970, jamais un référendum d’autodétermination n’avait été organisé sur la base d’un corps électoral faisant l’objet d’un accord unanime dans les deux camps – si l’on excepte quelques mouvements politiques largement minoritaires. Bien au contraire, l’opposition des légitimités en Nouvelle-Calédonie s’est longtemps cristallisée sur la question des frontières du groupe appelé à fixer le destin politique de l’archipel.
Jusqu’au début des années 1980, les indépendantistes considéraient qu’au nom du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, seuls les Kanak, en tant que peuple autochtone colonisé, étaient légitimes à se prononcer sur l’avenir du pays. Les loyalistes leur opposaient la légitimité démocratique à la française – un homme égal une voix – et le fait que les citoyens français vivant en Nouvelle-Calédonie étaient en majorité opposés à l’indépendance. Certes, leur rétorquaient les indépendantistes, mais dans le contexte de la colonisation de peuplement de l’archipel, la règle démocratique devient un outil pervers entérinant l’injustice coloniale et la marginalisation des colonisés dans leur propre pays, à l’image des Indiens d’Amérique du Nord ou, plus près du Caillou, des Aborigènes d’Australie ou des Maori de Nouvelle-Zélande. Les affrontements violents de la décennie 1980 découlent fondamentalement de ce conflit de légitimités et de sa répercussion sur le corps électoral.
Au gré des rapports de force politiques et des négociations successives, les lignes ont cependant peu à peu bougé, les loyalistes acceptant d’envisager une certaine restriction du corps électoral tandis que les Kanak ouvraient progressivement leur droit à l’autodétermination aux « autres » : d’abord à ceux qu’ils ont appelés dès 1983 les « victimes de l’histoire » (descendants des bagnards, des colons libres ou des coolies asiatiques et océaniens de l’ère coloniale), puis aux personnes ayant au moins un parent né sur place, puis à tous les natifs, puis à tous les habitants installés dans l’archipel avant une certaine date.
Si les accords de Matignon et de Nouméa ont pu ramener la paix et organiser un processus inédit de « décolonisation » – le mot a été prononcé par Michel Rocard dès 1988 puis repris dans le texte de l’accord signé dix ans plus tard –, c’est parce qu’un compromis historique a été trouvé sur cette épineuse question du corps électoral. Par leur signature au bas de l’accord de Nouméa en 1998, les représentants de l’État français, du peuple kanak et des autres composantes de la population calédonienne ont conjointement et solennellement reconnu que la question de l’indépendance serait finalement tranchée par tous les citoyens français installés en Nouvelle-Calédonie au plus tard le 31 décembre 1994 et y résidant de façon permanente depuis au moins vingt ans, ainsi que leurs descendants. Ce dispositif a abouti en 2018 à un corps électoral « gelé » de 175 000 personnes appelées à se prononcer sur l’avenir politique de la Nouvelle-Calédonie, et à l’exclusion de 35 000 citoyens français inscrits sur les listes électorales générales (pour les scrutins nationaux) et installés dans l’archipel après 1994. Le 4 novembre 2018, pour la première fois dans l’histoire politique récente de la Nouvelle-Calédonie, la question de l’indépendance a donc été posée à une population unanimement reconnue comme légitime à trancher cette question.
Si le scrutin est historique, c’est aussi parce que la population concernée par le référendum s’est montrée à la hauteur de l’enjeu en se rendant massivement et pacifiquement aux urnes. Avec une participation électorale de 80,63% des inscrits, soit 141 000 votants, les Calédoniens ont donné une ampleur sans précédent au vote – aucun autre référendum local ou national n’a jamais mobilisé une telle proportion d’électeurs dans l’archipel.
Au vu des profondes transformations politiques, économiques et sociales qu’a connues la Nouvelle-Calédonie depuis 1988, des dispositifs de rééquilibrage mis en œuvre pour lutter contre les discriminations et les inégalités héritées de l’époque coloniale – qui ont en partie porté leurs fruits, même si beaucoup reste encore à faire –, enfin du temps passé depuis les « événements » et de l’émergence de nouvelles générations supposément désintéressées de la politique, de nombreux commentateurs prévoyaient une abstention élevée du côté kanak et indépendantiste.
Le démenti des urnes est ici cinglant : manifestement, l’aspiration à l’indépendance chez les Kanak ne s’est absolument pas essoufflée. Elle semble aussi vive aujourd’hui qu’hier, dans le contexte désormais apaisé et en quelque sorte postcolonial de l’archipel où, depuis trois décennies, l’identité kanak est officiellement reconnue, le pouvoir politique effectivement partagé, et le secteur-clé de l’économie du nickel largement investi par les dirigeants indépendantistes. Que les trajectoires sociales des Kanak se soient considérablement diversifiées (salarisation, urbanisation, scolarisation accrue…) et, pour certaines d’entre elles, véritablement améliorées (on compte aujourd’hui des classes moyennes kanak qui n’existaient pas avant les années 1990), ne change rien à l’affaire : comme le disent traditionnellement les militants indépendantistes, « la consigne demeure » et « la lutte continue ».
Dans le camp du maintien dans la France également, la mobilisation des électeurs s’est révélée particulièrement importante, comme en témoigne le taux de participation très élevé en province sud (83%), fief des loyalistes, où le non emporte près de 74% de suffrages. Les analyses approfondies du scrutin révèleront peut-être des dynamiques électorales plus fines – notamment un meilleur score qu’attendu des indépendantistes dans l’agglomération de Nouméa –, mais de prime abord les deux camps semblent toujours aussi cloisonnés en termes communautaires que par le passé, et le rapport de force global n’a guère évolué.
Selon toute vraisemblance, les partisans de l’indépendance restent très majoritairement kanak et ceux du maintien dans la France très majoritairement non-kanak. Au sein du corps électoral référendaire, les seconds comptent 18 000 voix de plus que les premiers, soit un écart conséquent – bien qu’il soit finalement presque deux fois moindre que le nombre d’abstentionnistes (34 000 inscrits). Difficile de savoir aujourd’hui si l’un ou l’autre camp pourra compter lors du prochain référendum sur des réserves de voix supplémentaires parmi ces abstentionnistes, dont le pourcentage est déjà extrêmement bas, mais qui pourraient changer le résultat final.
Il faut cependant noter que la participation s’est avérée nettement moins élevée aux îles Loyauté (Maré, Lifou et Ouvéa), traditionnel bastion indépendantiste, qu’ailleurs : 9 000 inscrits loyaltiens n’ont pas pris part au vote contre 13 000 votants (indépendantistes à plus de 82%), soit une participation de 59% dans ces trois îles uniquement peuplées de Kanak. On ignore si cette mobilisation électorale relativement modeste est liée à un désintérêt ou une hésitation autour de la question de l’indépendance, à l’appel au boycott lancé par le Parti travailliste – petite formation indépendantiste radicale dont le leader est originaire des Loyauté, mais dont la consigne a été très peu suivie à l’échelle de la Nouvelle-Calédonie –, ou à un problème technique d’acheminement des procurations de vote pour les nombreux inscrits loyaltiens domiciliés à Nouméa. Les indépendantistes vont certainement tenter « d’aller chercher » ces abstentionnistes kanak des Loyauté pour le référendum de 2020, tout en tentant une nouvelle fois d’attirer les non-Kanak dans leur camp – même si apparemment cette stratégie n’a guère payé lors du scrutin de dimanche dernier.
La décolonisation comme question politique et comme enjeu social
À première vue, la Nouvelle-Calédonie paraît donc toujours coupée en deux blocs politico-ethniques opposés et d’importance à peu près égale. On aurait tort cependant de penser que la situation n’a pas évolué, car les projets actuels d’indépendance ou de maintien dans la France défendus par les principaux partis politiques se sont considérablement rapprochés d’un point de vue institutionnel ou sociétal, et n’ont plus grand-chose à voir avec les oppositions tranchées des années 1980. Le rapprochement de ces positions, mais aussi l’équilibre global des forces que le scrutin de dimanche a révélé, incitent plutôt à un optimisme prudent dans la perspective des négociations qui s’ouvriront forcément à l’issue du deuxième ou du troisième référendum, quel que soit par ailleurs le résultat de ces consultations. Une solution de compromis pacifique et acceptable pour tous aura certainement d’autant plus de chances d’être trouvée que la minorité perdante sera suffisamment forte pour ne pas être écrasée par la majorité gagnante, et que les propositions émises par les deux camps ne seront pas aux antipodes (si l’on ose dire) les unes des autres.
Sur la question du lien politique entre la France et l’archipel, les indépendantistes défendent désormais explicitement un statut d’indépendance-association en partenariat avec la France : le futur État souverain – qu’il s’appelle Nouvelle-Calédonie, Kanaky, Kanaky-Nouvelle-Calédonie, ou encore autrement – pourrait décider librement et dans son intérêt de confier certaines de ses compétences régaliennes à un autre État – par exemple la France – et de nouer avec lui un partenariat économique privilégié, comme le font déjà certains micro-États du Pacifique avec la Nouvelle-Zélande, l’Australie ou les États-Unis. Les loyalistes demandent de leur côté la plus grande décentralisation possible pour la Nouvelle-Calédonie au sein de la République, celle en pratique d’un État fédéré. Confins de l’autonomie ou État associé : les points de vue des loyalistes et des indépendantistes en la matière n’ont jamais été aussi proches, et un accord ultime sur les enjeux institutionnels concrets que soulève cette alternative ne paraît pas inatteignable, en dépit de la force symbolique toujours très prégnante et clivante des mots « France » et « indépendance ».
En matière économique ensuite, et sans rentrer ici dans les détails d’un débat complexe, la question du rapport entre les transferts financiers venus de la métropole – remplacés en cas d’indépendance par des dispositifs de coopération et d’aide au développement – et la création locale de richesses – le territoire détient près du quart des réserves mondiales de nickel – suscite des prises de position idéologiques diverses chez les indépendantistes et les loyalistes, mais parfois aussi des stratégies de développement assez analogues. Là encore, rien qui paraisse véritablement insurmontable dans le cadre d’une négociation politique.
En ce qui concerne enfin le projet social actuel et futur pour la Nouvelle-Calédonie, l’une des innovations les plus marquantes des accords de Matignon et de Nouméa est certainement d’avoir placé l’archipel dans une dynamique politique de réconciliation historique entre les diverses composantes de sa population. Le fameux « destin commun » promu par l’accord de Nouméa est censé manifester l’appartenance à une « citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie » qui réunirait le « peuple kanak » et les autres « communautés » au sein d’un « pays » en voie d’« émancipation ». Tous ces termes entre guillemets, lourds de sens, sont mentionnés à dessein dans le préambule de l’accord, qui par ailleurs « reconnaî[t] les ombres de la période coloniale, même si elle ne fut pas dépourvue de lumière ».
De ce point de vue, l’enjeu est finalement moins de savoir si cette émancipation se déroule à l’intérieur ou à l’extérieur de la République – les indépendantistes comme les loyalistes prônent désormais le destin commun –, que d’examiner les transformations pratiques des rapports sociaux hérités de la colonisation. C’est une autre façon de problématiser la fameuse question du rééquilibrage, sur laquelle, une fois de plus, il me semble difficile d’émettre un avis tranché : par certains aspects la société calédonienne est beaucoup moins coloniale qu’il y a trente ans, par d’autres elle le demeure encore très largement.
En tout état de cause, en Nouvelle-Calédonie comme dans les autres colonies de peuplement où les colons sont « restés », la question du colonialisme et de la décolonisation ne se résume jamais seulement au lien politique entre la colonie et la métropole : elle est également « internalisée » au sein de la société locale et porte toujours aussi sur le lien social entre (ex-)colonisateurs et (ex-)colonisés. Pour les indépendantistes kanak en lutte, la situation difficile des Aborigènes voisins, qui représentent aujourd’hui moins de 4% de la population australienne, et que l’indépendance de l’Australie vis-à-vis du Royaume-Uni n’a absolument pas « décolonisés », constitue un contre-exemple éloquent. Le cas aborigène permet en retour de bien saisir la double dimension du contentieux colonial en Nouvelle-Calédonie, question politique certes, mais aussi enjeu social.
La remise en cause des relations de pouvoir existantes, la transformation structurelle des hiérarchies, des discriminations et des inégalités héritées de l’ère coloniale, la réévaluation concrète et continue de la « présence kanak » (pour reprendre l’expression de Jean-Marie Tjibaou) dans tous les aspects de la vie sociale calédonienne, la refondation des liens de « concitoyenneté » entre les Kanak, les « victimes de l’histoire » et les autres Calédoniens concernés par le destin commun, en un mot la décolonisation des rapports sociaux, constituent des processus complexes et diffus qui prennent beaucoup de temps. Cette dimension sociale et quotidienne de « la lutte » ne s’achèvera pas au lendemain du ou des référendums de 2020 et 2022, quel que soit le futur institutionnel de l’archipel. Non, décidément, la Nouvelle-Calédonie n’a pas fini de nous étonner.
