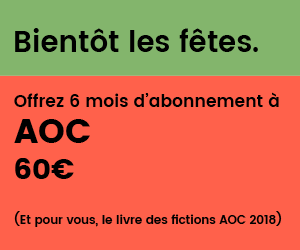La France contrainte des Gilets Jaunes
Les trois semaines qui ont séparé le moment fondateur du mouvement des gilets jaunes, le 17 novembre, des premières annonces gouvernementales relatives à l’abandon de la hausse des prix du carburants puis au soutien du pouvoir d’achat, le 10 décembre 2018, ont permis aux analystes et aux chercheurs de faire la découverte d’un mouvement social totalement inédit dans son origine, dans ses vecteurs de mobilisation comme dans ses effets territoriaux.
Faute de précédent, et avec aussi peu de recul, l’analyse se doit de rester humble sur le sujet. Toute tentative de catégorisation tombe bien souvent dans la caricature et le réductionnisme. S’il est difficile de saisir toute la diversité des facteurs explicatifs à ce mouvement, il est cependant possible de dire au moins ce qu’il n’est pas. On souhaite en particulier revenir sur l’affirmation galvaudée d’un mouvement qui serait issu de la « France périphérique », et qui viendrait s’opposer à une autre France, celle de l’élite et des métropoles, en une sorte de répétition du jeu éternel des luttes entre dominants et dominés – mais qui prendrait, désormais, une forme spatiale. Cette explication est commode, car elle est binaire et simpliste ; elle permet de radicaliser les positions et galvanise les foules. Elle est pourtant fausse, tout comme l’est l’idée même de la France périphérique.
Plus qu’une périphérie, c’est la marge périurbaine qui domine
Il existe bien entendu un facteur géographique qui semble évident pour justifier l’idée d’une opposition entre métropoles privilégiées et France périphérique : celui de la distance, et du coût croissant de la facture d’essence à mesure que l’on s’éloigne des centres d’agglomération. La distance à la ville est bel et bien un paramètre incompressible pour accéder à un emploi, aux qualifications et/ou aux services, dans la mesure où ces facteurs tendent à se concentrer toujours plus dans les principales agglomérations du territoire national. Ce coût de la distance ouvre ainsi, selon Jérôme Vignon, vice-président de l’Observatoire national de la précarité énergétique, au risque de « grande vulnérabilité énergétique » (risque défini en 2018 comme « probabilité de subir des dépenses supérieures au double de la médiane nationale à la fois au titre du chauffage domestique et au titre des transports quotidiens »). Cette vulnérabilité est d’autant plus élevée que l’on demeure « loin des pôles urbains, pour atteindre le maximum de 9,5% en zone rurale hors de toute aire urbaine soit 3,5 fois plus que la moyenne nationale ». Certes, la plus forte proportion de populations à bas revenus dans l’espace rural éloigné (agriculteurs, ouvriers) influe sur ce résultat, mais le poids de la dépense en carburants joue aussi son rôle dans l’aggravation des chiffres.
Pourtant, plusieurs analyses (Aurélien Delpirou, Sylvain Genevois) ont montré que la mobilisation des « gilets jaunes » n’est en réalité pas proportionnelle à la distance aux centres des grandes agglomérations. Au contraire, elle s’inscrit dans une étroite dépendance aux métropoles, les lieux de la mobilisation étant, dans leur quasi-totalité, inscrits dans les « couronnes périurbaines », ces territoires ruraux qui sont hors des espaces bâtis en continu, mais sous la dépendance immédiate des villes pour l’emploi et les services rares ou intermédiaires. Et c’est précisément cette dépendance territoriale, ce lien nécessaire entre rural et urbain qui pèse sur l’essentiel des frondeurs : la hausse des prix des carburants est d’autant moins supportable que cette dépense est incompressible. Au-delà du périurbain, dans les espaces ruraux plus éloignés, la question des mobilités se joue en partie en-dehors de la ville et n’est pas forcément contrainte au quotidien, l’emploi pouvant être disponible sur place. En d’autres termes, la dépense liée au coût des transports est un peu plus arbitrable en rural que dans le cadre des migrations quotidiennes du travail des populations périurbaines. On ne trouve ainsi guère de points de mobilisation en Bourgogne, en Poitou ou sur les hauteurs du Massif central, de la Haute-Loire au Tarn et à la Corrèze.
Certes, on pourra arguer du fait que ces territoires ont surtout moins d’habitants que d’autres ; il faut pourtant voir plus loin. En effet, la typologie des lieux soumis à blocage ou occupation contient en elle-même l’essence de la vie périurbaine : ronds-points aux entrées de ville, barrières de péage, dépôts pétroliers, parkings des zones commerciales agrègent l’essentiel des rassemblements. Tout est lié à la voiture, ce qui est logique puisqu’on parle de taxes sur les carburants ; mais c’est aussi sans doute parce que l’on occupe plus aisément un territoire que l’on connaît bien et dont on maîtrise les points sensibles. Plus encore : en procédant ainsi, le mouvement des « gilets jaunes » vise d’abord à se rendre visible à lui-même, et à faire entrer dans la mobilisation toutes celles et ceux qui partagent les contraintes quotidiennes de la mobilité. A l’inverse, gares, nœuds de transports en commun ou aéroports n’ont que peu fait l’objet de blocages – or il est permis de supposer que c’est plutôt là que l’on pouvait interpeller la « France d’en haut ». Quant aux rassemblements de centre-ville, ils s’adressent quant à eux directement au pouvoir national (préfectures, palais de l’Elysée).
Autre élément fondamental : ce ne sont pas non plus les plus pauvres qui se sont mobilisés. Les premières analyses ont montré des populations dont les revenus sont « modestes », selon Olivier Galland, et compris quelque part entre 1000 et 2000€ par mois – bien entendu, l’ordre de grandeur est approximatif et il existe des personnes sous ces montants ; mais pour pouvoir se mobiliser sur les questions de carburant, encore faut-il être motorisé, et avoir un motif de déplacement, c’est-à-dire en général un emploi. Aurélien Delpirou parle ainsi des « fractions consolidées des classes populaires ». La France la plus pauvre, faut-il le rappeler, est d’abord intra-urbaine, et ce n’est pas cette France-là qui semble s’exprimer, elle dont la souffrance est malheureusement encore en-deçà des enjeux matériels des « gilets jaunes ». Au contraire, la France périurbaine, c’est bien celle qui a pu opter pour un logement hors de la ville et qui a un emploi : rappelons que le revenu médian des espaces périurbains est, d’une manière générale, supérieur à la médiane nationale, et que les taux de chômage comme les taux de pauvreté y sont les plus bas du pays.
Le rôle central des dépenses contraintes
Quelle est donc le mal-être spécifique qu’affichent ces populations d’abord périurbaines ? Elle est liée avant tout au poids des dépenses contraintes, c’est-à-dire à l’ensemble des frais pré-engagés, sur lesquels on n’a quasiment pas de prise : loyers ou remboursements de prêts, abonnements téléphoniques, eau, gaz, cantine, assurances, etc. Ainsi, en dépit d’une hausse globale du pouvoir d’achat, la part des dépenses contraintes a augmenté quant à elle encore plus vite, passant de 12 à 29% des revenus en moyenne en un demi-siècle, si bien que la part de revenu arbitrable – ce qui reste une fois les factures payées – est orientée à la baisse.
Or c’est ici que réside le cœur du problème périurbain : ce territoire est précisément celui du cumul des dépenses contraintes. On y trouve à la fois la plus grande part d’accédants à la propriété, avec une part des remboursements de prêt et charges dépassant le quart du montant de leurs revenus ; et la plus grande part de dépenses de carburant, qui est elle aussi à considérer comme une dépense contrainte dès lors qu’elle est liée essentiellement à l’emploi. On n’a pas encore pris, sans doute, toute la mesure des conséquences de cette extension historique de l’influence urbaine hors des villes. Le périurbain, un « urbanisme d’opportunité », a en effet été promu pendant plusieurs décennies comme une alternative aux banlieues, selon les préceptes de l’anti-urbanisme qui voulait développer une société de propriétaires. Dopée par les aides à l’accession et à la construction, motivée par un marché de promoteurs-constructeurs qui proposait une solution rentable face à l’envol des prix de l’immobilier en ville, l’offre périurbaine a ainsi fixé dans la campagne une France contrainte, plus que toute autre sensible aux variations de ses conditions matérielles de vie et enserrée dans ses dépenses de logement et de transport.
A la contrainte périurbaine, on peut enfin ajouter – toujours avec prudence – une autre surreprésentation géographique, si l’on rapporte toutefois le nombre de points de blocage à l’importance démographique des agglomérations : celle des petites villes ouvrières touchées par la désindustrialisation. Elles aussi possèdent leur propre couronne périurbaine ; mais s’y ajoute un contexte défavorable de crainte sur l’emploi, avec des revenus médians plus modestes que la moyenne. Ce sont ces villes laissées à l’écart de la dynamique métropolitaine qui génèrent d’ailleurs, en moyenne, les plus grands sentiments d’insatisfaction de conditions de vie : non pas le rural, ni même le cœur des grandes villes, mais bien les petites agglomérations qui voient avec perplexité la réduction des services publics alors même que leur effort fiscal doit se renforcer. La fragilité sociale de ces petites villes industrieuses se manifeste ainsi par leur mobilisation élevée dans le Nord-Est, en basse Seine ou dans l’Est parisien, mais aussi de Fos-sur-Mer à la Ciotat, ou encore les pôles anciens de l’industrie et du textile de Roanne ou Montluçon.
Un moteur transversal : l’idée de justice fiscale
Ceci étant dit, il est difficile d’aller plus loin dans l’interprétation géographique du mouvement des « gilets jaunes ». En effet, il n’y a pas de déterminisme des lieux. Dans une société devenue très mobile, les inégalités sont partout : « les modes de vie brouillent les cartes, recomposent les catégories territoriales. Les « gilets jaunes » ne sont pas des ruraux ou des périurbains, ils sont à la fois des résidents périurbains, des usagers ou salariés des services de la ville moyenne et d’anciens habitants ou d’actuels consommateurs des métropoles », tranche Daniel Béhar. L’idée de la « France périphérique » serait ainsi un miroir rassurant d’auto-identification, binaire, face à une société qui ne l’est plus. De fait, la grande richesse peut être rurale et éloignée : certaines localités touristiques ou villages gentrifiés ne posent pas problème à ceux qui ont les moyens du voyage. L’espace périurbain est lui-même très segmenté socialement, les couronnes de l’Ouest parisien ou de l’Ouest lyonnais étant particulièrement aisées, rejetant les catégories socio-professionnelles les plus modestes vers des marges plus éloignées, ou bien vers l’Est. Enfin, toutes les petites villes ne sont pas non plus en crise, loin s’en faut, elles qui bénéficient, notamment au sud-ouest du territoire, de la « circulation invisible des richesses » et des apports redistributifs de l’économie résidentielle théorisée par l’économiste Laurent Davezies.
En somme, il est vain de chercher une explication géographique ultime à la crise des « gilets jaunes », tout comme au mal-être social qui s’exprime plus largement dans la société française dans son ensemble. Les territoires ne sont pas la cause des problèmes, ils en sont le révélateur : l’espace périurbain ou les petites villes du déclin industriel, par leur composition sociale particulière, rendent plus visibles qu’ailleurs des revendications de fond qui traversent en réalité la société dans son ensemble. Les arguments de fond du mouvement en cours relèvent avant tout d’une exigence de justice fiscale, laquelle s’est cristallisée autour du refus de transférer les produits d’une fiscalité proportionnelle aux revenus, relativement équitable, vers une fiscalité à la consommation, qui est l’impôt le plus inéquitable qui soit. En négligeant la réalité quotidienne des dépenses contraintes des ménages, et en ignorant le poids des représentations sociales de l’inégalité, on en vient à provoquer une dégradation d’ensemble du consentement à l’impôt, et l’on sape ainsi dangereusement les bases du modèle républicain.