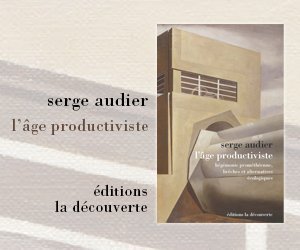Une autre face de la République islamique d’Iran
Levons tout de suite une équivoque. Contrairement à ce qu’on entend ici ou là, ces jours-ci, l’Iran ne fête pas le quarantième anniversaire de la « révolution islamique », car la révolution de 1979, n’était pas « islamique », ou pas seulement « islamique ». Comme toutes les vraies et grandes révolutions, elle a rassemblé des acteurs et des revendications disparates, sinon contradictoires. Ce n’est que dans un deuxième temps, à la faveur de la guerre imposée par l’Irak, en 1980, qu’une partie, et une partie seulement, de ces courants islamiques, à savoir les khomeynistes, se sont emparés du pouvoir et ont écrasé ou écarté les autres composantes de la mobilisation, y compris certains courants islamiques, tels que les Moudjahidin du peuple, le Mouvement national de libération, le grand ayatollah Shariatmadari, et la plupart des « sources d’imitation » de Nadjaf, en Irak.
La prise en otage des diplomates américains, en novembre 1979, a été une étape décisive de ce processus de captation de la révolution par les khomeynistes. Encore faut-il ajouter que ces derniers n’étaient pas eux-mêmes unis. À partir de 1984, l’Association des clercs combattants s’est opposée à la Société du clergé combattant, en se réclamant l’une et l’autre de l’ayatollah Khomeyni. Cet affrontement a constitué les prémisses de la compétition ultérieure entre réformateurs et conservateurs, que l’on présente généralement, de manière erronée, comme une bataille entre « radicaux » et « modérés ». En d’autres termes, la révolution de 1979 a été politique et sociale, plutôt que religieuse. L’oublier, c’est se perdre dans les faux débats qui prédominent aujourd’hui au sujet de l’Iran. Que le champ religieux ait bénéficié de la révolution est une évidence, mais une conséquence des événements plutôt que leur explication.
En outre, la phase révolutionnaire, de plus en plus violente à partir de l’été 1979, a été étouffée en 1983 lorsque l’ayatollah Khomeyni a imposé le principe du gouvernement du jurisconsulte (velayat-e faqih), y compris à l’essentiel de l’institution cléricale qui n’y était pas favorable et n’était pas révolutionnaire. L’Iran n’est donc pas en révolution, certainement pas en révolution islamique, depuis 1979, mais en République islamique. Une République qui s’est institutionnalisée, qui repose simultanément sur la légitimité du suffrage universel et sur la légitimité islamique, et qui a fait prévaloir la raison d’État sur la raison religieuse du vivant même de l’ayatollah Khomeyni. Cependant, l’idéal ou la passion révolutionnaire persiste en Iran, au moins sous la forme d’un regret, d’une nostalgie ou d’une accusation : les détenteurs du pouvoir auraient trahi l’espérance révolutionnaire, selon le vieux narratif politique qui prévaut depuis la révolution constitutionnelle de 1906-1909 et oppose l’exigence de justice du peuple (mardom) à l’iniquité de l’État (dolat), non sans reprendre le dolorisme chiite de la célébration de la bataille de Kerbela.
Il est bien des manières de raconter l’histoire de cette République islamique pour comprendre sa longévité. Car, après tout, il y a quelque paradoxe à fêter le quarantième anniversaire d’un régime en ne cessant d’annoncer sa fin prochaine, prédiction de rigueur pour ainsi dire depuis sa naissance, notamment dans la diaspora de Los Angeles. La République islamique n’était pas censée survivre à l’attaque de l’armée de Saddam Hussein en 1980, à la mort de l’ayatollah Khomeyni en 1989, à la crise économique récurrente depuis sa naissance, aux vagues de contestation populaire ou étudiante qui se sont succédé depuis la fin de la guerre avec l’Irak, en 1988, aux sanctions internationales qui pèsent sur elle depuis la prise en otage des diplomates américains en 1979. Le parti de cet article est de la lire à travers le prisme des relations entre la sphère publique et la sphère privée qu’ont profondément transformées la rupture révolutionnaire et l’institutionnalisation du régime postrévolutionnaire. Ces dernières interviennent à des niveaux différents, à des périodes diverses, et souvent selon des logiques contradictoires. Leur analyse permet d’avoir une vision kaléidoscopique de la République islamique.
Secteur public et secteur privé : l’économie en trompe l’oeil
La distinction entre le public et le privé se pose d’abord dans le champ économique. Dans un premier temps, la République islamique a étendu le secteur étatique en nationalisant les banques, les assurances, les principales industries, les mines. Elle a également renforcé le secteur coopératif et l’intervention de l’État dans le commerce intérieur et extérieur afin de « couper les mains des intermédiaires » et autres « sangsues » du bazar. Elle a institué le contrôle des changes. Elle a confisqué les biens des « idolâtres » (taghouti) qui s’étaient exilés pour fuir la répression, en particulier ceux de la Fondation Pahlavi, transformée en Fondation des déshérités, de droit privé mais placée sous l’autorité directe du Guide de la Révolution, tout comme la puissante Fondation des martyrs, créée ex nihilo et abondée par d’autres confiscations. Et elle a esquissé une réforme agraire qui a tourné court.
En effet, dès 1984, les khomeynistes les plus conservateurs et les clercs quiétistes, en particulier ceux de Mashhad, y ont mis le holà et ont freiné l’étatisation de l’économie, tout en dénonçant l’intrusion simultanée de l’État et de son appareil répressif dans la sphère privée de la famille, que sanctuarise l’islam. À l’époque la défense de l’initiative privée dans le domaine économique est donc allée de pair avec celle de l’inviolabilité du privé familial. Or, les acteurs politiques auxquels il fallut alors résister étaient ceux-là même qui deviendront les réformateurs des années 1990 et les figures de proue du Mouvement vert de 2009 : le Premier ministre Mir Hossein Moussavi et la plupart des membres de son gouvernement.
Quoi qu’il en soit, la mort de l’ayatollah Khomeyni a ouvert la voie à une libéralisation croissante de l’économie iranienne sous la houlette des présidents qui se sont succédé depuis 1989, de Hachemi Rafsandjani (1989-1987), Mohammad Khatami (1987-2005) et Mahmoud Ahmadinejad (2005-2013) à Hassan Rohani (depuis 2013), non sans tensions entre les détenteurs du pouvoir étatique et les représentants politiques du secteur privé dont la Chambre de commerce porte les intérêts et dont le Parlement, doté de véritables prérogatives, est la chambre d’écho. L’unification des taux de change, les subventions publiques à certains produits de première nécessité, le statut des investissements étrangers ont été parmi les principales pommes de discorde entre les présidents de la République successifs et ce dernier, qui a bloqué plusieurs réformes économiques et limogé de nombreux ministres.
L’une des principales conséquences de cette politique de libéralisation économique, depuis 1990, a été le développement de ce qu’on nomme, en Iran, le « quatrième secteur », à l’interface du secteur public, du secteur coopératif et du secteur privé reconnus par la Constitution de 1979. La création de filiales ou de joint-ventures, la sous-traitance, les partenariats public-privé, y compris dans le cadre du droit islamique des waqf (biens de mainmorte), ont fourni de formidables opportunités d’enrichissement à la classe politique et à ses affidés, qu’ont décuplées les sanctions internationales, propices à une économie de l’ombre sous l’aile protectrice de l’État et de ses services de sécurité. Il en est résulté quelques grands scandales qui ont mis en lumière l’entregent de golden boys, tels que Jazaeri Arab (1997), Babak Zanjani (2005), Mahafarid Amirkhosravi (2011), à l’échelle régionale et internationale. Ainsi, Babak Zanjani est lié à Reza Zarrab, un opérateur irano-azerbaïdjano-turc compromis dans l’affairisme de la famille et du gouvernement de Recep Tayyip Erdogan, en Turquie, et aujourd’hui en détention aux États-Unis pour avoir participé au contournement des sanctions contre l’Iran.
L’agitation sociale de l’hiver 2017-2018, amplement couverte par la presse internationale, doit se lire sous cet éclairage. Le dépôt de bilan de plusieurs établissements bancaires a provoqué des manifestations de déposants, notamment à Mashhad, la métropole du Khorassan, une région dans laquelle la proportion d’épargnants par rapport à la population totale était la plus élevée du pays. Néanmoins, il est vite apparu que les manifestations étaient trop bien organisées pour être le seul fait des petites gens lésés. De toute évidence ceux-ci bénéficiaient de soutiens sous-marins autrement plus puissants : sans doute de certains acteurs politiques désireux de gêner le président Hassan Rohani, dans la mesure où le Khorassan est le fief de son compétiteur conservateur malheureux lors des élections de 2017, Reza Raisi, mais aussi les plus gros actionnaires du groupe Padideh, en pleine banqueroute et désireux de retrouver leur mise.
Les protestations populaires contre la diminution du pouvoir d’achat qui se sont ensuite propagées vers l’ouest du pays, en délaissant curieusement les provinces les plus pauvres du Golfe et du Baloutchistan, dissimulaient de la sorte un jeu d’intérêts plus complexe auquel certains protagonistes de l’État n’étaient pas étrangers. Il s’agissait bel et bien de bloquer certaines des réformes économiques voulues par le président Rohani, telles que l’unification des taux de change, la baisse des taux d’intérêt bancaire, et les mesures contre le blanchiment de l’argent sale qu’exigeaient le FMI et les États occidentaux comme contreparties de l’accord nucléaire de Lausanne de 2015, et qui étaient une condition sine qua non de la réintégration de l’Iran dans l’économie internationale (le Parlement vient d’ailleurs de se prononcer contre l’adoption de cette réglementation en prenant argument du retrait des États-Unis de l’accord).
Chose peu notée, la dépréciation spectaculaire du rial a permis à l’État de dédommager les plus gros créanciers de ces banques en faillites, la dette de celles-ci étant libellée en monnaie nationale, et les réserves en dollars de la Banque centrale lui donnant le moyen de les indemniser à bon compte. Il va sans dire que le marché foncier a été le haut lieu de la spéculation à un moment où l’appétit des « mangeurs de terre » ne cesse de croitre et financiarise de plus en plus l’accès à celle-ci ou à l’immobilier, dans un contexte d’urbanisation rapide. Les distorsions de prix qui s’en suivent et la stagflation qui s’est installée rendent probable une nouvelle vague de contestation populaire dont il faudra, le moment venu, se demander qui en tire les ficelles et qui en seront les vrais bénéficiaires. L’évolution « thermidorienne » – pour reprendre la problématique de Jean-François Bayart – de la République islamique lui confère une économie politique spécifique qu’il convient de garder à l’esprit et complexifie la compétition factionnelle. L’ordre – privé – de la famille, ou plutôt de certaines familles, nationalement ou localement dominantes, en est le pivot, qu’on occulte souvent à force de privilégier, de manière très normative, le clivage entre « modérés » et « radicaux », ou entre « réformateurs » et « conservateurs », ou entre laïcs et religieux, ou encore entre l’État et la société.
Le champ religieux en tension
En second lieu, les relations entre la sphère publique et la sphère privée impliquent le champ religieux. Nous avons déjà vu qu’une partie du clergé a pris la défense de l’autonomie de la famille (et de la propriété privée) par rapport à l’État dans les années 1980. Néanmoins, la mort de l’ayatollah Khomeyni, en 1989, a modifié les données du problème. Président de la République, son successeur, Ali Khamenei, n’avait qu’un rang clérical secondaire et ne souhaitait pas accéder à la magistrature suprême. Nommé Guide de la Révolution contre son gré, il invita ses pairs à pleurer pour un État dont le chef était un étudiant en religion (talabeh) ! De fait Ali Khamenei n’accéda au titre de « source d’imitation » qu’en 1995, au prix d’une campagne assez laborieuse. En réalité, les clercs de l’Assemblée des Experts et les Gardiens de la Constitution – deux institutions cruciales dans le délicat équilibre des pouvoirs au sein de la République islamique – jouissent d’une autorité et d’une légitimité religieuse beaucoup plus fortes que celles d’Ali Khamenei. Leurs interventions incessantes dans le jeu constitutionnel et dans le filtrage des candidats aux élections, plus encore leur production juridique et théologique ont progressivement étatisé le champ religieux, non sans étouffer sa liberté d’expression et sa créativité, au grand dam du haut clergé resté dans le quant-à-soi des écoles religieuses des principales villes du pays, notamment de Qom et de Mashhad.
En d’autres termes, la religion est devenue une politique publique au service de l’État plutôt qu’à celui de la transcendance, ce qui passe par sa marchandisation croissante, autre sujet de désolation pour bien des clercs. Les cérémonies, les prières sont de plus en plus systématiquement tarifées, et les pèlerinages à La Mecque, à Mashhad ou sur les lieux saints d’Irak et de Syrie sont de plus en plus dispendieux.
Il y a donc une tension latente, et parfois ouverte, entre l’institution sociale du clergé et l’État, une tension qui relève bien de la problématique de la société civile, cette dernière n’étant pas l’autre de l’État, mais la société dans son rapport à l’État, et ne pouvant pas être réduite aux seuls acteurs laïcs ou aux seules organisations non gouvernementales. Ce sera certainement l’un des enjeux de la succession d’Ali Khamenei dont nombre de clercs et de responsables politiques débattent plus ou moins ouvertement depuis les années 1990. Le velayat e faqih (le gouvernement du jurisconsulte) devra-t-il être transmis à un homme ou, comme semblait le recommander Hachemi Rafsandjani dans les dernières années de sa vie, à un collège de clercs – formule en faveur de laquelle Ali Khamenei s’était quant à lui prononcé en 1989, mais à laquelle s’était alors opposé le même Hachemi Rafsandjani tout en préconisant un mandat de Guide de la Révolution limité dans le temps ? Quelles doivent être les prérogatives du jurisconsulte par rapport au président de la République et au Parlement, étant entendu qu’il est lui-même choisi par l’Assemblée des Experts élue au suffrage universel et que la légitimité islamique du régime n’est pas complètement déconnectée de sa légitimité démocratique ? Quelle place laisser au figh, le droit islamique, à la production duquel concourent les principaux ayatollahs à travers leurs interprétations plurielles, et parfois divergentes ? Depuis la révolution de 1979, la République islamique a répondu de manière évolutive à ces questions, récurrentes depuis plus d’un siècle, ce qui explique en partie sa longévité, mais elle reste empêtrée dans ses contradictions.
Notamment, la politisation du champ religieux à laquelle elle a procédé l’a placée en porte-à-faux avec l’espérance révolutionnaire de 1979, que Michel Foucault avait conceptualisée dans les termes contestés d’une « spiritualité politique ». L’obligation du port du voile en est une illustration frappante, encore que souvent mal comprise. Culturellement, le hejab comporte deux dimensions : celle de l’apparence (zaher) et celle de l’intériorité (baten). La première d’entre elles relève de la norme, de l’orthopraxie, éventuellement sanctionnée par la loi ou ses représentants ; la seconde participe de la sphère de la transcendance qui ne concerne que la relation de la croyante à son Dieu, dans l’ordre de la transcendance. Pratiquement il est toujours possible d’opposer la seconde à la première lorsque l’État ou le clergé prétend imposer le port du voile, et bien des femmes ne s’en privent pas dans la vie quotidienne. Mais force est de reconnaître qu’il existe un large consensus dans l’opinion et dans la classe politique pour ne pas soulever la question dans le débat public. Y compris de la part des réformateurs, et des femmes elles-mêmes.
Seule Faezeh Rafsandjani, la fille du président de la République Hachemi Rafsandjani, s’est prononcée contre l’obligation du port du voile et l’organisation d’une consultation populaire à ce sujet, dans les années 1990, et elle était Reconstructrice, non khatamiste. Le hejab est comme un contrat social entre les femmes et la République islamique, un contrat social qui s’est conclu à travers la coercition – l’ensemble des révolutionnaires estimant en 1979 qu’il y avait plus urgent que de défendre les femmes de son imposition par les gros bras des komiteh –, mais qui leur a permis d’étendre leur présence dans l’espace public. Ce faisant, la République islamique a rendu possible l’actualisation d’une éthique qui s’était répandue au fil des transformations sociales des années 1960-1970 et qui a constitué l’un des vecteurs de la mobilisation révolutionnaire : celle de l’« être-en-société » (adam-e ejtemai) capable d’articuler sa vie privée et sa vie publique. Par leur engagement révolutionnaire les femmes des classes moyennes et populaires n’ont pas été les dernières à promouvoir cet idéal et à sortir de la schizophrénie dans laquelle les enfermait la furia modernisatrice de la monarchie. Vouées à l’opprobre de la tradition si elles ne se conformaient pas aux normes de la modernité occidentale, elles trouvèrent dans le port du hejab pendant les manifestations de 1978-1979 le moyen d’être à la fois fidèles à leur conviction ou à leur mode de vie et révolutionnaires, c’est-à-dire modernes. On n’a pas suffisamment vu que la disqualification du port du voile à l’époque du Shah était plus une affaire de classe sociale que de culture ou de religion. Le hejab était la marque du déclassement social, de la subalternité, sous le sceau de la tradition.
De ce point de vue la révolution fut un grand chambardement, vécu de façon souvent traumatique dans les familles, fussent-elles modernes : non seulement les filles sortaient de leur propre chef dans la rue pour manifester ou militer, mais elles le faisaient sous le voile, ce symbole lamentable d’arriération culturelle ! Lorsque la révolution triompha les femmes qui s’y étaient engagées firent valoir leurs droits, ou une partie de ceux-ci, auprès de l’ayatollah Khomeyni. Ce dernier insista sur la nécessité de définir les principes religieux en les contextualisant, à la grande colère des « sources d’imitation » les plus conservatrices mais aussi les plus puissantes, telles que l’ayatollah Khoi, et il maintint le droit de vote des femmes, ainsi que celui d’être élues, tout en se prononçant pour la réforme agraire – autant de prémisses de la prééminence de la raison d’État sur la raison religieuse.
Ainsi, la pratique du voile est ambivalente. Elle est garante de la femme-en-société, elle a pu être un vecteur d’émancipation sociale et politique, elle témoigne aussi bien de l’intériorité religieuse, voire mystique, ou d’un conformisme social, et elle est prétexte à répression policière ou judiciaire, même si aucune loi ne l’impose de manière explicite. Dans son ambivalence le voile assigne les femmes à une forme convenue de féminité, à une sorte de jeu de rôle auquel elles peuvent s’identifier, qui leur permet d’être présentes de manière légitime et autonome dans l’espace public, mais qui n’a pas forcément à voir avec les exigences de la transcendance.
Il ne s’agit évidemment pas de réduire le mécontentement d’une partie de l’opinion à la seule frustration de la « spiritualité politique » de 1979 par le régime issu de la révolution. Une partie de l’opposition est clairement laïque, en tout cas sécularisée, voire antireligieuse. Il ne s’agit pas non plus d’y voir un nouvel Acte de la dramaturgie convenue entre le « peuple » et l’« État ». Simplement la passion révolutionnaire subsiste, soit sous forme de mémoire critique ou de nostalgie, soit comme un idéal militant toujours actif. Peut-être, au fond, est-ce le point de convergence paradoxale entre les manifestants de 2009 qui protestèrent contre le vol de leurs suffrages lorsqu’ils apprirent la réélection au premier tour de Mahmoud Ahmadinejad, contre toute vraisemblance, et les jeunes bassidj, soutiens du régime, qui entretiennent la flamme des martyrs de la révolution et de la « Défense sacrée » face à l’envahisseur irakien, et dont le romantisme politico-religieux ne fait pas forcément bon ménage avec la froide raison d’État de la République islamique.
C’est ce qui fait que l’on peut être à la fois fidèle à la révolution de 1979, et critique par rapport à la République islamique, sans pour autant en remettre en cause la légitimité ou le principe. Des distinguos qui échappent malheureusement à la plupart des médias ou des chancelleries, mais aussi à l’opposition iranienne elle-même, engoncée dans la mythologie du bon peuple (mardom) et du méchant État (dolat) et attendant vainement son heure face au désert des Tartares d’où devrait surgir la crise finale, à la fois désirée et redoutée. Elle s’en trouvera certainement démunie le moment venu. L’avenir de l’Iran appartiendra non aux chevaux de retour de la monarchie ou des Moudjahidin du Peuple, mais à de nouveaux acteurs dont certains sont déjà à l’œuvre dans la pénombre du « quatrième secteur » de l’économie et dans les réseaux financiers souterrains, lesquels pèsent de plus en plus lourd lors des élections, à l’échelle tant locale que nationale. Une chose est sûre : le répertoire du nationalisme, que ne récuse pas la République islamique sans pouvoir en avoir le monopole, sera aussi important que celui de l’islam, étant entendu que le chiisme en est un élément crucial. Et ce répertoire nationaliste est compatible aussi bien avec la sphère privée qu’avec la sphère publique, pour le plus grand bonheur de l’être-en-société, quel que soit son genre.