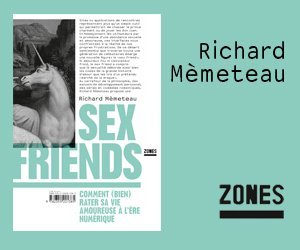Européennes 2019, le retour des outsiders
On sait que l’élection européenne reste un scrutin secondaire. « De second ordre » dit-on souvent en science politique pour marquer son moindre intérêt pour les acteurs traditionnels de l’élection par rapport aux échéances nationales, notamment présidentielles et législatives. De fait, lors des scrutins européens, l’investissement des formations partisanes et la couverture des médias sont plus faibles de longue date, tout comme la participation électorale passée sous la barre des 50% depuis l’élection de 1999. C’est là tout le paradoxe des européennes.
Si le scrutin reste secondaire, il gagne en importance au fil du temps et, surtout, il produit parfois des effets de premier ordre. Depuis les années 1990, l’élection européenne est venue régulièrement affecter les équilibres politiques nationaux. Plusieurs partis ou leaders charismatiques ont pu appuyer leur entreprise politique sur une élection européenne faisant office de marchepied et génératrice de notoriété, de légitimité ainsi que parfois de ressources matérielles pour la vie politique.
Un indice est révélateur de ce potentiel déstabilisateur du paysage politique national en France : le fait que, pour s’en prémunir, le scrutin européen ait été réformé par le parti au pouvoir par deux fois en quinze ans. C’est le cas en 2003 sous le gouvernement Raffarin et en 2018 sous la présidence d’Emmanuel Macron. Les enjeux et les effets de ces réformes électorales méritent qu’on y revienne, car le détour par les cuisines (électorales) permet souvent de mieux juger de la qualité du menu (politique)…
Les spécificités de l’élection européenne vont favoriser le développement du souverainisme en France contre l’UE de Maastricht et de Bruxelles.
C’est notamment dans les années 1990 que l’élection européenne devient un élément perturbateur en puissance du jeu politique national. Au sein d’un système français marqué par des élections à scrutin majoritaire traditionnellement favorable aux partis dominants, l’élection européenne devient une aubaine pour les outsiders : les partis de taille plus modeste mais aussi les nouveaux entrants dans le jeu politique. Si le scrutin européen leur est favorable, c’est pour trois motifs principaux.
Le mode de scrutin proportionnel tout d’abord qui permet d’éviter le vote utile et assure à chaque parti atteignant 5% des voix d’accéder au parlement et aux sièges d’eurodéputés. Le comportement des électeurs ensuite qui, en France comme ailleurs en Europe, tendent à produire une « vote de cœur » à ces élections. Les électeurs favorisent les petites et moyenne formations et sanctionnent régulièrement le parti au pouvoir. Enfin, si l’obtention de sièges est facilitée, se lancer dans la campagne européenne le devient également puisqu’à partir des années 1990, la France se dote progressivement d’un système de financement public des partis. Celui-ci permet aux formations de prétendre à un remboursement des campagnes (à partir de 3% des voix). Dès lors, c’est souvent aux européennes que l’on voit des nouveaux entrants faire leur apparition dans la compétition.
On peut rappeler les succès (parfois éclairs) des listes Philippe de Villiers ou de Bernard Tapie en 1994 (respectivement en 3ème et 4ème place derrière l’UDF-RPRP et le PS, avec plus de 12% des voix et 13 eurodéputés). Le mouvement de Jean-Pierre Chevènement, alors récemment sorti du PS, y fait son apparition. Dans la décennie 1990, le développement de Chasse-Pêche-Nature et Tradition prend appui sur les européennes. L’alliance des trotskystes LO-LCR y obtient ses premiers élus au-delà d’une échelle locale en 1999.
Plus largement, les spécificités de l’élection européenne vont favoriser le développement du souverainisme en France contre l’UE de Maastricht et de Bruxelles, en particulier à droite mais pas seulement. On peut se souvenir de l’entreprise du Pôle républicain qui se donne pour objectif à la fin de la décennie de transcender le clivage gauche-droite et de réunir, derrière la candidature de Jean-Pierre Chevènement aux présidentielles de 2002, « les républicains des deux rives ».
L’élection européenne a longtemps été, et demeure, une source de pluralisme dans l’offre politique française.
Le succès à l’élection européenne ne suffit pas à s’imposer dans un scrutin national néanmoins. Après son coup d’éclat aux européennes de 1994, Philippe De Villiers échoue en 1995, comme Jean-Pierre Chevènement sept ans plus tard (les deux candidats avoisinent les 5%). Pourvoyeuse de bons résultats, d’élus, de notoriété et de légitimité, l’élection européenne permet néanmoins la montée en puissance et le maintien de petites formations. C’est là un effet notoire et souvent peu perçu de la construction européenne sur l’espace partisan français. L’élection européenne a longtemps été, et demeure, une source de pluralisme dans l’offre politique française. Dès lors, du point de vue des partis dominants, elle devient également un vecteur de concurrence et une source d’éparpillement des voix. En particulier à droite.
Le camouflet de l’élection européenne de 1999 pour la droite est sans doute l’élément déclencheur de la réforme électorale de 2003. L’alliance RPR-DL, alors menée par un certain Nicolas Sarkozy, est défaite par les dissidents. L’éphémère coalition de Villiers-Pasqua, partis chacun à la tête de leur propre formation, arrive en seconde position derrière le PS. Avec 13 eurodéputés et 13,05% des voix, les deux leaders entrent auréolés de victoire au parlement européen, à la tête de la première formation de la droite française (pour quelques mois, l’alliance explose un an après sa mise en place).
Les institutions et leurs usages sont le fruit de rapports de force, on le sait. C’est alors que la réforme électorale devient un outil dans la main des plus puissants. En 2003, sous la présidence de Jacques Chirac, le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin réforme l’élection européenne. Fin de la circonscription nationale – et donc de la liste – unique, la France est divisée en 8 grandes régions et chaque parti devra produire huit listes jusqu’en 2014. Les opposants sont vent debout. De fait, la réforme démultiplie les couts et c’est presque huit campagnes au lieu d’une qu’il faut mener. Visant officiellement à rapprocher les eurodéputés de leurs électeurs, la réforme avantage de fait, les formations disposant de moyens matériels conséquents mais surtout d’un réseau militant dense sur l’ensemble du territoire ainsi que de figures populaires ou tout au moins connues derrière le leader, capables de réunir des voix sous leur nom en région… Autant de ressources dont ne disposent pas les nouveaux entrants et les petites formations aux moyens limités et/ou centrées autour d’un leader charismatique.
Les effets de la réforme ne tarderont pas à se faire sentir dans la décennie suivante. Ces nouvelles conditions de la compétition participent de l’affaiblissement voire de la disparition de certaines formations (CPNT, le MPF, le Mouvement des citoyens…) et l’offre politique se resserre progressivement autour des principaux opposants à l’UE : le FN-RN et la FI qui émerge aux côtés du PCF lors des élections européennes de 2009 avant de s’en autonomiser.
Au passage, soulignons donc que la « victoire » historique du FN lors de l’élection européenne de 2014 doit également être lue à l’aune de ces transformations. Sorti en tête des urnes et auto-proclamé « premier parti de France » dans sa propagande post-électorale, le parti bénéfice en 2014 des effets de la réforme de 2003 qui contribue à offrir au FN un espace électoral balayé de nombres de ses rivaux souverainistes à droite.
En prévision de l’élection de mai, le scrutin européen a de nouveau été réformé en 2018 sous la présidence d’Emmanuel Macron. La récente réforme fait écho à celle de 2003 : elle procède des mêmes motifs dans un contexte partisan inversé pour la République en marche. LREM reste un parti jeune, formé autour du leadership central d’Emmanuel Macron et marqué de carences. Celles de figures secondaires populaires ou disposant de notoriété d’abord, celle d’un appareil partisan suffisamment armé également et surtout d’effectifs militants capables de porter des campagnes régionales. Dans ce contexte, la réforme acte un retour à une élection centralisée. Exit les huit grandes régions, l’élection européenne s’organise de nouveau autour d’une liste unique par parti sur l’ensemble du territoire national. Autrement dit, une élection mieux adaptée aux ressources du parti présidentiel qui peut faire campagne depuis Paris, derrière la figure tutélaire de son leader.
La réforme de 2018 (re)fait de l’élection européenne un scrutin particulièrement ouvert aux outsiders et aux nouveaux entrants.
À l’échelle de l’élection à venir, si elle peut favoriser LREM, la réforme ne risque pas d’handicaper ses adversaires, bien au contraire. Nombre d’entre eux, en particulier les petites formations et les entreprises politique formées autour d’un leadership charismatique, sont favorisées par ces nouvelles conditions de campagne. Les principaux adversaires d’Emmanuel Macron profiteront donc également de la réforme en ce sens. On a ainsi vu augmenter les listes qui ont atteint le nombre record de 33 en 2019, et on pourrait faire le pari que ça va continuer lors des prochains scrutins.
Au-delà de l’échéance du mois de mai, on peut imaginer des effets à plus long terme. La réforme équivaut à un retour à la situation des années 1990. On peut donc s’attendre à ce qu’elle produise sur le long terme certains effets similaires. On peut d’ores et déjà en pointer deux.
La réforme (re)fait de l’élection européenne un scrutin particulièrement ouvert aux outsiders et aux nouveaux entrants. On le voit en 2019, ce scrutin à moindre cout et qui offre plus de « chances » d’accéder à des sièges de représentants les motifs évoqués plus haut, donne lieu à la création de nouvelles listes. Celles-ci sont, de fait, souvent formées autour de la personnalité d’un leader. Le récent débat électoral télévisé a ainsi été marqué par le retour – et la multiplicité – des « petits » candidats mais aussi des nouveaux entrants parmi lesquels on peut évoquer François Asselineau, Raphaël Glücksmann, Benoît Hamon dans une certaine mesure ou encore les diverses tentatives de montage d’une liste estampillée « gilets jaunes ».
Les élections européennes redeviennent un potentiel appui au maintien et parfois à l’expansion des certaines petites et moyennes formations. Elles continuent également d’offrir un contexte favorable aux principaux outsiders. Les Verts ont su en tirer parti depuis leur création. Du côté des opposants, le FN, devenu RN, a réussi en deux décennies à être identifié comme un opposant à la fois historique et stable à l’UE actuelle. Sa critique étant devenue, au fil des années 1990, un des piliers doctrinaux du parti. Si les sondages annoncent un bon score au parti de Marine Le Pen, dans ce nouveau contexte renouveler le « succès » de l’élection européenne de 2014 reste néanmoins une gageure. La baisse du cout d’entrée en compétition, la multiplication des listes, en un mot, cette diversification de l’offre électorale produite par la réforme fait de l’élection 2019 une échéance plus ouverte à l’éparpillement des voix que celle de 2014, en particulier pour les opposants à l’UE.
Face à la situation de crise que connait le projet de l’UE ces dernières années, les enjeux européens – sans être absents – peinent comme souvent à prendre de l’ampleur dans cette nouvelle campagne. L’Union européenne, ses politiques publiques et ses acteurs se sont fait plus présents dans les discours au fil des années 1990 et 2000. Néanmoins, alors que 2019 marque les quarante ans de l’élection européenne, on ne peut que constater combien celle-ci reste sous de multiples aspects saisie par les acteurs politiques et leurs observateurs comme une élection française de mi-mandat. Le slogan 2019 de la FI « Stop à l’Europe de Macron » est paradigmatique de cet entrelacement des deux arènes de compétition.
Cette nationalisation des enjeux n’a rien de neuf. Il ressort bien qu’en 2018, comme en 2003, l’élection des eurodéputés reste mobilisée comme un nouvel outil dans la compétition entre partis nationaux. Au cœur de celle-ci, la réforme électorale est une arme politique dans la main des plus puissants, qui aujourd’hui comme hier, ne manquent pas de s’en servir.
Il est probable néanmoins que, comme dans les années 1990, la ré-ouverture de la compétition lors des européennes générée par la réforme de 2018 favorise le pluralisme, et donc la concurrence au sein de l’espace partisan, et poursuive la recomposition en cours du paysage politique français.
NDLR : Emmanuelle Reungoat publie Enquête sur les opposants à l’Europe: à droite et à gauche, leur impact d’hier à aujourd’hui, Le Bord de l’Eau