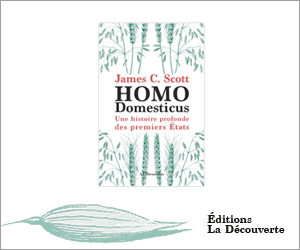Crise de l’Europe : une crise des vocations ?
Une fois encore, les élections européennes n’ont pas particulièrement mobilisé les citoyens européens, en France notamment. Certes en augmentation par rapport à 2014, la participation au scrutin du 26 mai s’est élevée à 51%. Cette faible mobilisation est souvent rapportée à une forme de défiance à l’égard de l’Union européenne. Elle est souvent considérée comme lointaine et peu concrète.
La distance des citoyens est redoublée par une « crise » interne à l’Union européenne, ce qui le Brexit ne fait que renforcer. L’Union européenne est en « crise ». C’est un constat unanime et récurrent. De nombreuses tentatives d’explication l’accompagnent. Elles évoquent tour à tour les « pannes de l’intégration européenne », « l’impasse » dans laquelle les chefs de gouvernement successifs se seraient enfermés, un « effet de fatigue » du processus d’élargissement européen, voire la « grande récession », « l’échec » ou le « déclin » de l’UE. Parmi les conséquences de cet état de crise devenu permanent, la « déprime des eurocrates » est évoquée [1]. Le projet européen serait devenu « démodé ». « L’Euro Bubble » aurait perdu de son intérêt et de son pouvoir d’attraction. De moins en moins de personnes, voire quasiment plus personne, y compris au sein des institutions européennes, « croiraient » encore au projet européen.
Pourtant, l’attractivité de l’Europe politique ne se dément pas. De nombreux jeunes souhaitent s’orienter vers les métiers qui se sont développés avec la construction européenne , et faire partie du monde des eurocrates : plusieurs milliers de personnes [2] font carrière dans les institutions européennes (fonctionnaire européen, assistant parlementaire au Parlement européen, etc.), ou en lien avec celles-ci (chargé de projet européen au sein d’une collectivité territoriale, représentant d’intérêt ou « lobbyiste » pour une entreprise ou une association, etc.), circulant d’un poste à un autre. Au local-national ou à Bruxelles, ces « insiders » ou « permanents » de l’Europe, participent à mettre en forme les problèmes publics, élaborer des décisions, créer ou maintenir des liens entre ou avec les institutions.
Ils sont en charge de tâches administratives, de la communication, de la veille sur la réglementation et les politiques communautaires, de la diffusion d’informations et d’argumentaires, de la recherche de compromis au sein d’une organisation ou d’un regroupement d’organisation, de la formulation de « conseils » ou de « recommandations », de la recherche de financements, de la construction et de la mise en œuvre de projets, ou encore de la rédaction de textes législatifs. Ce « personnel de renfort » des institutions européennes, qui ne forme pas une profession proprement dite, mais plutôt une « nébuleuse professionnelle ou un groupe professionnel », a fortement crû depuis 30 ans.
Même au plus fort de la crise de l’UE, les candidats aux métiers de l’Europe restent toujours très nombreux.
L’augmentation du nombre de postes s’est accompagnée de celle du nombre d’impétrants et d’une concurrence de plus en plus forte à l’entrée de ce marché de l’emploi autour de la construction européenne. De manière emblématique, les concours d’entrée dans la fonction publique européenne sont depuis plusieurs années – et ils le restent plus que jamais – très courus et extrêmement sélectifs [3]. Les postes un peu moins prestigieux et pour partie transitoires, tels que ceux d’assistants parlementaires au Parlement européen, de chargés de mission au sein de groupes d’intérêt et de collectivités territoriales, et même de stagiaires, le sont également : chaque offre d’emploi ou de stage s’accompagne de plusieurs dizaines ou centaines de candidatures.
Les formations qui préparent aux métiers de l’Europe politique et à occuper par la suite une position de « permanent » du champ de l’Eurocratie sont elles aussi fortement demandées, et souvent très sélectives. Tel est le cas du Collège d’Europe, fondé en 1949 à Bruges et partagé depuis 1993 entre deux campus (Bruges en Belgique et Natolin-Varsovie en Pologne). Surnommé l’ÉNA européenne dans les années 1990 en raison de son rôle d’école de formation de futurs hauts fonctionnaires européens et autres élites spécialisées dans les affaires européennes, il accueille chaque année près de 500 élèves (480 en 2016) issus de 55 pays [4]. Tel est aussi le cas des « Masters qui font de l’Europe une réalité », pour reprendre un titre du supplément Éducation du quotidien d’information Le Monde en 2009. Ces masters (niveau bac+5) ont été créés dans l’UE – et même au-delà comme en Suisse par exemple, à l’université de Fribourg et à l’Institut européen de Genève – au sein de départements de droit, d’histoire, de langue, d’économie, et de science politique, et de divers types d’établissements publics ou privés.
Si, par rapport au Collège d’Europe, ils apparaissent comme des formations de second ordre, car moins prestigieux et plus accessibles au vu du processus de sélection et de frais de scolarité moins élevés, une part importante de ceux qui exercent un métier de l’Europe à Bruxelles et au local-national y est désormais formée. Surtout, ces formations connaissent depuis les années 2000 un succès certain, sans que la demande s’essouffle. Même au plus fort de la crise de l’UE, les candidats aux métiers de l’Europe restent toujours très nombreux.
Une enquête sociologique menée auprès d’élèves et d’anciens élèves d’un ensemble de ces masters en France est particulièrement éclairante sur ce que sont devenus les eurocrates ; il s’agit de masters dénommés « affaires», « études » ou « politiques » européennes, ou « métiers de l’Europe », créés au milieu des années 1990 et surtout dans les années 2000, dans les Instituts d’études politiques de Paris et de province et dans des facultés de droit, d’histoire et de science politique.
Ce ne sont pas n’importe quels jeunes qui se tournent vers ces formations aux métiers de l’Europe politique. Ce sont de bons élèves issus des catégories sociales supérieures et intermédiaires (enfants de cadres. Ils ont étudié le droit, la science politique, l’histoire ou les études européennes, et ils se distinguent particulièrement par leurs compétences linguistiques et leur mobilité internationale. Ils parlent une ou plusieurs langues étrangères dont l’apprentissage s’est fait notamment à l’étranger, dans le cadre de dispositifs de mobilité internationale, comme les échanges Erasmus. Ces élèves sont caractéristiques d’une génération Erasmus qui, on doit le rappeler, ne concerne qu’une infime minorité des étudiants en France (moins de 5%). Enfin, ils sont dans l’ensemble plus portés aux compromis qu’aux rapports de force. Ils valorisent des formes d’éclectisme, de polyvalence, d’ouverture et de modération.
Beaucoup de ceux qui travaillent dans les métiers de l’Europe, ceux qui forment les eurocrates, ont des rapports distanciés, impersonnels et instrumentaux à la construction européenne.
Ces éléments ne sont finalement pas si surprenants au regard des métiers concernés : des métiers de l’action publique dans un environnement international. Plus étonnant en revanche est le rapport à l’Europe de ces jeunes. De prime abord, on pourrait s’attendre à rencontrer des militants de la cause européenne, à l’image des pionniers de la construction européenne qui ont participé à développer les institutions, des personnes souhaitant vivre de l’Europe pour l’Europe, pour adapter une formule de Max Weber. Mais la réalité est différente. Si quelques élèves et anciens élèves présentent ce profil, ils sont minoritaires.
Alors que le projet européen a été développé par des personnes qui croyaient dans le projet européen, et qui vivait de et pour l’Europe, le moteur des trajectoires des futurs eurocrates n’est pas ou plus seulement l’engagement en faveur de la construction européenne. C’est là un résultat important, nombreux sont ceux qui présentent un rapport instrumental à l’Europe. L’Europe n’est pas seulement une orientation en lien avec des valeurs (développer le projet européen). Elle est aussi une orientation professionnalisante et prestigieuse. Les métiers de l’Europe sont perçus comme susceptibles de permettre une ascension sociale, et d’apporter un ensemble de rétributions.
Des rétributions matérielles d’une part : un emploi, une rémunération non négligeable notamment pour les postes au sein des institutions comme ceux de fonctionnaires européens, ainsi qu’à un degré moindre les postes de contractuels comme ceux d’assistants parlementaires qui, depuis la mise en place d’un statut, ne sont pas négligeables pour de jeunes diplômés (entre 3 000 et 4 000 euros après une courte expérience).
Des rétributions non matérielles d’autre part : la possibilité de vivre à l’étranger, de voyager, d’évoluer dans une ambiance plus ou moins cosmopolite, de travailler en parlant plusieurs langues, entre soi cosmopolite, interculturalité, etc.
Une conséquence est que beaucoup de ceux qui travaillent dans les métiers de l’Europe, ceux qui forment les eurocrates, ont des rapports distanciés, impersonnels et instrumentaux à la construction européenne. Ils travaillent dans l’Europe comme ils pourraient travailler dans un autre secteur (une banque par exemple), sans ressentiment, sans parti-pris, sans passion, sans haine, sans amour et sans enthousiasme. Il y a là une hypothèse sociologique sur la crise de l’Union européenne, une hypothèse alternative aux explications qui reposent le plus souvent sur les règles institutionnelles, les marchandages politiques, la personnalité des dirigeants, ou une socialisation « techno » des eurocrates. Si crise de l’Europe il y a, c’est aussi parce qu’en son sein les chevilles ouvrières n’ont pas ou plus la vocation.