Notes sur les sociétés du profilage (2/2)
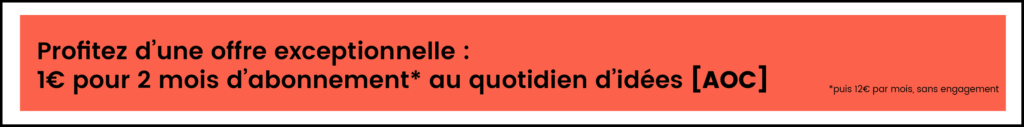
Après les « sociétés de la discipline» analysées par Foucault et les « sociétés de contrôle » prophétisées par Deleuze dans les années 1990, la conjonction des technologies digitales, d’Internet et de certaines logiques de gouvernement nous fait entrer dans un nouveau régime de pouvoir que je nomme « sociétés du profilage », parce qu’il est rendu possible par l’émergence d’un nouvel objet, indissociablement épistémique, économique, technique et politique, le « profil ». Un profil est constitué par un ensemble de traces laissées ou produites par un individu téléphonant, payant, circulant, postant des « contenus », et aussi cherchant des informations sur le Web. Il autorise alors des rapprochements d’individus en communautés, mais aussi des prédictions, et un certain type d’action politique inédit. Après avoir analysé les deux premiers moments, technologiques et économiques, je me pencherai sur les deux suivants, l’un épistémique et l’autre politique, au fondement des sociétés du profilage.
Prédire : le moment épistémique de la multicorrélation
Le passage de données déposées (via la consultation des sites) ou construites (via les achats faits, les consultations de Google, etc.) à la constitution d’un profil nécessite donc une troisième condition que j’appelle le « moment épistémique ».
Tout d’abord, notons que le « profil » comprend en réalité plusieurs strates. Mon comportement d’internaute, chercheur de données, consommateur de sites ou acheteur, constitue mon « profil individuel » : un ensemble de données, temporellement situées, qui permet de reconstituer certaines grandes lignes de ma personnalité (j’aime la musique classique, je suis avec attention les progrès de l’intelligence artificielle, je suis marathonien ou fan de curling). Certaines prédictions peuvent se baser sur ce profil individuel : ainsi, si j’ai souhaité acheter un billet de train pour Londres, des publicités me proposeront des hôtels à Londres ; si mon téléphone, dont je n’ai pas neutralisé les
