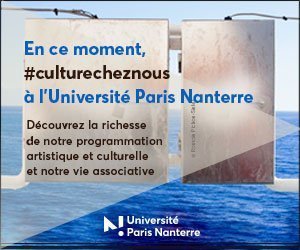Pologne et Hongrie : Covid-19 et tentation autoritaire
La crise du COVID-19 a renforcé les tensions politiques dans les pays d’Europe centrale. En Hongrie, la décision du Premier ministre Viktor Orbán de gouverner par décrets pour une durée illimitée a suscité l’indignation. En mai, des citoyens hongrois, qui avaient critiqué leur gouvernement sur les réseaux sociaux, ont été arrêtés par la police. Le champ politique polonais a plongé dans le chaos à l’approche de l’élection présidentielle, initialement prévue le 10 mai 2020, que le gouvernement essayait d’imposer avec un vote par correspondance, avant de la reporter. Dans les pays déjà engagés sur la voie autoritaire, ce sont non seulement certaines des libertés, mais également un ensemble de règles démocratiques qui risquent de succomber face à la crise sanitaire.
Parmi les effets de la pandémie mondiale en termes d’action publique, le choix des exécutifs polonais et hongrois de renforcer leur pouvoir de manière arbitraire attire l’attention. Comme l’a rappelé Olivier Nay dans AOC, « là où elles sont déjà mises en danger par les tentations illibérales, ces libertés pourraient connaître une régression encore plus forte faute de garde-fous institutionnels ». Si les atteintes aux libertés publiques et au pluralisme ne menacent pas seulement les pays d’Europe centrale et orientale, les choix effectués dans ces pays depuis 2010 (victoire du FIDESZ et l’arrivée au pouvoir de Viktor Orbán en Hongrie) et 2015 (victoire du parti national-conservateur Droit et Justice, PiS, en Pologne) entérinent la « révolution conservatrice » à l’œuvre.
Le regard porté sur ces deux pays, membres de l’Union européenne depuis 2004, nécessite toutefois de se garder de tout exceptionnalisme. Tout d’abord, même dans les démocraties occidentales, des tendances aux pratiques répressives ou arbitraires ont déjà été notées bien avant la pandémie. Ensuite, la menace sanitaire globale contraint un grand nombre de pays à limiter, temporairement, certaines libertés, comme celles de se déplacer,