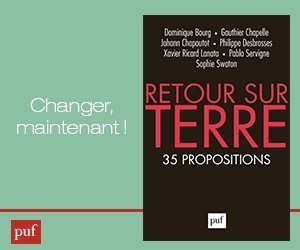À distance : (dé)construire le « chez-soi de travail »
Depuis le début du confinement, le télétravail est présenté comme la solution miracle pour maintenir coûte que coûte l’activité économique : « Le télétravail devient la règle impérative pour tous les postes qui le permettent », affirme ainsi dès le 15 mars 2020 le ministère du travail dans un communiqué.
Au sein d’un tissu économique fortement tertiarisé, le ministère estime alors que « près de 8 millions d’emplois (plus de 4 emplois sur 10) sont aujourd’hui compatibles avec le télétravail dans le secteur privé ». D’emblée, le télétravail se met donc en place, à la va-vite, la plupart du temps hors de tout accord collectif. D’après l’article L. 1222-11 du Code du travail, le télétravail est en effet considéré en cas d’épidémie comme un « aménagement du poste » qui s’impose. Ainsi contraints de rester chez eux depuis plusieurs semaines, ces nouveaux télétravailleurs ont appris à bricoler des solutions, à improviser un bureau dans le salon, à comptabiliser leur temps de travail… Et dans une totale improvisation, les managers ont dû imaginer des solutions pour maintenir le contact.
Même s’il est difficile de savoir exactement combien de personnes sont aujourd’hui réellement concernées[1], car très vite le télétravail a fait place à des mesures de chômage partiel ou total, le statu quo devrait se poursuivre au-delà du 11 mai dans beaucoup de secteurs[2]. Ainsi, alors qu’habituellement, ce mode de travail ne concerne qu’environ 3% des salariés d’après une étude de la DARES[3], le télétravailleur est devenu en quelques semaines une vraie figure médiatique.
Au fil des pages des journaux et des émissions de radio, deux profils-types se dessinent. Le premier profil est celui de la télé-travailleuse qui se retrouve en première ligne pour gérer de front les tâches domestiques ou parentales et les contraintes du travail productif (comme ici). Le second profil est plus polymorphe, ni déterminé par son genre ou par son métier (même s’il semble se retrouver davantage chez les cadres) et s’est rapidement imposé dans l’espace médiatique (comme là). Ce qui le définit, c’est le fait d’entretenir un rapport heureux à sa nouvelle condition de télétravailleur. La satisfaction éprouvée dans le temps présent vaut comme projection enviable dans « le monde d’après » : « ne plus se retrouver dans les bouchons », « vivre et travailler à la campagne », « ne plus voir son chef », « pouvoir s’occuper de ses enfants », « être libre de s’organiser comme on veut », « être plus efficace »… Autant d’arguments répétés qui participent à alimenter un discours dominant plutôt positif sur le télétravail.
Que retenir de ce bruissement ? Le paradigme d’un travail détachable de toute contrainte physique et temporelle va-t-il s’imposer ? Et surtout, la sortie de l’organisation se traduira-t-elle par des aménagements négociés collectivement et individuellement du cadre salarié typique de co-présence, ou par un recours accru à des indépendants évoluant aux marges des organisations ? Certains président déjà une concurrence généralisée et mondiale des travailleurs à distance, y compris sur des tâches qualifiées (voir cette note), figure émergente aux côtés des « tâcherons du clic » payés à la tâche pour des travaux sous-qualifiés.
Si l’exercice de prédiction est toujours périlleux, on peut en revanche nourrir l’analyse en portant un regard rétrospectif sur les transformations du monde du travail sur le temps long. C’est pour alimenter la réflexion que je voudrais ici mobiliser certains éléments tirés de ma thèse, consacrée à la comparaison de professionnels exerçant leur activité à distance sous différents statuts juridiques : des journalistes-pigistes salariés multi-employeurs, des graphistes indépendants cotisant à la Maison des artistes, et des télé-secrétaires indépendantes exerçant sous le régime de la micro-entreprise.
D’ailleurs, ces professionnels cumulent souvent de façon synchronique plusieurs statuts : chômeur/salarié ; indépendant/chômeur/salarié ; indépendant/salarié/auteur… Le travail à distance permet ainsi, tout autant qu’il renforce, l’hybridation des statuts, à la frontière entre le salariat et l’indépendance.
Le travail à domicile, variable d’ajustement du capitalisme
Si cette forme de travail paraît aujourd’hui particulièrement ajustée à ce que d’aucuns appellent le « capitalisme cognitif », il est intéressant de rappeler que les évolutions du travail à domicile soulignent en creux les mutations du capitalisme (voir Lallement, 1990).
Le recours à une main d’œuvre rurale mobilisable en fonction des pics de production et payée à la tâche a ainsi accompagné la naissance des premières filatures dans le contexte de la naissance de la proto-industrie. Puis durant toute la période de maturité du cycle usinier au cours du XIXe siècle, la main d’œuvre s’est féminisée et urbanisée. L’ajustement de l’offre à la demande est alors parfait : l’ouvrière chôme en morte-saison, ne compte pas ses heures quand les commandes arrivent, et se contente d’un salaire de misère.
Si des premières formes de régulation se mettent en place au tournant du XXe siècle, il faut attendre le contexte social de l’après-guerre pour que ces travailleuses à domicile isolées accèdent aux garanties et protections du cadre salarial. La loi du 26 juillet 1957 qui garantit la présomption de salariat au travailleur à domicile met ainsi fin à une longue pratique jurisprudentielle qui avait jusqu’à cette date assimilé le travail domestique au travail indépendant, sur l’argument que la distance physique contrevenait au principe de la subordination juridique qui est au fondement de la relation salariale. Pourtant, dans un contexte de salarisation et de tertiarisation massive de l’économie pendant les Trente glorieuses, le travailleur à domicile de l’ère industrielle disparaît progressivement.
Il faut attendre le début des années 1980, pour que le développement de la « télématique » ouvre une nouvelle ère, celle de l’âge des services : le travail à domicile devient le « télétravail ». Les premiers rapports consacrés au télétravail émanent alors de la DATAR (l’ancêtre du ministère de l’intérieur) avec un enjeu fort de lier le travail délocalisé chez soi avec le développement des territoires[4], mais à partir des années 2000, la paternité des rapports revient au ministère du travail. Il n’y est plus question de logiques de territoire mais de transformation des manières de travailler[5].
La faible diffusion du télétravail en France est alors renvoyée aux « lourdeurs du droit du travail » et il est préconisé aux entreprises de faire preuve d’une plus grande « agilité ». Et pourtant, le cadre législatif a grandement simplifié le recours au télétravail salarié ces dernières années : il est entré dans le Code du travail en 2012 avec un allègement des contraintes pour l’employeur ; et la loi du 29 mars 2018 a encore davantage simplifié les procédures. Depuis cette date, un simple accord entre l’employeur et le salarié permet de mettre en place le télétravail, à condition toutefois que les deux parties soient volontaires.
Mais dans un contexte néo-libéral qui facilite le recours à l’indépendance, via notamment l’instauration en 2009 du régime de l’auto-entreprise, l’externalisation du procès de travail s’accompagne aujourd’hui d’un discours sur la nécessaire sortie du cadre du salariat. C’est ainsi qu’à leurs marges, les organisations peuvent désormais compter sur une armée de réserve d’indépendants qui travaillent sous le statut d’auto-entrepreneurs, parfois dans des conditions de sous-traitance qui relèvent de formes de salariat déguisé. Dans la période de crise économique dans laquelle vont être plongées les entreprises, on peut se demander si le travail à distance, sous cette forme moins protectrice et collective, ne risque pas de se développer.
Essayer de se construire un cadre
Dans les discours faisant la promotion du télétravail, on entend aussi beaucoup d’arguments vantant une meilleure articulation entre vie professionnelle et vie privée. L’équation est présentée comme doublement gagnante : gain de place et de flexibilité pour l’entreprise ; gain d’autonomie pour le travailleur ou la travailleuse à domicile.
Pourtant, au sein de l’espace du domicile qui renforce potentiellement les confusions entre rôle professionnel et domestique, les arbitrages entre temps et espaces de travail et de non-travail relèvent d’une négociation renouvelée entre l’individu et son entourage proche (conjoint, enfant) et le donneur d’ordres (l’employeur, le client). Or ce que montre le travail ethnographique que j’ai mené dans le cadre de ma thèse, c’est que la capacité de construire un chez-soi de travail est inégalement distribuée tant d’un point de vue du genre, des ressources sociales et biographiques, que des logiques de métier.
Pour analyser les ressorts de la construction d’un chez-soi de travail, il faut prendre en compte des éléments qui sont mesurables objectivement, mais aussi être attentif à la manière dont l’individu fait sens de sa situation. Les critères objectifs renvoient à la manière dont l’individu parvient plus ou moins à stabiliser son activité et à en tirer des ressources suffisantes pour être économiquement indépendant. Les critères subjectifs se mesurent à la manière dont il parvient plus ou moins à donner un sens positif à sa situation, et à revendiquer une posture professionnelle dans le cadre du domicile qui tend à invisibiliser l’acte même de travail.
En effet, contrairement au travailleur à domicile de l’ère industrielle qui installait ses machines dans l’espace de la maison (machine à coudre ou à aiguiser les couteaux), le télétravailleur n’a bien souvent que son ordinateur comme outil de travail, ce qui renforce le flou autour des indices de mise au travail. Comment dans ces conditions faire la distinction entre je travaille et je ne travaille pas (ou plus) ? L’enquête a fait apparaître différentes figures du travailleur à distance.
On peut regrouper au sein d’un premier groupe des professionnels qui partagent le fait de subir la distance. Il s’agit dans leur grande majorité de femmes qui dégagent très peu de revenus de leur activité. Cette précarité économique est renforcée par une clôture sur le chez-soi et réciproquement. Le travail se fait sur la table de la cuisine ou du salon et se déroule dans les interstices du temps dégagé des tâches domestiques et parentales. Une enquêtée, graphiste, me dit ainsi, après avoir égrené la liste des tâches domestiques induites par le soin donné à son enfant en bas âge : « bosser je pense que c’est vraiment la dernière chose que je fais après tout ce que j’ai fini de faire… parce que je sais que j’ai besoin d’être dans un rythme où je ne vais pas être quand même arrêtée comme ça ».
J’ai retrouvé surtout ce mode contraint du travail à distance, notamment chez des femmes diplômées qui souffrent d’isolement professionnel et qui vivent le travail à domicile comme une assignation genrée problématique. Il est aussi repérable chez des jeunes qui débutent leur vie professionnelle à distance et qui ne peuvent s’appuyer sur des ressources scolaires (diplômés d’école de second rang) ou sociales (enfants de classes moyennes ou populaires) pour donner sens à une position objectivement et subjectivement subie. En cette période de confinement, on peut faire l’hypothèse que la précarité économique de certaines situations soit accentuée, et que les professionnels déjà fragiles sur le marché de l’emploi ou de l’indépendance soient tellement mis à distance qu’ils en deviennent invisibles.
Le second groupe est constitué de personnes qui cherchent à tracer des frontières claires entre les temps / les espaces travaillés et non-travaillés au sein du domicile. Pour composer avec la distance, ces professionnels se fixent des horaires (« moi je travaille sur un rythme 9h-18h00, du lundi ou vendredi et surtout je m’habille », selon un enquêté, graphiste), travaillent toujours à un endroit fixe (soit dans une pièce séparée, soit dans un espace de bureau loué à l’extérieur). Il s’agit avant tout de « travailler comme un salarié normal » (un enquêté, pigiste), y compris pour des indépendants.
Dans ce cas, la métrique salariale est rassurante car elle replace le travail dans un cadre spatio-temporel socialement partagé. L’effet-frontière doit jouer dans les deux sens : maîtriser les intrusions de la sphère professionnelle dans la sphère privée, et réciproquement. Mais pour pouvoir défendre l’idée même de frontière, il faut avoir une visibilité suffisante sur les engagements professionnels. La stabilisation des revenus permet aussi bien souvent d’habiter des logements plus grands afin de disposer d’un bureau à soi.
Dans la période actuelle marquée par une cohabitation forcée des enfants et des parents, la question du respect des frontières semble bien être un enjeu central pour la plupart des néo-télétravailleurs qui s’ingénient à reproduire à leur domicile le cadre habituel du bureau. Dans un temps devenu élastique, le besoin de rituels et de repères temporels semble encore plus important. Mais l’effet-frontière n’existe pas en soi, il est l’enjeu toujours renouvelé d’une négociation au sein du couple.
Au sein de mon corpus, les hommes semblent surtout chercher à définir des frontières strictes pour mettre à distance les tâches domestiques et parentales et ainsi éviter une potentielle inversion des genres. Cela ne tient qu’à condition que leurs conjointes soient en première ligne. Alors que chez les femmes concernées, la répartition des tâches est généralement plus égalitaire. Dans cette perspective, on peut se demander dans quelle mesure ce type de logiques genrées a présidé aux arbitrages conjugaux au sein des couples bi-télétravailleurs, et s’interroger sur la manière dont ils vont continuer à distribuer les priorités dans les semaines à venir : qui gardera les enfants qui ne retourneront pas à l’école ? Quel sera le travail jugé le plus prioritaire et au nom de quels critères ?, etc.
Défendre la distance comme une autre façon de travailler… et de vivre
L’enquête a fait apparaître un troisième profil concernant des professionnels qui, au contraire, valorisent le fait de travailler à distance dans une critique appuyée du salariat. Revendiquer la distance, c’est alors défendre un autre rapport au temps et à l’espace : le travail est nomade (chez soi, ou, pour les plus jeunes, au café, en bibliothèque, dans un espace de co-working) et ne se déroule pas sur des plages prédéfinies. Si la figure du télétravailleur en pyjama travaillant la nuit agit comme une figure-repoussoir, car elle est associée à un défaut de professionnalisme, ces professionnels revendiquent une liberté retrouvée dans l’organisation de leur temps.
C’est surtout vrai chez les télé-secrétaires qui valorisent le travail au domicile comme ce qui leur permet de sortir d’une condition salariée malheureuse (succession de petits boulots, position dominée dans la ligne hiérarchique), et de revendiquer une articulation heureuse entre l’identité de « femme active » et de « mère ». C’est ainsi, par exemple, que cette enquêtée, secrétaire dont le mari est ouvrier, justifie ses arbitrages temporels : « Je m’organise selon mon emploi du temps… ça peut être je travaille le matin, je la récupère l’après-midi, et pendant la sieste je peux travailler, après jusque-là on a toujours trouvé le bon compromis ». Pour autant, cette liberté gagnée reste souvent conditionnée à une dépendance économique à leur conjoint, car elles dégagent de fait de faibles revenus de leur activité.
On peut également repérer une valorisation du travail à distance chez certains enquêtés plus jeunes, mais qui relève alors davantage du registre de la « critique artiste » du salariat. Cela se traduit par la mobilisation d’une discours qui valorise le « décalage » et « l’incertitude » et l’inscription dans une « vie de bohème » qui permet subjectivement d’investir positivement une position objectivement incertaine.
On repère de façon majoritaire la valorisation d’un tel rapport alternatif au travail chez de jeunes diplômés, issus des classes intellectuelles supérieures et professions libérales, qui peuvent aussi compter sur le soutien parental pour leur assurer un soutien matériel et sécuriser les premières années d’insertion sur le marché de l’emploi. Ce qui est intéressant à rappeler dans ces deux cas limites – celle de la femme active au foyer et du jeune diplômé bohème – c’est que la défense de l’indépendance (en tant que statut) au nom d’un autre rapport au travail et d’une liberté gagnée se traduit souvent par une dépendance économique (au conjoint, aux parents, aux allocations chômage).
Les professionnels qui peuvent défendre une norme alternative au travail tout en occupant une place dominante sur le marché de l’indépendance ne sont finalement qu’une minorité dans le corpus d’enquête. Cela concerne essentiellement des hommes exerçant le métier de graphiste, se définissant comme « créatifs » et habitant dans les quartiers gentrifiés. Définissant avant tout leur travail par sa part créative, ils se refusent à l’enfermer dans un cadre spatio-temporel défini. Il en découle une définition extensive du temps de travail : lire, aller aux expositions, au cinéma… Tout devient travail ou rien ne l’est vraiment. On peut dire qu’ils occupent les marges, jouant précisément de la confusion des temps et des espaces. Le travail est réalisé chez soi ou dans un bureau à l’extérieur (généralement désigné sous le terme « d’atelier »), et peut se dérouler la semaine comme le week-end. Jouissant d’une réputation sur le marché, ils ont une visibilité sur les commandes qui leur permet d’entretenir un rapport confiant dans l’avenir et d’investir de façon positive une vie par projets.
Mais prenons garde à ne pas faire de la figure désirable du créatif la représentation dominante du travailleur à distance sans interroger les conditions sociales de son émergence (ressources scolaires, sociales, résidentielles). Dans la période de grande incertitude économique qui s’ouvre, le risque est grand que les effets de genre se creusent et qu’on observe une clôture sur le chez-soi des plus précaires. Ce constat vaut aussi pour les plus jeunes qui ne disposent pas des ressources sociales pour vivre l’incertitude économique avec l’assurance des héritiers.
La sortie du cadre protecteur du salariat fait en effet reposer sur le travailleur/travailleuse à distance la seule responsabilité de son employabilité et l’exclut, de fait, des mécanismes de redistribution et des protections sociales. De la même manière que le capitalisme a réussi à intégrer la critique dans le renouvellement de ses paradigmes, l’actuelle promotion du travail à distance participe de la reconfiguration du modèle dominant de ce que devrait être la forme enviable du travail, sous forme salariée ou indépendante. Mais il ne faudrait pas que ce qui est présenté comme un bénéfice pour tous, renforce, dans la réalité, les assignations de classe et de genre. La question centrale qui se pose aujourd’hui est de savoir comment peuvent être articulées les aspirations individuelles à penser un rapport renouvelé au travail et l’inscription dans des solidarités collectives.