L’égalité des chances n’est pas toute la justice
Le « vieux » mouvement ouvrier, celui de la société industrielle et du projet socialiste, se battait pour réduire les inégalités de condition, pour que les patrons et les rentiers « rendent » aux travailleurs une partie de la richesse qu’ils leur avaient volée. Il se battait aussi pour les conditions de travail et la dignité des travailleurs, quitte à être peu sensible à la condition des femmes et à celle des immigrés d’abord perçus comme des travailleurs particulièrement exploités.
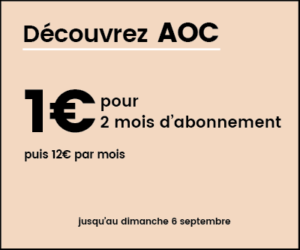
Cette conception de la justice sociale n’a pas entièrement disparu, mais au cours des trois dernières décennies, l’égalité des chances s’est imposée comme notre principal modèle de justice, celui qui fonde la critique des injustices et mobilise le plus fortement les citoyens. Dès lors que nous affirmons être fondamentalement égaux, l’égalité des chances exige que nous puissions accéder à toutes les positions sociales en fonction de notre seul mérite, indépendamment de notre sexe, de notre condition sociale, de notre « race », de notre culture… La société de l’égalité des chances méritocratique ne vise pas l’égalité, mais elle serait une société juste dans laquelle les inégalités seraient incontestables car reposant sur le seul mérite des individus. Comme dans le sport, les inégalités seraient justes au terme d’une compétition équitable entre des concurrents bénéficiant d’une égalité initiale[1].
Ce point de vue est devenu une routine critique mesurant et dénonçant les inégalités des chances : écarts des chances d’atteindre les positions et les biens, la santé, l’éducation, l’influence… On discute moins du rôle du CAC 40 ou des grandes écoles que de la place congrue qu’y occupent les femmes, les minorités, les gens d’origine modeste… La société juste devrait abolir toutes les discriminations et aboutir à une mobilité sociale pure et parfaite, à une société où chacun pourrait faire valoir son mérite. Il va de soi que cette conception de la justice est incontestable, que les discrimination
