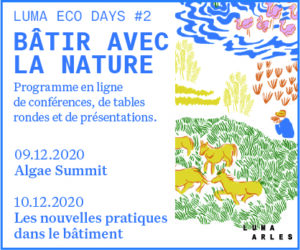L’introuvable débat public français sur le jihad
C’était il y a un mois, le 23 octobre exactement, au Cap-d’Ail, dans les Alpes-Maritimes. Le maire faisait avaliser par le conseil municipal sa volonté de rebaptiser l’école du nom du professeur d’histoire-géographie Samuel Paty. En apparence inoffensive, l’initiative mécontente cependant nombre de parents d’élèves. Pourquoi ? Parce qu’ils craignent que leurs enfants soient désormais une cible. Selon le témoignage recueilli par France Bleu, certains parents ont été jusqu’à « chang(er) leur enfant d’école, ils sont partis dans une autre ville…»
L’anecdote est terrible. Non pas parce qu’elle remet en cause une hypothétique communion nationale autour de Samuel Paty et de la liberté d’expression, mais parce qu’elle témoigne du traumatisme qui gagne la société française. Alors que de nombreuses études ont montré jusqu’ici la capacité de résilience de la population face aux attentats (en particulier le travail du sociologue Gérôme Truc), le sentiment d’effroi ne s’enracine pas moins dans le pays, et c’est justement ce que les jihadistes recherchent. Charlie Hebdo, le Bataclan et Saint-Denis, Nice, Conflans-Sainte-Honorine… La peur progresse au sein d’une population par ailleurs largement abreuvée d’avis d’experts et de contenus de tous types, comme le rappelle une note qui tente d’analyser le rapport de « l’opinion publique » aux attentats de 2015.
Pourtant, à l’échelle nationale, ce traumatisme ne s’accompagne d’aucune décision d’ampleur pour tenter de l’endiguer. Cinq ans après les 110 propositions, pour l’essentiel coercitives, de la commission sénatoriale, aucune initiative nouvelle, aucune convention experte, indépendante, politique et/ou citoyenne n’est chargée d’examiner le phénomène au fond et la manière d’en sortir en formulant des orientations pour les années à venir. Dans le même temps, le débat politique, médiatique, public, non pas sur la liberté d’expression ou l’ « islam radical », mais sur le jihad en tant que tel, ses causes, ses évolutions pas