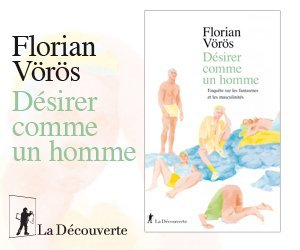Attentats terroristes, une descente dans le maelström
Il y a cinq ans, déjà, que les attentats du 13 novembre ont eu lieu. Et depuis, la liste des attentats perpétrés sur le territoire français n’en finit plus de s’allonger, nous donnant l’impression de glisser inexorablement vers l’abîme. Le sentiment est d’autant plus vif que le débat public à propos de ces attentats est marqué d’une profonde confusion. Les jours qui ont suivi l’assassinat de Samuel Paty l’ont encore montré. Chasse aux « islamo-gauchistes », controverse sur les rayons hallal dans les supermarchés, appel à « profiter » du moment pour faire passer en force une loi déjà retoquée par le Conseil constitutionnel, surenchère de l’extrême droite : rien ne nous est épargné, y compris de la part de membres du gouvernement.
Pourtant, il y a quatre ans tout juste, dans une interview à Mediapart quelques mois avant d’être élu président de la République, Emmanuel Macron se demandait lui-même : « La question, c’est comment on sort de ça ? On en sort d’abord en distinguant les sujets. Bien souvent, dans le débat qu’on a sur l’islam, on confond tout. La folie, c’est qu’on ravive ces débats dès qu’il y a un attentat, ça, il faut quand même le dire et le dénoncer. » Seulement voilà : il y a ce qu’on peut dire au calme, dans les locaux d’un journal parisien, et ce qu’on fait en situation, lorsque l’on se trouve en proie à une nouvelle attaque terroriste…
Les attentats sont des moments d’emballement de la vie sociale, où les émotions prennent le pas sur la raison : les esprits s’échauffent et les sensibilités comme les opinions s’exacerbent. Accentués par les chaînes d’information en continu et les réseaux sociaux, ces moments particulièrement éprouvants sont propices aux dérapages de toutes sortes comme aux instrumentalisations politiques. Idéalement, nous devrions savoir, dans ces moments-là, garder notre sang-froid et agir avec discernement – tout particulièrement lorsque l’on se trouve exercer des responsabilités publiques. Dans les faits, leur terrible répétition nous fait ressembler aux pêcheurs qu’Edgar Allan Poe décrit dans sa nouvelle « Une descente dans le maelström » : dominés par nos affects, incapables du moindre recul, nous n’en finissons pas de fixer le cœur du tourbillon.
En même temps qu’elle nous amène à faire front, l’attaque terroriste accentue donc aussi les tensions au sein de la société.
Dans une conférence inspirée par cette nouvelle, le sociologue allemand Norbert Elias faisait remarquer, au début des années 1980, que les hommes ont encore à accomplir dans le domaine social et politique ce qu’ils ont su réaliser vis-à-vis de la nature[1]. Pendant des siècles, celle-ci nous a inspiré terreur et fascination ; incapables de prendre du recul sur elle, nous ne parvenions pas en maîtriser les dangers tels que les tempêtes ou tremblements de terre, ce qui, en retour, ne faisait que renforcer peur et croyances, jusqu’à ce que le développement du savoir scientifique nous aide à la considérer de manière rationnelle. C’est ce qui nous reste encore en large partie à faire pour les phénomènes sociaux, et en particulier pour un phénomène tel que le terrorisme. Nous ne partons pourtant pas de rien, puisque cela fait une vingtaine d’années que se développent en sciences sociales les connaissances sur les attentats et leurs effets.
S’il est connu qu’un groupe voit généralement sa cohésion se renforcer lorsqu’il est en proie à une attaque (pourvu qu’il bénéficie d’un degré de cohésion minimale avant cette attaque), c’est à l’un des plus grands sociologues américains contemporains, Randal Collins, que l’on doit d’avoir précisé comment ce processus opère à l’échelle d’un pays entier en réaction à une attaque terroriste[2]. À la suite du 11-Septembre, il a pu distinguer différentes phases par lesquelles sont passées les États-Unis au fil des mois, dont une particulièrement importante : une « zone d’hystérie », qui démarre quelque temps après l’attaque, dès lors que, passée la stupeur des premiers instants, la solidarité apparaît à son comble dans le pays, et qui peut durer jusqu’à trois mois, pourvu qu’aucun autre attentat ne vienne relancer le processus.
C’est une période particulièrement dangereuse, où la société apparaît comme à fleur de peau, propice aux passages à l’acte par mimétisme, aux rumeurs et mouvements de panique infondés, aux crimes racistes et bavures policières. C’est très exactement une période de ce genre que nous traversons depuis l’assassinat de Samuel Paty, avec son lot de menaces contre des mosquées, d’intimidations et agressions contre des musulmans, et de nouvelles attaques ou tentatives d’attaque, comme dernièrement à Nice ou à Avignon. En même temps qu’elle nous amène à faire front, l’attaque terroriste accentue donc aussi les tensions au sein de la société : ce sont les deux faces d’un même processus.
Pour l’établir, Randall Collins a toutefois dû faire preuve d’une réactivité peu ordinaire. À peine quatre jours après les attentats du 11-Septembre, il mettait en place avec quelques collègues un protocole d’enquête en plusieurs points des États-Unis afin de collecter des observations et des données de première main. Là est toute la difficulté : il faut pouvoir réagir très vite à l’attaque terroriste en tant que sociologue, et non en tant que simple citoyen choqué, indigné, etc.
C’est tout sauf évident. Stéphane Beaud en témoigne par exemple dans La France des Belhoumi à propos de l’attentat contre la rédaction de Charlie Hebdo : « Je n’hésite pas à avouer que j’ai été moi-même “pris” par l’événement et que j’ai ressenti moi aussi un énorme choc, une très grande tristesse […]. Bref, il m’a fallu un certain temps pour me “ressaisir”, revenir à mon métier de sociologue, m’efforcer de raccrocher la “grande Histoire” (les attentats) et la “petite histoire” (celle de la famille Belhoumi), le macro et le micro, etc. C’est-à-dire enquêter à nouveau auprès des membres de la fratrie[3]. »
Plus récemment, Loïc Le Pape expliquait aussi comment il s’y était pris, dès le lundi suivant l’assassinat de Samuel Paty, pour dépasser sa propre sidération, de manière à pouvoir aborder l’événement avec ses étudiants et leur donner les moyens de le mettre en perspective grâce à un certain nombre de travaux en sciences sociales et science politique. Trop souvent en pareilles circonstances, on voit au contraire des universitaires oublier purement et simplement leur métier, généraliser à partir de leur propre point de vue sur l’événement, et se jeter ainsi tête baissée dans un débat public hystérisé, où leur parole vient se mêler à celles d’éditorialistes et d’autres personnalités publiques avec si peu de plus-value, là où on attendrait d’eux qu’ils apportent plus de distance.
Il faut rappeler avec force que c’est précisément le geste de l’enquête qui permet au chercheur de prendre du recul sur lui-même et son propre rapport à l’événement.
Ce qui marque une différence fondamentale entre de simples commentaires sur l’événement, tels ceux d’éditorialistes, et un éclairage scientifique, c’est le détour par l’enquête. Contre ceux qui se plaisent à faire croire que la sociologie pourrait s’en passer, et se concevoir comme une opération purement théorique et critique, critique parce que théorique, il faut rappeler avec force que c’est précisément le geste de l’enquête qui permet au chercheur de prendre du recul sur lui-même et son propre rapport à l’événement, d’interroger ses prénotions et premières impressions, d’objectiver en somme la situation.
Tout le problème est toutefois que ce détour, lorsque survient un attentat, implique une discordance des temps, entre celui de l’événement, régi par l’urgence et l’immédiateté, et celui de l’enquête, de la production d’un savoir scientifique, qui engage une temporalité plus longue. Quand ceux qui prennent le temps d’enquêter auraient des choses intéressantes à nous dire, il y a déjà longtemps que nous sommes passés à autre chose, et quand l’événement est là, que nous sommes pris dans sa spirale, ceux qui le commentent n’ont généralement pas eu le temps d’enquêter. Sauf lorsque, comme en France aujourd’hui, les attaques se répètent, conduisant à un télescopage des deux temporalités, les résultats d’enquêtes sur des attentats antérieurs se retrouvant en position d’éclairer l’actualité.
Au lendemain des attentats du 13 novembre 2015, le CNRS lançait un appel à projets inédit, « Attentats-recherche », grâce auquel ont été soutenus une soixantaine de projets de recherche, dont quelques-uns portant spécifiquement sur les événements terroristes en eux-mêmes et leurs répercussions. D’autres furent aussi lancés en marge de cet appel. Cinq ans plus tard, les résultats qui en sont issus pourraient être utiles pour faire face à la nouvelle série d’attaques que nous subissons, ainsi qu’en témoigne un livre comme Face aux attentats[4]. Cet ouvrage collectif invite en effet à nous déprendre d’un certain nombre d’idées reçues qui contribuent à alimenter le maelström.
Étant donné que l’être humain serait « par nature » égoïste, on pense par exemple que la réaction de ceux qui sont directement en proie à une attaque terroriste se résume à « sauve qui peut » et « chacun pour soi ». Or les rescapés du Bataclan interrogés par Guillaume Dezecache et ses collègues leur ont au contraire expliqué avoir eu eux-mêmes ou observé chez d’autres des gestes d’entraide ou de coopération durant l’attentat. Certains, au lieu de faire complètement le mort pour éviter de se faire tirer dessus ont par exemple pris le risque de prendre la main de quelqu’un de blessé à côté d’eux pour le réconforter – ce qui peut avoir du sens du point de vue d’une stratégie de survie. Et ce n’est pas la première fois qu’on l’établit : des études sur le World Trade Center le 11 septembre 2001 ou le métro de Londres le 7 juillet 2005 avaient déjà mis en évidence cette réalité.
Une autre idée reçue est que les attentats islamistes feraient nécessairement le jeu de l’extrême droite. Certes, la zone d’hystérie est propice à une recrudescence des crimes racistes et des agressions islamophobes, en même temps que ces événements offrent aux partisans d’extrême-droite une « fenêtre d’opportunité » pour faire avancer leurs idées. On ne peut nier que leurs prises de parole sont de plus en plus visibles sur les réseaux sociaux, comme sur certains plateaux télévisés, où elles génèrent des clashs et alimentent le buzz.
Bénéficiant ainsi de ce que Christopher Bail appelle l’« effet de marge[5] », ces discours tendent à gagner le cœur de l’attention médiatique, alors qu’ils restent en réalité très minoritaires. De fait, malgré les coups de butoirs de l’extrême droite à chaque nouvel attentat, il n’y a pas aujourd’hui en France d’émeutes anti-musulmans comme il y avait des émeutes anti-Italiens en réaction aux attentats anarchistes à la fin du XIXe siècle…
C’est que, comme le montre Vincent Tiberj, ce qu’on observe plutôt dans notre pays depuis les années 1990, en dépit des attentats, est une progression de la tolérance, liée au renouvellement des générations. Et pourvu donc qu’on ne les incite pas sciemment à tout mélanger, les Français savent « faire la part des choses » : après les attentats de janvier 2015, le Pew Research Center avait mesuré que leur opinion vis-à-vis des musulmans s’était améliorée, comme cela avait aussi été le cas, du reste, pour les Américains après le 11-Septembre…
La médiatisation des attaques terroristes en Occident fait depuis les années 1990 une place grandissante aux victimes et aux réactions de la société civile.
Les mots qu’emploient les responsables politiques et les journalistes pour mettre en récit un attentat sitôt qu’il survient sont déterminants. Leur responsabilité est immense. Car, cela paraîtra peut-être évident formulé ainsi, mais on l’oublie en réalité trop souvent : ce à quoi nous réagissons lorsque nous réagissons à un attentat, au-delà de ceux qui en sont directement victimes et témoins, est ce que nous en percevons au travers des médias. L’assassinat de Samuel Paty n’aurait sans doute pas suscité les mêmes réactions si l’image de sa tête décapitée n’avait pas autant circulé sur les réseaux sociaux dans les instants qui ont suivi…
Plusieurs travaux relevant des media studies, en particulier ceux d’Isabelle Garcin-Marrou, ont bien établi que la médiatisation des attaques terroristes en Occident fait depuis les années 1990 une place grandissante aux victimes et aux réactions de la société civile. Symptomatique de cette évolution sont les mémoriaux éphémères qui se forment en hommage aux victimes sur les lieux d’attentats, devenus si présents dans le traitement médiatique des événements terroristes. Ces assemblages de fleurs, bougies, objets divers et bouts de papier sont, certes, médiagéniques. Mais ils servent, d’abord, à panser la plaie. Se pourraient-ils qu’ils nous aident aussi à penser ?
Dans Les mémoriaux du 13 novembre, un autre ouvrage collectif conçu en partenariat avec les Archives de Paris[6], on verra qu’il en va en fin de compte de ces mémoriaux comme de bien d’autres phénomènes sociaux : il y a ce qu’on en dit, et ce qu’ils disent par eux-mêmes. On croit généralement qu’il s’agit d’espaces consensuels, on moque les bougies et les « nounours », quand ils sont en réalité porteurs d’une charge politique et critique. Outre qu’on y trouve des mots adressés non pas seulement aux victimes, mais aussi aux terroristes et dirigeants politiques, ils interpellent les passants et, autour d’eux, se nouent de forts rapports de concitoyenneté.
Et alors qu’on s’imagine aussi que le fait de se sentir concerné par un attentat procède de la simple activation d’un sentiment d’appartenance au pays frappé – comment un Français pourrait-il être indifférent au 13 novembre ? –, les messages collectés dans ces mémoriaux montrent que c’est en réalité un sentiment de plus ou moins grande proximité vis-à-vis des victimes qui est en jeu, et que le partage d’une même nationalité n’en est qu’un facteur parmi d’autres.
Il y a par exemple aussi le fait de connaître personnellement les lieux frappés, d’habiter ou d’avoir habité à proximité, de connaître ou pas des gens dans la ville en question, d’avoir le même âge ou le même profil sociologique que les victimes, etc. Certains ont ainsi réagi au 13 novembre en tant qu’amateurs de rock, parents ou musulmans, plutôt que simplement en tant que Français. Il importe, je crois, de le savoir : cela aide à distinguer la charge normative des injonctions à se sentir « tous » concernés de la réalité du processus sociologique qui fait que certains se sentent toujours davantage touchés que d’autres – et que c’est tout à fait normal. On évite ainsi d’ajouter du mal au mal, d’attiser des tensions, en culpabilisant inutilement certains de nos concitoyens dont on pourrait juger qu’ils ne sont pas assez – ou trop – émus.
« Ne pas rire, ne pas déplorer, ne pas détester, mais comprendre », disait Spinoza. C’est plus que jamais ce qu’il nous faut faire après un attentat, et a fortiori quand les attentats se répètent, pour pouvoir rester soudés et clairvoyants. C’est pour cela que nous avons besoin de sciences sociales. Et c’est pour cela que nous avons besoin de collecter le contenu des mémoriaux éphémères, source unique pour comprendre ce qui nous arrive dans ces moments-là et comment nous y faisons face.
Madrid, Londres, Oslo, Boston, Bruxelles, Manchester, Barcelone : de plus en plus de villes frappées par des attentats l’ont compris et constitué de ce fait des fonds semblables à celui créé par les Archives de Paris après le 13 novembre 2015. Ces fonds pourront servir demain à écrire l’histoire de ces événements. Mais ils nous sont déjà utiles hic et nunc, pour approfondir notre connaissance des situations post-attentats, et espérer pouvoir ainsi nous sortir du maelström dans lequel, à force de se répéter, ces situations menacent de nous entraîner.