Patriarcapitalisme : ce que le Covid-19 fait au travail des femmes
Un plan de sauvetage de 1,9 trillion de dollars. Suivi d’un plan de relance de 4 trillions de dollars. Voilà la réponse de l’administration Biden à la récession économique causée par la pandémie de COVID 19. Aux grands maux, les grands remèdes. De nombreux économistes et commentateurs ont salué ce plan qui « marque un changement d’époque » et fait la preuve d’une « présidence révolutionnaire ». À de nombreux égards, sans doute est-ce le cas. Mais pas à tous.
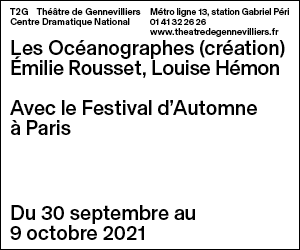
La récession due à la COVID 19 n’est pas une récession classique. Pour la première fois, c’est une récession qui affecte principalement les femmes. Les femmes étaient en effet en première ligne des secteurs les plus affectés par la pandémie et les confinements : les secteurs de service à la personne, la restauration et l’hôtellerie, les arts. Ceci contraste avec les récessions classiques de ces dernières décennies (et même toutes les récessions depuis 1948) qui affectèrent des secteurs traditionnellement masculins, au premier rang desquels les secteurs manufacturiers exposés à la compétition de main d’œuvre à bas coût dans les pays en développement. Cet impact disproportionné, et unique dans l’histoire des récessions, sur le travail des femmes a amené les économistes à parler de « fémi-cession ».
La taille du choc est aussi sans précèdent. Par exemple, aux États-Unis, le taux de chômage des femmes a augmenté trois fois plus que celui des hommes en 2020. Lors de la « Grande Récession » de 2009, l’exemple classique d’une « mascu-cession », le taux de chômage des hommes, principales victimes de la baisse d’activité dans les secteurs manufacturiers et de la construction, n’avait augmenté « que » deux fois plus que celui des femmes. Comme l’écrivent les économistes Titan Alon, Matthias Doepke, Jane Olmstead-Rumsey et Michèle Tertilt; « jamais aucune récession n’a affecté à ce point un sexe plus que l’autre ».
Et je ne parle ici que du chômage. Je ne parle même pas de la charge familiale qui augmenta jusqu’à un point intenable pour les mères de famille. Ni de la violence domestique qui augmenta de 30% en France la seule première semaine du premier confinement, et jusqu’à 50% dans les zones péri-urbaines du Pakistan où mes co-autrices et moi avons mené une enquête en juillet 2020.
Cependant, qui furent les premiers à reprendre le chemin du bureau lors du retour du travail en présentiel ? Qui profita majoritairement des plans de relance et de la reprise de la croissance ? Pas les femmes, non. Par exemple, ce plan de sauvetage et de relance « révolutionnaire » américain est, encore et toujours, un plan de relance qui privilégie les industries masculines. Si l’on décompose 1,5 milliard du plan de sauvetage [1] entre les différentes industries visées et que l’on tient compte de la proportion de femmes et d’hommes dans chaque industrie, on constate que pour chaque dollar dépensé pour une employée femme, 1,42 dollar est dépensé pour un homme.
Pour les 2,3 milliards du plan d’infrastructure, ce ratio est de presque 3 pour 1. Pour le American Families Plan, la tendance est inverse avec un ratio favorisant les femmes (0,18), puisque ce plan vise l’éducation et la petite enfance. Mais au total, si l’on considère ces trois plans ensemble, on constate que pour chaque dollar pour une femme, un homme en touchera 1,46 (bien sûr, beaucoup dépendra de l’évolution de l’emploi dans ces secteurs, nous y reviendrons).
En France, même histoire. Même si la récession y fut moins injuste pour les femmes qu’aux États-Unis, notamment grâce aux mesures d’indemnisation de chômage partiel qui permit aux femmes de conserver leurs emplois ainsi qu’au maintien des crèches et écoles en présentiel, le plan de relance privilégie, encore et toujours, les industries masculines. 6 milliards y sont alloués à la santé (qui emploie 70% de femmes), contre 8,2 milliards à l’aéronautique (42% de femmes), hydrogène, nucléaire (environ 20% femmes dans le secteur de l’énergie) et automobile (où elles sont moins de 40%). 6,7 milliards iront à la « rénovation écologique » (c’est-à-dire le secteur du bâtiment, où les femmes représentent 12% des effectifs). En Australie, c’est encore pire. La mesure phare (et très coûteuse) du plan de relance en 2020 était une subvention de 15 000 à 25 000 dollars (9 500 à 16 000 euros) pour des travaux de rénovation (verts ou non). Soit une aide directe non seulement au secteur (masculin) du bâtiment mais aussi aux ménages les plus riches, propriétaires de leur maison.
Pourquoi ces plans de relance favorisent-ils l’emploi masculin ? Pourquoi ressemblent-ils autant à tous les plans de relance précédents, qui ont tous traditionnellement privilégié les secteurs masculins, alors même que l’on fait face à une récession unique, qui a entrainé une aggravation sans précèdent des inégalités femmes-hommes ? Et derrière cette question, pourquoi existe-t-il encore de tels déséquilibres sur le marché de l’emploi, qui nous amène à caractériser si aisément, dans les données ainsi que dans nos esprits, métiers féminins et masculins ? Et quels enseignements pouvons-nous tirer du passé pour prévoir l’évolution de l’emploi dans ces métiers, au fur et à mesure qu’ils bénéficieront plus ou moins des plans de relance ou même du progrès technologique ?
Je me penche sur ces questions dans Patriarcapitalisme, un ouvrage qui paraît ces jours-ci, fruit de plus de 10 ans de recherche sur les inégalités économiques entre les femmes et les hommes et sur leurs origines. Par ce néologisme, je caractérise la façon dont les normes culturelles produisent, émanent, et justifient les inégalités économiques entre les femmes et les hommes. Ces normes déterminent en effet le choix de métier, l’évolution des heures de travail et des rémunérations, ainsi que le statut même associé à un métier (qui, en retour, en influence la rémunération). Et je me penche sur leurs origines dans le temps long et leur persistance au fil des générations.
Il n’y a plus à l’heure actuelle tant de discrimination et d’écart salarial entre les femmes et les hommes à métier égal que de discrimination et d’écart salarial entre les mères et tous les autres.
Dans un premier temps de cet ouvrage, je décris l’évolution des inégalités femme homme dans l’économie au cours du XXe siècle. Je passe en revue la façon dont les grands évènements et les grandes innovations du XXe siècle, de la Première Guerre mondiale à l’invention de la pilule, ont fait évoluer le travail des femmes, leur éducation, et leurs emplois. Jusqu’à l’arrêt relatif de ces progrès vers le milieu des années 1980.
Puis, je me tourne vers les explications traditionnelles proposées par les chercheuses et chercheurs en sciences sociales, et basées sur la spécialisation économique au sein du couple, l’éducation, ou encore l’expérience professionnelle pour expliquer les changements observés au cours du XXe siècle. Si ces arguments parviennent à éclaircir les évolutions observées dans les années 1960 et 1970, ils ne parviennent pas à expliquer les inégalités qui demeurent entre les femmes et les hommes à la fin du XXe siècle. En particulier, depuis les années 1980, les femmes sont plus éduquées que les hommes, et elles les ont presque rattrapés en années d’expérience.
Quelles explications dès lors ? Certains ont mis en avant de soi-disantes différences psychologiques entre les femmes et les hommes ; d’autres, le fait que les femmes n’auraient pas les mêmes préférences relatives pour la vie familiale et le travail. Or, aucune de ces explications n’est satisfaisante. Ces différences supposées sont en effet sans doute plus le produit des inégalités économiques et politiques entre les femmes et les hommes qu’elles n’en constituent une explication.
La plupart des inégalités restantes entre les femmes et les hommes s’expliquent désormais par des différences systématiques en termes de choix de métier et d’industries, différences qui sont elles-même largement bornées par des injonctions à satisfaire des identités de genre et dictées par des considérations sociales de qualités naturelles supposées féminines ou masculines. Aux femmes douces l’enseignement et le soin. Aux hommes compétitifs et dominateurs la direction des entreprises.
Or, de façon systématique, la perception sociétale des métiers dits « féminins » est dévalorisée, quand bien même ceux-ci étaient peu de temps auparavant des métiers « masculins » – et donc prestigieux. J’expose aussi à l’aide de données chiffrées et de comparaisons internationales à quel point les normes sociales et la plus grande prise en charge (c’est un pléonasme) du soin des enfants au sein du ménage heurtent la carrière professionnelle des femmes.
Ainsi, il n’y a plus à l’heure actuelle tant de discrimination et d’écart salarial entre les femmes et les hommes – à métier égal notons-le bien, tout en gardant en tête que les femmes restent surreprésentées dans les métiers les plus précaires – que de discrimination et d’écart salarial entre les mères et tous les autres. Et non seulement uniquement les mères, mais les mères dans les couples hétérosexuels. Les mères dans les couples homosexuels, elles, subissent une perte de revenu non seulement plus faible, mais de bien plus courte durée. Les salaires des mères biologiques dans les couples homosexuels rattraperont celui de leurs partenaires au bout de deux ans. Les salaires des mères, biologiques aussi bien qu’adoptives, dans les couples hétérosexuels ne rattraperont jamais, en moyenne, celui des pères.
Mais si ces normes culturelles et ces identités de genre déterminent à ce point les inégalités économiques, d’où viennent-elles ? Et comment peuvent-elles changer ? C’est ce que j’expose dans la troisième partie de l’ouvrage, qui nous emmène des forêts d’Amazonie jusqu’à l’Arabie Saoudite, en passant par l’Australie coloniale afin d’étudier l’origine et l’évolution des normes culturelles de genre.
La plus « biologique » sera la justification de la domination, la plus acceptable cette domination sera.
Je rappelle en particulier le désastre qu’a représenté pour les femmes l’invention et surtout l’intensification de l’agriculture qui, en dégageant un surplus, a permis l’accumulation et donné naissance à la propriété privée, devenant ainsi la matrice des inégalités économiques et en particulier des inégalités entre les femmes et les hommes et de l’asservissement des femmes à la production domestique. J’utilise ces exemples et ces contextes pour montrer également que les normes de genre ne contraignent pas uniquement les femmes. Les hommes, eux-aussi, sont entravés par des normes de masculinité qui exacerbent trop souvent la violence, le mal-être, et ce jusqu’au suicide.
Cette perspective de temps long permet de mettre clairement en évidence les mécanismes de domination. Plus il y a de richesses et de surplus, plus les puissants cherchent à se les accaparer. Les inégalités ainsi créées sont potentiellement dangereuses ; les dominé(e)s, exclu(e)s des richesses, risquent de se rebeller. Ainsi, les riches dominants doivent mettre en place un système de valeur qui sécurise leur position en la justifiant. La plus « biologique » sera la justification de la domination, la plus acceptable cette domination sera.
Au Moyen Âge, les femmes sont possédées par le diable, elles sont des sorcières ; au XIXe siècle, elles n’ont pas les mêmes facultés intellectuelles que les hommes et sont faibles par nature ; au XXe et XXIe, elles ne sont pas aussi compétitives et résistantes au risque, elles ont des préférences différentes pour la famille et le travail. Cette même logique s’applique bien sûr à toutes les logiques de domination, pas seulement sexuelle, mais aussi raciale, nationale, ou même envers les minorités sexuelles (leur principal défaut selon cette logique étant en effet de contrevenir à une définition biologique du genre et de la sexualité).
C’est en effet un des grands enseignements que mon ouvrage met en avant : inégalité, domination, et idéologie sont intimement liées. L’une ne va pas sans les autres. Les dominants se construisent sur et profitent des inégalités. Ils produisent, de par leur accès privilégié au savoir, et défendent, de par leur accès privilégié au pouvoir, une idéologie afin de justifier de leur domination auprès des dominés mais aussi à leurs propres yeux. On valorise systématiquement l’emploi masculin. Et l’on en fait profiter des plans de relance. Ce qui aggrave encore les inégalités…
Alors : que faire ? La mise en évidence de l’ancrage et de la persistance dans le temps long de normes culturelles générant et justifiant les inégalités peut apparaître comme un aveu d’impuissance à les corriger. Certains m’accuseront d’adopter une vision déterministe de l’histoire. Mais c’est tout le contraire ! Si l’introduction de la charrue ou les déséquilibres démographiques liés aux guerres mondiales ou à la colonisation les ont influencées durablement, les normes sociales peuvent tout aussi bien changer sous l’impulsion de grandes évolutions économiques ou culturelles contemporaines.
L’obstacle majeur au changement culturel des normes de genre réside dans les difficultés à dévier d’un équilibre collectif, d’un point de référence commun, du plus petit dénominateur de la réflexion. Ainsi, l’information peut être le moteur de changements significatifs. Ce qui m’amène à être optimiste quant aux conséquences à long terme de mouvements sociaux tels que #MeToo et #MeTooIncest. Aujourd’hui, nous nous rendons tous compte collectivement de l’étendue et des répercussions de la violence et de la domination masculine, de la famille jusqu’aux grandes entreprises ; je pense que cette prise de conscience aura des implications irréversibles. Ce qui était encore acceptable il y a dix ou vingt ans ne l’est plus aujourd’hui. Pour reprendre le slogan Hollywoodien : Time’s Up.
Ce qui m’amène, enfin, à passer en revue l’efficacité des politiques publiques et privées, depuis les politiques familiales jusqu’à l’instauration des quotas en entreprise et en politique, pour remédier à ces inégalités. J’y propose des solutions concrètes, notamment l’instauration de quotas qui ne concerneraient pas seulement les plus hauts postes, la formation et l’éducation pour lutter contre le harcèlement, et la mise en place d’une comptabilité précise de l’égalité. Parce que l’on comprendra qu’il est futile d’attendre un changement social organique. L’invocation au changement social et le refus conséquent d’intervenir par la législation sont d’ailleurs des positions généralement tenues par les segments les plus conservateurs de la société, ceux qui bénéficient le plus des inégalités en place.
J’invite aussi à réfléchir sur ce que les femmes blanches, dans les pays occidentaux, industrialisés et démocratiques vont faire des progrès dont elles ont bénéficié au cours du XXe siècle (bien que des inégalités demeurent toujours !). Les utiliser et à leur tour profiter de la domination des femmes racialisées, des travailleurs dans les pays en développement, et à leur tour justifier une idéologie patriarcapitaliste 2.0 ? Comme ces femmes dont l’arrivée aux conseils de direction sous l’effet des quotas ne bénéficie en rien aux autres employées de l’entreprise ? C’est le piège. Et bien sûr ce piège est d’autant plus fort que les inégalités ne font que se creuser. C’est en partie pour ça qu’il n’y a pas grand-chose à attendre de la seule arrivée des femmes aux plus hauts postes à responsabilité. De là-haut, le fossé est trop grand, le fauteuil trop confortable. Ainsi, l’évolution des inégalités de genre est intimement liée à l’évolution des inégalités économiques tout court. Ce qui renforce encore le besoin impératif de les corriger.
NDLR : Patriarcapitalisme. En finir avec les inégalités femmes-hommes vient de paraître aux éditions du Seuil.
