Covid-19 : encadrer la crise
Nous sommes en crise. C’est l’évidence même : une pandémie mondiale a frappé l’espèce humaine et nous traversons une crise. Mais qu’en est-il vraiment ? Que le Covid-19 soit une crise, cela semble incontestable. Or, que signifie cette affirmation ? On peut renverser la question : comment qualifier autrement une pandémie mondiale qu’en ayant recours à la notion de crise ? Après tout, des vies humaines sont en jeu. En effet, le fait de qualifier un événement ou une situation en utilisant le terme de crise relève d’un simple acte sémantique, ou d’un acte verbal. Et l’affirmation « cette chose est une crise » semble sémantiquement justifiée dans le cas d’une pandémie humaine mondiale.
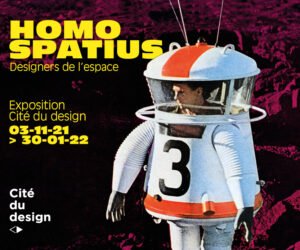
Cependant, « c’est une crise » n’est pas une simple observation empirique qui peut être exprimée sans problème par un acte sémantique. Au contraire, « c’est une crise » est une observation logique – c’est un énoncé. Et c’est, en outre, un énoncé qui doit être appréhendé sur le plan conceptuel. Je m’explique.
Commençons par une observation empirique : virus. Observation fondée sur une distinction : virus/non virus. Il s’agit d’une observation de premier ordre. Un virus ne peut être connu (observé) que sur la base de distinctions qui déterminent ce qu’il n’est pas. Voici une autre observation possible : virus présent. Cela signifie que je suis, ou ne suis pas, en présence d’un virus. Il s’agit d’une observation de second ordre fondée sur l’observation de premier ordre « virus/non virus ». En partant de là, l’énoncé « le fait d’être en présence d’un virus est une crise » est une observation de portée conceptuelle.
En d’autres termes, l’observation empirique « virus » est différente de l’affirmation conceptuelle « le virus est une crise ». Un virus ne se présente pas naturellement comme une crise. Déclarer que le virus est une crise qualifie l’observation empirique. Par conséquent, nous introduisons une observation empirique dans la sphère conceptuelle. Le concept de crise est donc fondamental pour la pratique qui consiste à cadrer la maladie comme événement intelligible et historique.
Pourquoi cela importe-t-il ? Après tout, se retrouver en présence d’un virus n’est pas une bonne chose. Il importe que nous admettions que la crise est un énoncé car, en tant que proposition, elle constitue notre principal moyen de qualifier le monde observable, de qualifier une situation, de qualifier l’histoire.
Notre monde contemporain semble se définir, fondamentalement, par une situation de crises prolongées, dont chacune repose sur des observations empiriques. Par exemple, nous avons une crise sanitaire mondiale, qui correspond à l’observation empirique « virus », ou « SARS-CoV-2 », ou « Covid-19 ». Nous avons une crise environnementale, qui correspond à l’observation empirique « incendies », « inondations » ou températures océaniques plus élevées. Nous avons une crise socio-économique, qui correspond à des représentations statistiques, telles que la répartition des revenus et les inégalités de richesse.
Nous menons des recherches sur ces crises afin de mieux les comprendre et, si possible, les corriger. Par exemple, lorsqu’il est établi qu’il y a une crise financière, comme en 2007, les chercheurs et les journalistes d’investigation cherchent à décrire l’impact de la crise sur diverses populations. Nous avons ensuite des publications (essentiellement post hoc) sur l’impact de la crise financière sur les gens.
Or, une approche très différente consisterait à poser d’abord des questions constitutives sur le concept de crise. Par exemple : quelle est la chose, précisément, qui est identifiée comme étant en crise ? À quel moment déclare-t-on qu’il y a crise, et pourquoi à ce moment précis plutôt qu’à un autre ? Crise pour qui ? Qui ou quoi en est à l’origine ? Car en fin de compte, lorsque la crise est déclarée, si certaines questions sont permises, d’autres sont exclues.
La question primordiale est donc la suivante : qu’est-ce qui est en jeu lorsque nous déclarons qu’il y a crise ? En d’autres termes, quels sont les effets de cet énoncé ? Il s’agit d’une interrogation importante car elle nous oblige à expliciter les hypothèses qui structurent et informent nos efforts pour résoudre la crise, ou bien notre manière de problématiser quelque chose en tant que crise.
Résoudre la crise suppose que nous soyons tous d’accord sur ce qui est, exactement, en crise et pour qui. Cela signifie que nous considérons sérieusement les effets tangibles du concept lui-même sur la formulation des affirmations de vérité. Dans le cas du Covid-19, c’est là une chose dont il faut tenir compte.
La production « obsessionnelle » de données dans le système de santé américain ne s’est pas traduite par des données exploitables contre la pandémie.
Aujourd’hui, la crise signifie une pandémie sanitaire mondiale. Rien ne peut sembler plus naturel : la crise ultime pour les humains est de ne pas avoir de défense immunitaire face à un virus. C’est littéralement une crise existentielle. Or, nous avons bel et bien une défense contre le SARS-CoV-2, et c’est ainsi que nous avons développé un vaccin. Donc, si la pandémie mondiale n’est pas une crise existentielle qui menace l’existence de l’espèce humaine, de quel type de crise s’agit-il ?
La réponse la plus évidente est que le Covid-19 est une crise de santé publique : les humains n’étaient pas préparés à se défendre contre cet intrus biologique exceptionnellement virulent et transmissible.
Mais comme l’ont montré les anthropologues Andrew Lakoff et Stephen Collier, nous étions, en réalité, préparés. Les recherches de Lakoff, en particulier, nous aident à mieux comprendre la consolidation de ce qu’il appelle « l’assemblage de la sécurité sanitaire mondiale ». Lakoff retrace l’émergence de la notion même d’« état de préparation » (preparedness) en tant que stratégie publique aux États-Unis, qui impliquait la consolidation de formes de connaissances et de pratiques issues de domaines très divers, dont la sécurité civile, la gestion des catastrophes, et la santé publique internationale.
Lakoff analyse également l’évolution et les déplacements de ce qui constitue une maladie émergente depuis la fin des années 1980, lorsque la pandémie de VIH/SIDA a mis fin à la croyance selon laquelle les maladies infectieuses seraient contenues par des mesures de santé publique. À cette époque, les agences de biosécurité avaient conclu – n’oublions pas, c’était il y a quarante ans – que notre écologie mondiale future connaîtrait l’émergence continue de nouvelles maladies pour lesquelles nous n’avons aucune immunité existante.
À la fin des années 1990, la US Bio-Defense Initiative s’est préparée contre une éventuelle attaque bio-terroriste (notamment d’anthrax). En outre, comme le documente Lakoff dans un essai important sur la mise en place de la « virologie expérimentale » au sein d’une stratégie de préparation à la pandémie, le financement de la recherche fondamentale est également significatif, passant de 15 millions de dollars en 2001 à 212 millions de dollars en 2007. Le résultat a été la mise en place de tout un dispositif mondial de biosécurité.
Ce dispositif ne s’est-il pas appliqué au virus du Covid-19 ? Le virus du Covid-19 a-t-il, d’une manière ou d’une autre, rendu le dispositif national de biosécurité mondiale des États-Unis inefficace ou obsolète ? Le Covid-19 est-il un virus ou un mode d’infection radicalement différent ?
Si la science avait échoué, nous n’aurions pas été en mesure de séquencer le génome du Covid-19 ou de développer un vaccin. Ce type d’échec aurait représenté une crise épistémologique, c’est-à-dire qu’il nous aurait mis face à l’incapacité des formes de connaissance existantes à appréhender et à représenter les phénomènes, à rendre compte des événements et des expériences que nous avons en commun. Il n’y a pas eu, heureusement, de crise épistémologique.
En revanche, les défis en matière de gestion et de compétence ont été innombrables. Par exemple, étant donné l’existence d’une préparation à la pandémie, il est extrêmement difficile de comprendre pourquoi il n’existait pas de système normalisé pour gérer une pandémie. Le compte rendu du magazine The Atlantic intitulé « Why the Pandemic Experts Failed » (pourquoi les experts en pandémie ont échoué) décrit comment l’initiative de ce magazine – le Covid Tracking Project – est devenue une source cruciale de données sur la pandémie pour le gouvernement américain, et ce en raison de l’absence totale de paramètres normalisés et d’un système national standardisé concernant les tests de dépistage, ainsi que de l’incapacité de ce même gouvernement à recenser les données relatives aux tests, aux hospitalisations, aux taux de positivité et au nombre de décès.
Il ne s’agissait pas seulement d’un manque de ressources administratives aux niveaux national et fédéral. Le Covid Tracking Project, lancé par deux journalistes du Atlantic en collaboration avec un spécialiste des données et des équipes de volontaires, témoigne de ce manque de capacité et montre à quel point la production « obsessionnelle » de données au sein du système national de santé américain ne s’est pas traduite par des données exploitables pour une gestion efficace en matière de santé publique.
Il importe de prendre en compte les pratiques qui constituent la crise au lieu de la naturaliser.
Comme aux États-Unis, en France et, plus largement, en Europe, des dispositifs gouvernementaux de gestion de pandémie aiguë ont été mis en place au cours des dernières décennies. Mais même en France, où la qualité des infrastructures publiques dépasse de loin celle des États-Unis, les enjeux en matière de gestion et de compétence ont miné la capacité de préparation à la pandémie.
Cette situation a été qualifiée de « crise organisationnelle », qualification qui figure en sous-titre d’une enquête pointue en temps réel consacrée aux processus décisionnels de la bureaucratie française dans le feu de l’action pandémique. Les auteurs montrent comment la nature du régime au pouvoir a structuré la réponse à une urgence publique : en France, des grèves prolongées et généralisées contre des projets de réforme ont façonné la stratégie du gouvernement Macron, une stratégie qui s’est alors écartée du plan de préparation pour une pandémie grippale.
De même, la fragmentation bureaucratique (la constitution de comités ad hoc, le défi que représente la « coordination de la coordination » entre les agences et les instances consultatives nouvellement créées) ainsi que la dérive organisationnelle ont conduit à des interventions particulières face à la pandémie – ou à leur absence. En d’autres termes, la dynamique institutionnelle a généré une crise particulière, ainsi que des pratiques singulières de gestion du Covid-19. Il importe de prendre en compte ces pratiques, qui constituent la crise, au lieu de simplement naturaliser la crise comme une chose qui existe en dehors des relations sociopolitiques et des institutions.
Mais surtout, comme le montrent les auteurs de cette enquête, Henri Bergeron, Olivier Borraz, Patrick Castel et François Dedieu, en Europe (comme aux États-Unis et ailleurs, par exemple en Australie), la préparation au risque de pandémie est passée au second plan, derrière la focalisation sur le risque terroriste. Cette focalisation s’inscrit dans un régime normatif existant qui place les questions géopolitiques, y compris les questions relatives aux migrants, aux réfugiés et à l’immigration, au-dessus des questions de santé et de bien-être. Plus important encore, cette focalisation renvoie à la question essentielle de savoir ce qui est en jeu lorsque l’on déclare qu’il y a crise (« ceci est une crise »).
Nous avons choisi le « point de vue de la contamination » plutôt que le « point de vue de la configuration ».
Le cadrage importe. Le cadre définit la frontière entre ce qui est inclus et exclu, et, partant, délimite les cibles de l’intervention et les limites de la connaissance. Cadrer la crise, et donc formuler les questions qui informent la gestion de la crise, se fait à de nombreux niveaux. Il y a les cadrages géopolitiques, mentionnés ci-dessus, qui sont informés par les normes relatives à ce qui constitue la « sécurité humaine ». Il existe également des méthodes de modélisation et de représentation, qui reposent aussi sur des hypothèses concernant la vie normative, l’intégrité biologique ou ce que nous considérons comme la sécurité biologique.
Le virus du Covid-19 et la pandémie de Covid-19 ont tous deux été principalement conçus comme des objets de connaissance et d’intervention en matière de sécurité biologique par le biais d’ensembles de données et de modèles statistiques. La modélisation a été utilisée pour déterminer la stratégie appropriée : par exemple, l’atténuation versus la suppression. Différents modèles reposent sur différentes hypothèses, par exemple sur ce qui constitue une catégorie d’humains, qui, dans le cas présent, pouvait être distinguée en « personnes à risque, infectées, guéries ». Bien sûr, les modèles ramènent nécessairement des sujets complexes à des catégories uniques, mais ils simplifient aussi, de manière connexe, les interactions sociales. Ces dernières sont prises en compte différemment – et avec des conséquences diverses – dans, par exemple, les modèles compartimentaux, les modèles basés sur les comportements des individus et les modèles de réseau, respectivement[1].
La pandémie de Covid-19 nous est connue presque exclusivement sous la forme d’une visualisation statistique faite de courbes et de vagues. Ces représentations visuelles donnent une forme à l’épidémie, créant ce que David Jones et Stefan Helmreich ont appelé des « récits en formes de vagues » qui servent à la fois d’outils de prédiction et de techniques de persuasion.
Ces modèles et visualisations statistiques génèrent des énoncés de vérité qui sont distincts de ceux qui pourraient être générés par d’autres postulats concernant ce qu’il convient de représenter, le mode de représentation et la manière de mobiliser ces représentations ou d’agir à partir de celles-ci. C’est ce qu’a souligné avec force le médecin et historien des sciences Warwick Anderson dans sa récente critique non seulement de la modélisation statistique comme méthode réductrice permettant de porter des jugements rapides et décisifs dans un contexte marqué par l’incertitude, mais aussi du crédit accordé au taux de reproduction du virus (R0) en tant que représentation définitive d’un événement socio-épidémiologique complexe qui se déroule sous nos yeux.
Heureusement, ces modèles ont fait l’objet de débats autour des hypothèses, des incertitudes et des valeurs normatives, assurant ainsi une vision réflexive ou critique des représentations statistiques qui servent à établir des stratégies publiques particulières[2]. Mais ces débats ont eu peu d’impact.
En réduisant l’hétérogénéité, nous avons réduit la complexité et donc la capacité à envisager d’autres cadrages et d’autres voies. Nous avons choisi, pour reprendre les termes de l’éminent historien des sciences CE Rosenberg, le « point de vue de la contamination », une focalisation sur la transmission « de matériel morbide » entre humains, plutôt que le « point de vue de la configuration », lequel prend en compte l’écologie plus large de la vie virale.
Ce dernier point de vue est développé dans de nombreuses recherches sur les écologies pathologiques, publications qui auraient pu nous servir, comme le propose Warwick Anderson, d’ « EPI cognitif » (équipement de protection individuelle cognitif). Mais le Covid-19 a été constitué comme une crise épidémiologique, empêchant de fait sa représentation en termes plus hétérogènes – empêchant par exemple qu’elle soit envisagée comme un phénomène épidémiologique et socio-économique complexe et mutuellement constitué, ou comme une question de bien-être humain, et pas seulement de sécurité biologique.
Le bien-être public ne figure pas dans l’indice mondial de sécurité sanitaire.
Tout cela conduit à la question de savoir ce qui représente le mieux la sécurité humaine. Pour répondre à cette question, nous ne pouvons pas accepter aveuglément les énoncés de crise. Cela ne signifie pas qu’ils ne sont pas vrais. En d’autres termes, la décision de ne pas accepter aveuglément les énoncés de crise n’équivaut pas à nier l’affirmation d’un individu selon laquelle il a vécu une crise ni à désavouer l’affirmation d’une communauté selon laquelle elle a traversé une crise. Cela implique simplement un engagement à étudier la qualification de la crise. Comment cette qualification est-elle formulée ? Quels en sont les termes ? Qu’est-ce qui constitue la crise comme un objet sur lequel nous pouvons agir ?
La crise est un objet de connaissance. Nous déclarons qu’il y a crise, nous la définissons, nous établissons ses contours ou ses limites, nous la gérons, etc. Elle a des conséquences et des effets variables selon les populations et les communautés. Tout cela a son importance.
La théorie sociale européenne nous dit que la crise suppose un tournant. La crise est associée à un tournant parce qu’elle renvoie à une transformation épistémologique. En d’autres termes, la crise signifie, du moins selon la théorie sociale classique, la transformation de la production de connaissances et la production d’énoncés de vérité.
Mais arrêtons-nous un instant, et réfléchissons : lorsque la crise est déclarée, dans quelle mesure sommes-nous au milieu d’une transformation normative, ou d’une émergence de nouveaux standards normatifs ? Il nous faut nous demander, lorsque nous affirmons que la pandémie de Covid-19 est une crise, par exemple, si cela tient au fait que certaines standards normatifs et affirmations de vérité ne sont plus tenables. Serait-ce le cas ?
Il est sans doute encore trop tôt pour le dire. Peut-être que les brevets sur les vaccins feront l’objet d’une contestation juridique, attestant de la transformation des énoncés de vérité concernant les droits de propriété et le bien-être humain. Peut-être qu’une campagne de vaccination mondiale financée et gérée à l’échelle de la planète deviendra une pratique courante dans les années à venir. Peut-être.
Cependant, et malheureusement, d’une manière générale, nous pouvons voir très clairement comment, dans le cas du Covid-19, dire qu’il y a crise reconfirme implicitement les normes en matière de santé publique et ce que nous considérons comme étant la sécurité humaine. Nous voyons bien que dans ce cas il n’y a pas de transformation épistémologique – pas de nouveaux énoncés de vérité.
Aux États-Unis, l’énoncé de crise est inscrit dans des disparités raciales et socio-économiques très graves et profondes en matière de santé publique et de bien-être ; et celles-ci constituent la norme. Ces disparités incluent des différences dans les conditions de vie et de travail, et un accès inégal aux soins médicaux. La réponse au Covid-19 comme crise de santé publique n’a pas permis d’atténuer ces inégalités.
Certes, l’Urban Institute, un groupe de réflexion américain, rapporte que le American Rescue Plan Act de 2021 réduira le taux de pauvreté de 13,9 % en 2018 à 7,7 % en 2021. Il s’agit d’une baisse significative qui témoigne de l’importance des aides sociales. Mais malheureusement, il s’agit d’une baisse sur une année (2021) et qui repose largement sur les chèques de relance fédéraux versés directement aux familles. Ces programmes de secours vont prendre fin ; les causes structurelles de la pauvreté demeureront.
Comme aux États-Unis, la persistance et l’exacerbation des inégalités de revenus et de patrimoine sont une caractéristique de la vie en France et au Royaume-Uni. En l’absence d’un revenu de base universel, de « baby bonds » (prime à la naissance) pour combler l’écart de richesse en fonction de l’appartenance raciale, ou d’un fonds de « capital de base universel » qui assure l’équité et donc la redistribution de la richesse aux citoyens – sans aucune de ces mesures, la « crise du Covid-19 » n’engendrera aucune transformation épistémologique ou structurelle, quand les crises sont pourtant censées y conduire.
Au contraire, le fait de déclarer qu’il s’agit d’une crise n’a fait qu’exacerber les inégalités socio-économiques, car le bien commun (public welfare) n’entre pas en ligne de compte dans les plans de préparation à une pandémie. Il n’en est pas tenu compte aux États-Unis, par exemple, nation qui constitue l’un des exemples les plus spectaculaires d’inégalités de revenus due aux différentiels de revenus tirés du capital (par opposition aux revenus tirés du travail). Cependant, ces inégalités existent plus généralement à l’échelle mondiale, et elles sont exacerbées par le nationalisme vaccinal.
Il est regrettable qu’en dépit des plans de préparation aux pandémies mis en place de longue date, le bien-être public ne figure pas dans l’indice mondial de sécurité sanitaire, qui sert à évaluer les capacités de chaque pays à gérer les « événements biologiques catastrophiques ». Malheureusement, malgré l’aggravation flagrante des inégalités socio-économiques au sein des nations et plus largement dans le monde, et malgré toutes les souffrances et les deuils en cours, la sécurité humaine définie en termes de bien-être public n’a pas émergé comme un nouveau régime normatif.
traduit de l’anglais par Hélène Borraz
