Le monarque britannique est-il le garant de l’unité du Royaume et du Commonwealth ?
Dans son grand ouvrage consacré à la constitution d’Angleterre, Walter Bagehot, co-fondateur du magazine libéral The Economist, écrivait : « L’utilité de la Reine, dans sa fonction dignitaire, est incalculable. Sans elle, en Angleterre, le gouvernement anglais actuel échouerait et périrait. » La reine en question était naturellement Victoria, mais on serait tenté de dire la même chose d’Élizabeth II qui vient de disparaître après soixante-dix ans de règne.
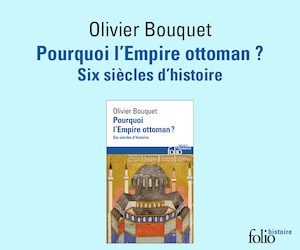
La reine a-t-elle permis aux Britanniques de surmonter les effets conjugués de la crise du Brexit et de l’épidémie de Covid 19 ? N’a-t-elle pas assuré la continuité de l’État dans la tourmente gouvernementale de ces derniers mois, et n’a-t-elle pas accompli son devoir jusqu’au bout pour désigner le successeur de Boris Johnson, ainsi que le veut la coutume ? Autrement dit, le monarque anglais est-il le garant de l’intégrité de la nation et du Commonwealth ?
La doxa constitutionnelle
Bagehot publie The English Constitution en 1867, l’année même où nombre de sujets britanniques accèdent à la représentation politique et deviennent de ce fait des citoyens. Par la seconde loi de réforme (Reform Act) l’ensemble de la classe moyenne ainsi que la frange supérieure de la classe ouvrière acquièrent ainsi le droit d’élire les membres des Communes. Le système restait censitaire et tenait à l’écart le reste des ouvriers, les employés de maison par définition sans domicile fixe, sans parler de l’ensemble de la population féminine.
Mais pour les plus conservateurs, cette extension du droit de vote s’apparente néanmoins à un « saut dans l’inconnu » (a leap in the dark). Le Royaume-Uni ne risque-t-il pas de se désintégrer sous l’effet de cette poussée démocratique ? Le dix-neuvième siècle voit, de fait, le déclin de l’aristocratie représentée à la Chambre des lords et la balance pencher en faveur de la Chambre des communes : on perçoit bien qu’étant plus représentative des intérêts et des aspirations de la majorité, son r
