Vers une écologie progressiste
L’ouverture des possibles qu’a produite le cycle d’élections présidentielle et législatives en 2022 en France, rapprochant le pays des situations de la plupart des pays d’Europe, nous invite à ne pas nous contenter des étiquettes des partis pour analyser les propositions et les actions des uns et des autres.
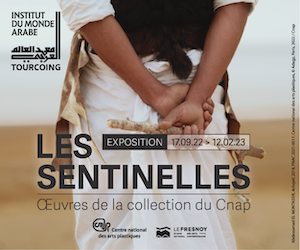
On peut définir le progressisme comme une orientation politique visant, pour la société et ses composantes, des avancées imaginées, définies, proposées et mises en œuvre par cette société et les acteurs qui l’animent. La démarche progressiste consiste à aller le plus loin possible vers des situations jugées meilleures par le plus grand nombre, en s’assurant que ceux qui jugent les changements négatifs aient aussi leur mot à dire.
Une traduction de ce choix est donnée par le caractère indissociable du couple développement-justice, chacun des éléments devenant synonyme de l’autre[1]. Dans deux textes précédents[2], j’ai montré que la vie politique en Occident tendait à se réorganiser en cercles concentriques progressiste / conservateur / réactionnaire / totalitaire et que le « curseur » gauche/droite s’affaiblissait, tout en devenant orthogonal à ces clivages, ce qui veut dire, par exemple, que rien ne garantit que ceux qui se disent de gauche soient effectivement progressistes.
Dans ce texte, je montre que les enjeux politiques liés à la nature entrent bien dans cette nouvelle configuration et j’explore les conditions de possibilité d’une écologie progressiste.
Une prise de conscience progressive de la responsabilité envers la nature
Un enjeu se situe désormais au sommet de l’arborescence des orientations politiques : la nature. Selon la manière dont les sociétés le traitent et le traiteront, beaucoup des autres enjeux seront profondément affectés.
Définissons la nature comme l’ensemble des réalités relevant du monde physique et biologique pour autant qu’elles concernent les humains, avec lesquelles ceux-ci interagissent et qu’ils peuvent ou non unifier
