Une approche écologique des interactions humaines
Écologie. Un mot, deux choses : un mouvement militant et politique, mais aussi et d’abord, une avancée scientifique. L’écologie scientifique, selon la définition qu’en donna Ernst Haeckel en 1866, est « la science des relations des organismes avec leur environnement, autrement dit l’étude de leurs conditions d’existence ». Les conditions d’existence d’une espèce donnée constituent son monde propre, son milieu de vie ou biotope, son umwelt tel que l’a décrit Jakob von Uexküll en 1934 dans son ouvrage pionnier, Milieu animal et milieu humain[1].
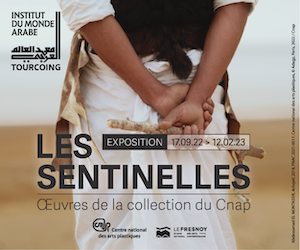
Cette définition ne s’applique pas à l’écologie en tant que mouvement militant et politique puisque celle-ci ne se propose pas de produire des connaissances, de décrire une réalité et d’en rendre compte : elle prescrit, elle invite à agir. Cessons, nous dit en effet l’écologie politique et militante, de considérer la planète comme un réservoir de ressources à exploiter et à dominer ; reconnaissons le caractère vital du « système Terre » et des « non humains » qui le composent. Renouons avec ce qui nous fait vivre, écrivent Bruno Latour et Nikolaj Schultz dans leur Mémo sur la nouvelle classe écologique[2] : nous ne devons plus nous considérer comme des humains face à la nature mais comme des vivants au milieu des non humains[3].
Pour définir et prescrire ce qui est souhaitable, il faut d’abord avoir une bonne connaissance de ce qui est. L’écologie normative présuppose donc l’écologie scientifique, écologie des milieux physiques, des plantes, des animaux. Mais où est l’écologie des humains ? On a beau dire, aujourd’hui, que nous, humains, faisons partie de la nature, nous ne figurons toujours pas parmi les objets sur lesquels porte le discours de l’écologie : nous en sommes les destinataires, et ce discours ne nous propose pas une description de ce que nous sommes, il nous invite à agir[4]. Certes, il y a urgence, mais ce n’est pas une raison pour continuer à nous excepter de l’ensemble des vivants[5].
Une première observation s’impose quant au milieu de vie des humains, c’est que chacun de nous vit d’abord et nécessairement au milieu d’autres humains. Avec des non humains aussi, possiblement, certains proches, d’autres lointains. Mais partout et toujours, les humains vivent en relation avec d’autres humains ainsi que dans l’environnement matériel et immatériel qu’ils créent.
Il est vrai que les autres primates vivent eux aussi en société, mais les humains sont de beaucoup les plus socialisés – nous nous sentons concernés (en bien ou en mal) même par des congénères que nous n’avons jamais rencontrés[6]. Notre milieu de vie premier, ce n’est pas le monde des non humains, c’est le monde des humains. Lorsqu’un enfant naît, ses poumons s’ouvrent d’eux-mêmes, mais son cerveau, lui, ne s’active que si des adultes interagissent avec lui. Ses apprentissages se font au contact des autres et grâce à eux[7]. Les relations que nous entretenons avec le milieu humain au sein duquel et grâce auquel nous vivons constituent donc un objet d’étude légitime pour l’écologie scientifique.
L’écologie militante et politique, en nous invitant à réagir à la crise écologique et aux menaces que celle-ci fait peser sur l’humanité, s’adresse évidemment aux individus pensants et connaissants que nous sommes (ou que nous croyons être). L’écologie scientifique, quant à elle, s’intéresse aux humains en tant qu’êtres vivants, donc animés, comme les autres vivants, d’une propension à vivre et même à se sentir vivre et exister. Il existe, certes, une Human Behavioral Ecology, mais cette discipline est une branche de la Behavioral Ecology qui étudie les autres animaux du point de vue darwinien de leur adaptation au milieu naturel.
En conséquence, « écologie humaine » laisse de côté l’existence subjective des humains. L’expression « ce qui nous fait vivre », qu’emploie Latour, renvoie concrètement à l’air que nous respirons et aux aliments que nous nous mangeons. Concerne-t-elle également notre existence subjective, notre intériorité ? Il ne le précise pas, mais il est clair que c’est plutôt l’écologie normative, celle qui nous invite à agir, qui nous concerne en tant qu’individus pensants.
Dans les lignes qui suivent, c’est bien d’une écologie descriptive ayant pour objet notre être subjectif qu’il s’agit. Je pars de ce constat fondamental que toute intériorité humaine suppose un milieu de vie (une niche écologique, un « umwelt ») tissé de liens interhumains, de langage, d’institutions et d’artefacts culturels (matériels et immatériels) au sein desquels il s’agit pour chacun d’avoir place et d’exister[8].
Depuis les matérialistes du XVIIIe siècle, il est entendu que pour sortir du dualisme, il suffit d’affirmer que l’âme, c’est en réalité le cerveau et que nos vrais besoins, ce sont les besoins matériels. « Dans la production sociale de leur existence, écrivait Marx, les hommes nouent des rapports déterminés, nécessaires, indépendants de leur volonté[9]. » Aux yeux de Marx, le mot « existence » renvoyait à l’existence matérielle. Or, le fait est que nous faisons l’expérience de nous-mêmes, en tant que corps vivant, mais aussi de l’intérieur, en tant que quelqu’un et non pas quelque chose.
Je puis souscrire à la citation de Marx, mais à condition de mettre sous le mot « existence » aussi bien notre existence subjective que corporelle (ce qui n’empêche pas de reconnaître tout ce que notre intériorité doit au cerveau). Ce qui implique que l’économie marchande ne constitue pas à elle seule le fondement des sociétés humaines (contrairement à la fausse évidence partagée aussi bien par le capitalisme que par le marxisme). En réalité, l’économie marchande est loin de suffire à fonder et à entretenir la forme de vie subjective et socialisée qui est celle de l’Homo sapiens[10]. Dès lors que nous baignons dans le monde des autres et que nous intériorisons celui-ci, ce qui se joue entre les autres et nous ne se limite pas à des intérêts économiques, mais implique notre désir d’exister et par conséquent des rapports passionnels, ce qu’une approche écologique devrait pouvoir éclairer[11].
Pour illustrer cette approche, les lignes qui suivent s’appuient sur deux exemples. Le premier vous est familier puisqu’il s’agit de la pandémie de Covid-19 et des réactions contrastées à l’égard du vaccin. Le second est très différent puisqu’il s’agit de la pratique du duel sous l’Ancien régime.
Être ou ne pas être vacciné
Grâce aux campagnes de vaccination qui se sont succédées depuis Edward Jenner et Louis Pasteur, des millions de vies humaines ont été sauvées. Une série de vaccins sont obligatoirement administrés aux enfants. Certains vaccins sont également exigés pour les voyageurs (par exemple contre la fièvre jaune dans les zones intertropicales, ou contre la méningite pour les pèlerins se rendant à la Mecque). Il s’est toujours trouvé une minorité de personnes refusant de se faire vacciner, mais avec la pandémie de Covid-19, le phénomène a connu un regain de vigueur.
En Europe, le clivage entre pro et anti-vaccin a mis à mal bien des amitiés et des liens de famille. Certains sont allés jusqu’à assimiler le passe sanitaire à l’étoile jaune ! Plus nombreux aux États-Unis, les anti-vaccins se recrutent largement chez les trumpistes. Quant aux pro-vaccins qui s’efforcent de convertir les récalcitrants, ils constatent généralement que leurs arguments, si rationnels et convaincants qu’ils soient à leurs propres yeux, restent sans effet. « On n’a pas assez de recul, s’entendent-ils répliquer, on ne sait pas si ces vaccins sont efficaces, ils peuvent même être nocifs » ; « De toute manière je ne vois pas grand monde et je fais attention, donc je ne contribue pas à propager le virus » ; ou encore : « Si j’attrape le Covid, eh bien j’assumerai », etc. Me faisant le récit de ses échecs, l’un de ces prêcheurs éclairés concluait sur un ton désabusé : « Bref, la connerie humaine ! » Une affirmation qui fait sans doute du bien à celui qui la formule, mais n’aide évidemment pas à analyser le phénomène qu’elle cible.
Un écrivain américain, Garret Keizer, a récemment publié un court essai consacré à ce qu’il considère être une troisième force en plus de celles du bien et du mal : la bêtise[12]. Il dit en avoir eu la révélation en voyant une foule en colère manifester en pleine épidémie de Covid contre la « tyrannie du masque ». Cette « stupidité », aux yeux de Keizer, ne témoigne pas tant d’un manque d’intelligence que d’un déni de réalité et du désir d’en transcender les contraintes, ce qui conduit à méconnaître ses propres intérêts et possiblement aussi de ceux des autres. Son analyse en reste là. C’est qu’il s’agit moins pour lui d’élucider le phénomène en question que de stigmatiser les trumpistes et leur obscurantisme.
D’une manière générale, aux yeux des « esprits éclairés » (dont Keizer est un bon représentant), un propos pertinent est un propos qui se fonde sur des connaissances vérifiées. Ainsi déploie-t-il des arguments « rationnels », c’est-à-dire des arguments qui s’appuient sur des faits reconnus par le monde savant et des raisonnements dont la logique est censée s’imposer à tout esprit normalement constitué.
L’individu éclairé s’identifie évidemment lui-même à ces critères. Il va donc de soi pour lui que ses interlocuteurs devraient se rendre à ses arguments. Ne sont-ils pas des humains semblables à lui, du moins semblables à celui qu’il croit être : des sujets rationnels, des sujets qui, par conséquent, attachent une grande valeur à la connaissance. Mais non, en réalité, ses arguments n’ont aucune prise sur ses interlocuteurs[13]. De quoi justifier le jugement dépréciatif qu’il porte sur eux, réaction comparable à celle d’une personne qui, confrontée à des réactions qu’elle déplore, s’exclame : « Vraiment, ça je ne comprends pas ! » Le « je ne comprends pas » n’implique pas que cette personne cherche à comprendre, mais qu’elle entend se démarquer à son avantage de l’individu ainsi jugé.
Bien que formulé sur le ton de la déception, le jugement dépréciatif apporte pourtant une satisfaction à l’individu éclairé, implicitement voire inconsciemment : elle lui confirme indirectement l’opinion avantageuse qu’il a de lui-même et soutient ainsi son sentiment d’exister.
Quant à l’élucidation du fait humain dont il s’agit, ce type de réaction n’avance évidemment à rien et constitue en réalité un échec[14]. Un comportement a beau être (ou paraître) irrationnel, il doit être possible d’en produire une connaissance rationnelle (ce que Spinoza avait fort bien compris).
Plutôt que de formuler des jugements péjoratifs à l’encontre des gens qui préfèrent ne pas se faire vacciner, certains préfèrent identifier les « biais cognitifs » qui expliqueraient ces réticences. Ils notent, par exemple, que les effets secondaires négatifs produits par un vaccin sur telle ou telle personne attirent bien davantage l’attention que son efficacité statistiquement prouvée[15].
Le concept de « biais cognitif », dû aux travaux de des psychologues Daniel Kahneman et Amos Tversky, présente l’avantage d’expliquer des comportements dits irrationnels sans pour autant mettre en cause le postulat qui veut que l’activité mentale soit fondamentalement de nature cognitive[16] : en invoquant un biais cognitif et en l’étiquetant (biais de confirmation, biais de négativité, biais d’autocomplaisance, etc.) on identifie différents formes de perturbation du fonctionnement cognitif tout en s’évitant de reconnaître que celles-ci sont sous-tendues par la propension à persévérer dans son être, la propension à soutenir une manière d’être (au sens littéral de l’expression) à laquelle on s’est identifié.
La théorie des biais cognitifs permet ainsi de préserver la croyance que, chez l’être humain, le rapport au monde est fondamentalement d’ordre cognitif et que la fonction essentielle du langage est informationnelle. Tel est le point aveugle des Lumières : l’individu éclairé peine à reconnaître que les faits auxquels il est confronté (y compris son propre comportement) s’expliquent aussi, en réalité, par le désir et la nécessité où nous sommes de nourrir notre sentiment d’exister, avec ou contre d’autres. En s’exprimant au titre d’un savoir « rationnel » (un savoir qui émane d’une instance tierce indépendante des partis-pris des uns et des autres) on s’assure d’avoir raison, ce qui, bien souvent, permet d’ignorer que l’on est poussé par le désir d’avoir raison et de l’emporter sur l’autre.
De leur côté, les anti-vaccins avancent des arguments qui ne sont pas moins rationnels à leurs yeux que ceux des pro-vaccins. Certains sont convaincus que les composants des vaccins sont nocifs. D’autres, les plus nombreux sans doute, estiment que l’obligation vaccinale constitue une atteinte aux libertés individuelles (ceci bien que le vaccin contre le Covid ne soit pas obligatoire, à la différence du BCG, rendu obligatoire en France en 1952, et des vaccins destinés aux jeunes enfants).
Il est cependant fortement préconisé par le gouvernement, de sorte que les militants anti-vaccins considèrent qu’il est légitime d’y résister : « Nous ne sommes pas des moutons ! » En France, le président Macron a tenu, semble-t-il, à incarner cette autorité contraignante plutôt qu’à placer au premier plan un représentant des épidémiologistes et des virologues, pourtant plus qualifiés que lui sur la question.
Or, comme les manifestations répétées des gilets jaunes l’ont montré, Macron est le personnage que bon nombre de Français aiment détester. Une telle situation a pu contribuer au bras de fer dans lequel s’est engagée une minorité non négligeable. C’est encore plus net dans des pays comme la Russie, l’Ukraine, la Bulgarie ou la Roumanie, où la défiance à l’égard du vaccin est, en quelque sorte, un sous-produit de la défiance à l’égard du pouvoir.
Mais ce n’est pas là la seule cause de l’opposition au vaccin. Car en définitive, les Français ont tout de même été plus nombreux à se faire vacciner que les Allemands et les Autrichiens, pourtant plus confiants dans leur gouvernement. Mais ceux-ci sont davantage portés sur l’anthroposophie de Rudolf Steiner et d’autres médecines parallèles. Les réseaux sociaux ont également joué un rôle dans cette affaire : on sait en effet qu’ils tendent à renforcer les convictions de ceux et celles qui s’en nourrissent plutôt qu’à les modifier[17]. L’acceptation ou le refus des recommandations sanitaires et de la vaccination dépend également du degré de confiance dans les scientifiques, et celle-ci est plus forte chez les personnes dont le niveau d’éducation – en particulier l’éducation scientifique – est plus élevé[18].
Il faut compter, enfin, avec les progrès de ce qu’on nomme l’individualisme, plus précisément la tendance à lier le sentiment de sa valeur personnelle au fait de s’affirmer en son nom propre contre une autorité collective (« Moi, je pense que… »). Jouer les David contre Goliath, c’est flatteur. D’autant que le plus-être qu’on en retire est tout à fait compatible avec la satisfaction à se sentir soutenu par « tous ceux qui pensent comme moi ». Ici encore, les réseaux sociaux jouent un rôle important : en permettant à leurs usagers de constater qu’ils ne sont pas les seuls à se rebiffer, ils les renforcent dans la conviction qu’ils ont raison.
D’une manière générale, tout en mettant en avant des arguments qui se veulent objectifs et rationnels, les anti-vaccins affirment ainsi indirectement leur être et tiennent donc à se démarquer de ceux qui se fondent sur une manière d’être perçue comme concurrente. À cet égard, l’exemple américain est éloquent puisque le clivage entre pro et anti-vaccins correspond très largement au clivage entre Démocrates et Républicains. Comment ne pas penser à la chanson de France Gall : « Résiste, prouve que tu existes ! »
Pro et anti-vaccins mettent en avant des raisons. Celles-ci, en justifiant leur position, visent à susciter l’approbation de ceux auxquels ils s’adressent. Se sentir justifié et digne d’approbation, c’est aussi – implicitement – sentir que l’on existe. Le désir d’exister – passion première – se réalise par l’intermédiaire de cette justification. C’est de cette justification que les individus en question sont conscients et non de leur désir d’exister.
Ici comme dans une infinité d’autres situations, il faut, pour que le désir d’exister se réalise, qu’il soit méconnu par la personne même qui en est animée. Pourquoi ? Parce que si vous prenez conscience que ce que vous affirmez tient moins aux raisons que vous mettez en avant qu’à la satisfaction que cette affirmation vous procure, vous allez commencer à douter de la valeur de ces raisons, ce qui ne peut que nuire à votre combat.
La position des pro-vaccins, légitimée par les pouvoirs publics, est évidemment puissante et confortable. Elle est plus délicate pour les personnes qui refusent de se faire vacciner dans la mesure où elles vont ainsi à l’encontre de leur intérêt qui est de ne pas mettre leur vie en danger ; en revanche, comparées aux pro-vaccins, elles jouissent d’un plus grand sentiment d’intensité : ce ne sont pas des moutons ! Un témoin extérieur dira d’elles que leur passion est plus forte que leur intérêt. Mais les anti-vaccins se perçoivent comme des individus rationnels et non comme des passionnés, ils sont convaincus que les raisons et justifications qu’ils mettent en avant sont les véritables causes de la position qu’ils ont adoptée et de l’ardeur avec laquelle ils la défendent. Et aussi bien chez les pro-vaccins que chez les anti-vaccins, la propension à s’identifier à un « nous » valorisé par opposition à un « eux » déprécié est un moteur puissant.
En effet, le désir individuel de s’affirmer en son nom propre et par soi-même, si pressant soit-il, ne se heurte pas moins au fait que chacun de nous – dure réalité – n’est qu’un parmi d’autres. C’est pourquoi notre désir d’exister, dans le processus même de sa formation et de son expression, ne peut pas ne pas réagir à celui des autres. Dans le cas où ceux-ci valorisent ce que nous valorisons, nous sommes portés à nous affilier à eux et nous gagnons ainsi un sentiment de plus-être. Lorsqu’ils déprécient, au contraire, ce à quoi nous tenons, ils déprécient ce qui soutient notre être. Ils nous infligent ainsi un moins-être subjectif et suscitent donc notre hostilité.
L’approche ainsi esquissée est écologique en ce qu’elle ne sépare pas l’intériorité de son milieu de vie. Elle se distingue de la vision humaniste traditionnelle dans la mesure où celle-ci attribue au sujet le pouvoir de se déterminer par lui-même. Or, si développés que soient notre capacité de réflexion et notre niveau de connaissance, il n’est pas en notre pouvoir d’échapper à la nécessité et au désir d’exister. Ni par conséquent d’échapper au fait que ce désir doive nécessairement tracer sa voie au sein des conditions sociales et des conjonctures relationnelles dont nous sommes tributaires. Pensez à l’eau d’une rivière : sa dynamique propre la pousse à s’écouler vers le bas, mais il lui faut pour cela frayer son chemin en fonction de la conformation du terrain et de ses accidents.
Le second exemple que nos allons maintenant aborder met lui aussi en lumière, à sa manière, le fait que pour prendre corps, s’exprimer et se réaliser, le désir d’exister dépend nécessairement de la conjoncture sociale et culturelle qui constitue son umwelt, son milieu de vie.
Le duel, entre honneur aristocratique et passion de tuer
Même si le fait d’exister dans l’esprit des autres n’est pas la seule et unique voie de réalisation du désir d’exister, il est cependant essentiel. On souligne volontiers, aujourd’hui, le caractère légitime du désir de reconnaissance et le devoir moral de reconnaître l’autre. La pratique du duel fait ressortir, au contraire, la face sombre de la lutte pour la reconnaissance.
Le dernier duel judiciaire ou « jugement de Dieu » autorisé par un roi de France eut lieu en 1547. La pratique ou la mode du duel pour le point d’honneur, duel privé, prit le relais. Dans le duel entrent en jeu les rapports entre la noblesse et le pouvoir royal[19], une certaine vision de l’honneur, la pression des pairs, l’affirmation physique et viriliste de soi ainsi que la jouissance de l’homicide[20].
La pratique du duel privé s’étendit sur quatre siècles, du XVIe jusqu’au début du XXe. Privilège initialement réservé à la noblesse d’épée, le duel séduisit aussi des membres de la noblesse de robe ainsi que des roturiers. Le duel, écrivait en 1715 l’un de ses détracteurs, l’abbé de Saint-Pierre, « est une maladie qui affecte plusieurs États de l’Europe et notre monarchie en particulier[21] ». Un mal français donc, qui finit par gagner la Russie. Au XIXe siècle, le duel fut surtout pratiqué par les militaires, mais également par des hommes politiques et des journalistes (il n’épargna pas pour autant les intellectuels, tel le mathématicien Évariste Gallois, tué en duel à l’âge de vingt ans, ou le poète russe Alexandre Pouchkine). La mode des duels ne survécut pas à la première guerre mondiale et à ses hécatombes industrielles.
Les duels furent interdits par le pouvoir royal. Henri III formula clairement la doctrine en 1576 : les duellistes se rendent coupables de lèse-majesté, ils usurpent le droit de justice dévolu par Dieu au monarque. Le duel, écrit Billacois, « affirme la vitalité orgueilleuse d’une aristocratie qui résiste à l’ordre monarchique[22] » et qui parfois même le défie ouvertement (n’oublions pas la Fronde, 1648-1653). Les protestations de la noblesse ne sont pas sans rapport avec celles des anti-vaccins : « Nous ne sommes pas des moutons ! »
Dans l’ensemble, le pouvoir royal se montra moins sévère qu’il promettait de l’être. Les rois, en effet, ménageaient la noblesse d’épée pour la bonne raison qu’il leur fallait compter sur elle pour lever des troupes (en France, la conscription fut instituée en 1793). De plus, les membres des classes supérieures pouvaient s’arranger pour échapper, dans une certaine mesure, à la rigueur des lois.
L’interdiction édictée par Henri III fut renouvelée par Louis XIII. Le préambule de ce nouvel édit met dans la bouche du jeune roi cet avertissement solennel : « Plus sensibles aux intérêts de Dieu qu’aux nôtres, nous ne saurions penser sans horreur à ce crime détestable qui pousse les duellistes, par une manie prodigieuse, à sacrifier leurs corps et leurs âmes à cette idole de vanité qu’ils adorent au mépris de leur salut. […] Que si les duellistes ont oublié que Dieu s’était réservé la vengeance, que c’est à Lui qu’ils sont obligés de la demander quand ils se croient offensés, ils devraient au moins se souvenir de s’adresser à nous comme à son Image vivante, à qui il lui a plu de donner, à l’égard des peuples qu’Il nous a soumis, quelque participation de sa puissance. Mais ils veulent se faire justice eux-mêmes, et se rendre indépendants dans la chose du monde où ils sont le plus obligés de se soumettre[23]. »
Dans un édit de 1656, Louis XIV à son tour prétend détruire « une coutume si fort opposée aux maximes chrétiennes, et qui fait épancher si honteusement un sang qui ne doit être versé que pour la défense des intérêts de Dieu et de la Patrie[24] ».
Après l’Ancien régime viennent la Révolution, l’Empire, la Restauration, mais le même constat continue de s’imposer : la manie du duel ne faiblit pas. « De nouveau fleurissent dans les devantures des librairies les essais et les recettes pour tarir le goût de s’expliquer en se trucidant[25]. » Mais en vain.
Arrêtons-nous un instant sur la justification qu’invoquent les duellistes : l’honneur. Au début du XVIIe siècle, un gentilhomme périgourdin, Louis de Chaban, rédigea un écrit intitulé Avis et moyens pour empêcher le désordre des duels. Il y définissait le duel comme « un combat pour le seul but d’acquérir ou de conserver l’honneur ».
D’après lui, l’honneur, pour les nobles, s’était longtemps matérialisé sous la forme de charges, d’offices et de pensions données par le roi en récompense de hauts faits. Malheureusement, le mauvais état des finances du royaume a conduit à instituer la vénalité des charges. Ainsi, poursuit le sieur de Chaban, « depuis que les actions de vaillance ne sont plus récompensées de ces anciennes marques qu’elles voulaient obtenir pour le véritable honneur […], nous nous portons désespérément aux duels pour acquérir la réputation d’être vaillants », celle-ci étant la sorte d’honneur ou de gloire que confère l’opinion publique[26].
Le raisonnement sous-jacent – à la fois intéressé et biaisé – est celui-ci : si le pouvoir royal voulait bien récompenser concrètement la vaillance des nobles, ceux-ci n’en seraient pas réduits à se battre en duel (on pense à la phrase que Racine, dans Les Plaideurs, met dans la bouche de Petit Jean : « Sans argent, l’honneur n’est qu’une maladie »).
Bossuet, de son côté, s’en tient à une définition générale : « L’honneur est cette estime que les autres font de nous pour quelque bien qu’ils y considèrent[27]. » La définition qu’en donnera l’Encyclopédie au siècle suivant n’est guère différente : l’honneur est « l’estime de nous-mêmes et le sentiment du droit que nous avons à l’estime des autres[28] ». Ces deux définitions présentent le désir d’acquérir et de conserver l’honneur comme un désir légitime.
Cependant, le genre de comportement et d’action qui attire l’estime des autres (et par conséquent le bien que l’on pense de soi-même) n’est pas toujours recommandable. Les mafieux ne prétendent-ils pas être des « hommes d’honneur » ? Ce n’est pas nécessairement et même pas souvent en se comportant bien moralement que l’on s’attire les suffrages des autres (Kim Kardashian et bien d’autres influenceurs et influenceuses aux milliers, voire aux millions de followers en savent quelque chose).
Les auteurs qui condamnent le duel voudraient que le désir d’honneur (autrement dit le désir de reconnaissance) s’aligne sur la morale. Ainsi, cette définition due à un auteur janséniste[29] : « L’honneur est le sentiment d’un cœur élevé qui réunit en soi et dans un degré éminent tous les caractères de la justice morale. » Vœu pieux, bien sûr ! D’autres anti-duels ont bien vu que derrière ce que les duellistes appellent l’honneur, c’est l’amour-propre qui s’exprime.
Montesquieu pousse plus loin l’analyse. Influencé par la pensée de Spinoza, il n’attache pas à l’amour-propre la valeur négative qu’y mettent les jansénistes. Le point d’honneur est bien une manifestation de l’amour-propre et du désir de gloire, mais ce désir lui-même, écrit-il, « n’est point différent de cet instinct que toutes les créatures ont pour leur conservation. Il semble que nous augmentons notre être quand nous pouvons le porter dans la mémoire des autres : c’est une nouvelle vie que nous acquérons, et qui nous devient aussi précieuse que celle que nous avons reçue du Ciel[30]. »
Le désir de gloire, donc, est du même ordre que la propension qui anime les autres vivants (le conatus de Spinoza). Et, ajoute Montesquieu, cette vie que nous communique le fait d’exister dans l’esprit des autres nous est « aussi précieuse que celle que nous avons reçue du Ciel » ; aussi précieuse, donc, que la vie du corps. Deux sortes de vie qui pourtant ne sont pas radicalement différentes mais plutôt deux modalités d’un même vouloir-vivre ou désir d’exister. Montesquieu, comme on sait, rejette l’opposition dualiste entre le corps et l’âme. Mais cela ne l’empêche pas de constater que sentir que l’on existe dans l’esprit des autres n’est pas un fait purement biologique – effort de précision dont nous devons lui savoir gré.
Les duellistes n’étaient évidemment pas enclins à identifier en eux les forces qui les poussaient à se battre, car il aurait fallu pour cela admettre que le souci de leur honneur n’était que la justification de leur ardeur meurtrière et non sa véritable cause. Dès lors, en effet, que je m’oppose à d’autres, et surtout si je le fais publiquement, je dois nécessairement mettre en avant une justification (et autant que possible y croire moi-même). Car si ces autres constatent que je m’en prends à eux sans une bonne raison, je me mets dans mon tort : je ne suis plus qu’un agresseur. J’ai perdu : l’honneur, alors, est pour eux et pour moi la honte.
C’est pourquoi, aussi cynique ou criminel que l’on soit, on n’éprouve pas moins le besoin de se justifier. En effet, toute personne, lorsqu’elle parle, est animée d’une visée de pertinence et attend donc de ses destinataires qu’ils entérinent la justesse de ce qu’elle dit. Approuvée, elle se sent justifiée et soutenue dans son sentiment d’exister. Elle a d’autant plus de chances de recevoir cette justification qu’elle partage avec eux un même terrain d’entente. Dans ce cas, ses paroles s’adossant à ce terrain d’entente, celles-ci confirment indirectement l’assiette existentielle de ses interlocuteurs. Et par conséquent aussi son affiliation à ceux-ci et sa propre assiette existentielle. Dans le cas contraire, elle s’expose à la réprobation, au rejet, voire à l’ostracisme.
Certains des auteurs qui déplorent « la manie des duels » font un pas vers la vérité en observant que l’une des causes des duels est la pression de l’opinion publique. C’est ce que constate un ami de Pascal, Pierre Nicole : « Combien de gens, écrit-il, s’allaient autrefois battre en duel, en déplorant et en condamnant cette misérable coutume, et se blâmant eux-mêmes de la suivre ? Mais ils n’avaient pas pour cela la force de mépriser le jugement de ces fous qui les eussent traités de lâches s’ils eussent obéi à la raison[31]. »
En invoquant la raison, Nicole et bien d’autres avec lui s’appuient sur la conviction (ou la croyance) qu’il est possible de transcender le réseau relationnel dont on est soi-même l’un des maillons. Possible, à condition de mobiliser intérieurement la force d’âme nécessaire. On touche ici au noyau de la conception occidentale de l’individu, vision exaltante d’une intériorité héroïque qui, assiégée par les forces de ce monde, y résiste et les dépasse car elle est d’un autre ordre que celles-ci (pensez aux innombrables prêches que le christianisme a consacré à ce thème, au fameux passage de Pascal sur l’homme, roseau pensant, ou encore à la vision kantienne du sublime).
Cette conception séduisante invite à s’identifier à un idéal, elle correspond à ce que nous voudrions être, non à ce que nous sommes. L’approche écologique que je propose est donc différente. Elle prend au sérieux le fait que beaucoup ne pouvaient pas échapper au duel, de même que d’autres aujourd’hui encore, ne peuvent se soustraire au crime d’honneur que leur famille les met en devoir de commettre. Si, en effet, l’intériorité n’est pas d’un autre ordre que le milieu de vie auquel elle appartient, le désir d’exister ne peut se réaliser indépendamment des formes de vie, des comportements, des idées et des images que ce milieu de vie le conduit à intérioriser. Il ne peut échapper aux contraintes que celui-ci lui impose ; tout au plus peut-il contourner certaines d’entres elles, tirer parti de certaines autres et parvenir ainsi à frayer son chemin.
Le milieu de vie de chacun d’entre nous est fait, bien sûr, du monde physique dans lequel nous vivons ; il est également fait, on vient de le voir, du monde des autres dans lequel nous baignons et que nous intériorisons. Notre milieu de vie, enfin, c’est notre corps lui-même – ce que, s’agissant des duels, il ne faut surtout pas oublier. Les duels ont toujours été une affaire d’hommes, d’hommes jeunes ou dans la force de l’âge.
Comme le rappelle le primatologue Frans de Waal, chez les primates, les mâles sont généralement plus brutaux que les femelles, un héritage qui n’épargne pas les hommes, plus violents physiquement que les femmes comme le confirment les statistiques mondiales sur l’homicide[32]. Les mâles s’affrontent pour les femelles aussi bien que pour le pouvoir et le territoire. La violence est ainsi associée au rut, aux parades nuptiales et aux insignes de prestige – bois des cerfs ou port de l’épée. « Tout ainsi que les béliers se tirent à part du troupeau pour s’entrechoquer, écrit l’auteur d’un Traité contre les duels de 1610, de même les Françoys se mettent à quartier du gros des armées pour s’entrestrocquer[33]. »
Le virilisme – un virilisme exacerbé – est une composante majeure de ce que les duellistes appelaient l’honneur (curieusement, Duel sous l’Ancien Régime, pourtant écrit par une femme, ne fait pas mention de ce virilisme). Mêlée à la jouissance de défier l’autorité et au désir de gloire, l’acmé virile qu’est le duel nourrissait certainement davantage le sentiment d’exister des deux adversaires que le comportement moral et rationnel auquel les invitaient les détracteurs de cette « manie funeste ».
Il est difficile pour des gens comme vous et moi de s’imaginer ce qu’était le vécu corporel des duellistes lorsqu’ils se battaient épée contre épée : équilibre physiologique et hormonal bouleversé par le stress ; terreur chez les uns malgré la volonté de faire bonne figure ; intensité et fureur addictives chez les autres ; détermination à trouer la peau de l’autre. L’autre, incarnation de ce qui m’empêche d’exister, l’homicide vécu par conséquent comme une sorte de triomphe (pensez aux illustrations répétées qu’en donnent westerns et autres films d’action).
Derrière l’homicide, réel ou fantasmé, sans doute faut-il remonter à l’hypothèse que j’ai proposée ailleurs[34], que tout nouveau-né, quand vient la période où il s’agit pour lui d’accéder à l’assurance de sa propre existence, en passe virtuellement par un « duel originaire » : si l’existence de l’autre, le caregiver dont je dépends entièrement, s’impose absolument à moi, alors je n’existe pas, et si, inversement, c’est moi qui existe, lui pourrait bien disparaître. Passer d’un C’est lui ou moi à un Lui et moi nous existons tous les deux, voilà qui ne va pas de soi.
