Images d’Ukraine : qui veut vraiment la fin de la guerre ?
Le moins que l’on puisse dire, c’est que nous n’avons pas le sentiment de manquer d’images de la guerre en Ukraine. Celles-ci, de sources multiples – journalistique, militaire, civile… –, peuplent massivement nos écrans depuis le 24 février 2022, date du début de l’invasion russe dans le pays. Le temps semble loin où le critique de cinéma Serge Daney déclarait, peu après la fin de la Guerre du Golfe en avril 1991, qu’il « a existé pendant cette guerre une véritable image manquante, celle de Bagdad sous les bombes[1] ».
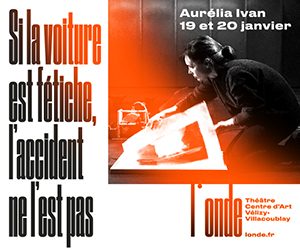
Malgré la couverture en temps réel de CNN à l’époque, ou plus exactement à cause d’elle – l’appareil militaire américain contrôlait de près son traitement de l’information –, les dommages collatéraux de l’opération « Tempête du désert » restaient globalement non vus. La guerre était supposée être « propre », et il ne fallait pas entacher la réputation des bombes dites « intelligentes » qui s’abattaient alors sur le sol irakien, causant des centaines de milliers de victimes parmi les civils. Cette réputation n’a pas résisté au temps, et aucun commandement militaire ne communique plus sur le caractère « chirurgical » de ses bombardements aériens. Aujourd’hui, les images ne manquent pas des villes ukrainiennes meurtries par le déluge de feu de l’aviation russe : Kyiv, Irpine, Kharkiv, Marioupol, Zaporijjia, Severodonetsk, Izioum, Balakliia, Kherson, Kramatorsk, Bakhmout, Soledar, Dnipro…
Le problème, en apparence, n’est donc plus le manque d’images, comme à l’époque de Daney où internet n’existait pas encore, ni même l’hypervisibilité du conflit que favorisent désormais les plateformes en ligne. Le problème est ailleurs. Il réside d’abord dans l’extrême monotonie des images sélectionnées par les médias d’information pour illustrer la guerre en Ukraine, indépendamment de la recherche obsessionnelle de l’image-iconique qui a tendance à éclipser toutes les autres (comme c’est le cas potentiellement pour la femme à côté de sa baignoire dans l’immeu
