Repenser l’habitabilité planétaire depuis les villes africaines
En mars 2022, l’architecte burkinabé Francis Kéré se voit décerner le prix Pritzker, l’équivalent du prix Nobel pour l’architecture. Cette distinction marque la reconnaissance de l’architecture africaine, longtemps ignorée et dénigrée. Mais, alors que Kéré prône le retour aux matériaux locaux et la redécouverte des savoir-faire vernaculaires, force est de constater que le béton domine très largement les paysages urbains africains.
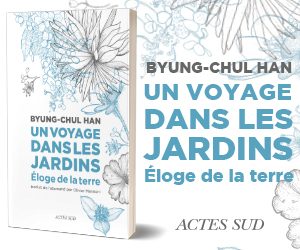
Symbole de modernité et de succès, ce matériau est devenu omniprésent. Il est pourtant aujourd’hui largement contesté pour son empreinte carbone. Alors que l’Afrique est particulièrement touchée par les effets du changement climatique et qu’elle abritera un quart de la population mondiale en 2050, nous interrogeons les modes d’habiter contemporains et invitons à penser nos futurs urbains depuis ce continent.
Du Béton Made in Africa
« Je rêve d’être footballeur, comme Samuel Eto’o ou… cimentier, comme Aliko Dangote » explique Olumide, du haut de ses 11 ans, lorsque nous le rencontrons à Lagos. Olumide, comme tous les enfants ouest-africains, connaît Dangote, l’homme le plus riche du Nigeria et d’Afrique (et 130e fortune du monde selon le magazine Forbes). Aliko Dangote, magnat du ciment, incarne la nouvelle figure de la réussite en Afrique. Depuis les années 2000, la compagnie Dangote a ouvert des cimenteries sur tout le continent à partir de carrières de calcaire locales pour produire la précieuse poudre grise qui, mélangée à du sable, du gravier et de l’eau, donne du béton. Le ciment, qui était hier un matériau d’importation réservé aux quartiers coloniaux et aux élites, est désormais produit localement et perçu comme 100 % Made in Africa.
En ouvrant ses cimenteries et en concurrençant les grands groupes européens comme Holcim (Lafarge) et Heiddelberg, Dangote a « africanisé » le ciment et permis de faire baisser son prix de vente. Celui-ci est aujourd’hui considéré comme un bien de première nécessité, souvent subventionné par les gouvernements. La Banque Mondiale elle-même a vu dans l’industrie cimentière un moyen de booster les économies locales : le matériau est vu comme un levier de développement permettant de loger le plus grand nombre et de construire les infrastructures de base.
La consommation de tonnes de ciment par habitant est d’ailleurs régulièrement prise comme indice de développement par les bailleurs de fonds et agences de développement, souvent comparée au PIB. La moyenne mondiale tourne autour de 500 kg par habitant. En Afrique, le ratio est encore faible, avec une moyenne de 115 kg per capita mais les marges de progression sont immenses, comme l’ont bien compris les géants du secteur, Dangote en tête, qui incitent à l’ouverture de cimenteries pour soi-disant en faire baisser le prix.
Il est vrai que ce matériau est devenu largement accessible et bon marché en à peine deux décennies. L’engouement qu’il suscite est également lié à sa simplicité d’usage et de mise en œuvre. Mélanger du ciment à de l’eau, du sable et du gravier pour produire du béton ne nécessite pas de source d’énergie électrique constante, laquelle fait cruellement défaut en Afrique. Nul besoin non plus de savoirs techniques, puisque les dosages nécessaires à la fabrication du béton sont indiqués par des pictogrammes sur les sacs de ciment eux-mêmes : trois brouettes de ciment, deux de sable et une de granulats (gravier). Construire en béton est apparemment un jeu d’enfant.
En Afrique occidentale francophone, les enfants apprennent justement à lire et à écrire avec le Livre de lecture du français pour les écoles africaines de Mamadou et Bineta, écrit par André Davesnes et réédité régulièrement depuis les années 1970. Dans la version de 1995, toujours en circulation aujourd’hui, la leçon 55 est intitulée « Les belles maisons de mon village » et décrit une situation : « Dans mon village, il n’y a pas que des cases, il y a aussi de belles et solides maisons dont les murs sont construits en briques et en ciment et dont les toits sont couverts de tuiles ou de tôle ondulée. » Les maisons en béton y sont donc décrites comme naturellement belles.
Les élèves sont ensuite invités à copier et à mémoriser les nouveaux mots : béton, briques, ciment, tuiles et tôle ondulée. Cette leçon rappelle le conte des Trois petits cochons qui a façonné les imaginaires de millions d’enfants occidentaux. Dans cette fable comme dans l’abécédaire lu par des générations d’enfants ouest-africains, le ciment et le béton résistent et rassurent.
Le ciment est un matériau, une marchandise, un business, mais il est aussi un fait social, chargé de valeur. Construire en dur participe de l’affirmation de soi : la réussite d’un individu se mesure aux tonnes de ciment coulées. Le sac de ciment lui-même devient objet d’aspiration, de désir, d’émancipation et d’affect. De jeunes gens s’offrent des sacs comme preuve d’amour et d’engagement.
Ainsi, au moment de constituer la dot, la famille de la mariée réclame généralement des sacs de ciment. Certains émigrés, pour contribuer aux dépenses de la famille restée au pays, préfèrent payer des sacs de ciment plutôt qu’utiliser les services internationaux de transfert d’argent. Pour les plus pauvres, qui ont difficilement accès au système bancaire, recevoir et/ou acheter des sacs de ciment et construire au fur à mesure est aussi un moyen de thésauriser.
Dans des sociétés urbaines marquée par l’incertitude et la précarité, construire une maison et en louer quelques pièces est l’un des rares moyens de préparer sa retraite et de s’assurer un revenu régulier pour ses vieux jours. Les habitants construisent ainsi par eux-mêmes, au jour le jour, au gré des revenus souvent intermittents. Le parpaing de béton est devenu le lingot du pauvre et son usage est désormais généralisé, y compris dans les quartiers précaires. Face aux évictions récurrentes dans les villes ouest-africaines, construire en béton permet de s’inscrire physiquement sur le long terme et de rompre avec l’insécurité.
Pour nombre d’individus qui n’ont pas de titres de propriété officiels et reconnus, la maison en béton est un moyen d’exprimer une certaine légitimité et de revendiquer une plus grande intégration à la ville. En ce sens, le béton matérialise le droit d’être en ville et d’y rester – une première pierre vers le « droit à la ville » du philosophe Henri Lefebvre.
Aujourd’hui, ce sont les mêmes sacs de ciment qui servent à construire les projets pharaoniques futuristes comme celui d’Eko Atlantic City, cette île artificielle au cœur de Lagos qui rappelle les projets de Dubaï, tout comme les abris de fortune dans les quartiers précaires ou les maisons des classes moyennes. Riches comme pauvres, tout le monde a affaire avec le béton.
Habiter des villes inhabitables
François Dossou est tout content de faire visiter sa nouvelle maison dans la périphérie de Cotonou au Bénin. Il est gardien et a économisé toute sa vie pour pouvoir bâtir ces quatre murs coiffés d’un toit en tôle. Après nous avoir assuré de sa satisfaction et de sa fierté, il confesse ne pas dormir dans la maison : « Le problème, c’est que la nuit, il fait trop chaud à l’intérieur. Alors, je dors dehors et je me fais piquer par les moustiques. ».
En regardant la maison-fournaise inhabitable de François, nous repensons à la fraîcheur des Tata Somba, ces cases en terre situées au Nord Bénin, aujourd’hui labélisées patrimoine mondial de l’UNESCO. En tête nous reviennent les maisons en pierre de Chinguetti, caravansérail niché au beau milieu du Sahara mauritanien, les pyramides de Méroé au Soudan, les villages dogons en terre accrochés sur la faille de Bandiagara au Mali ou encore les « cases-obus » de terre et d’herbe au Nord Cameroun.
François, comme nous, sait bien que les bâtiments en terre et en bois, avec une ventilation naturelle, présentent une meilleure qualité thermique, qu’il il y fait moins chaud le jour et plus frais la nuit. Mais lui comme tant d’autres a choisi de construire en béton car « c’est moderne et ça dure plus longtemps. Tu n’as pas besoin de refaire la maison après chaque pluie. La brique de béton, elle, ne pourrit pas ».
François a raison, enfin seulement en partie, car le béton n’est pas adapté aux conditions climatiques locales, marquées par des chaleurs extrêmes et une forte humidité. La question de l’omniprésence de ce matériau dans les paysages urbains comme ruraux, de sa pérennité et de sa durabilité se pose avec acuité. En Afrique comme ailleurs, le consensus autour du béton s’amenuise. Les militants écologistes, les ONG internationales et les rapports du GIEC ne cessent de dénoncer l’industrie du ciment, connue pour être l’une des plus polluantes au monde, responsable de 8 % des émissions de carbone mondiales.
Outre le ciment, fabriquer du béton nécessite d’immenses quantités de sable et de gravier, deux ressources que le Programme des Nations-Unies pour l’Environnement a classées en forte diminution dans le monde entier. Par ailleurs, le béton n’est pas un matériau aussi immuable qu’on peut le penser : sa durée de vie est estimée entre 50 et 7 ans. Passé ce délai, les bâtiments et les infrastructures nécessitent des opérations de maintenance à grande échelle.
L’Europe a pris conscience de l’obsolescence du béton avec l’effondrement du Pont de Gênes en 2018 et les évacuations régulières de bâtiments pour éviter les effondrements, notamment de balcons. Le sujet de la maintenance, de son coût et de sa prise en charge inquiète en Afrique, alors que les bâtiments sont souvent construits avec des matériaux de piètre qualité, sans respect des normes recommandées et en l’absence de permis de construire. Les effondrements de bâtiments font d’ores et déjà partie du quotidien.
La ville de béton qui prend forme en Afrique résume alors toutes les contradictions de notre société : elle semble la seule capable de faire face à la croissance démographique et urbaine en proposant de construire rapidement et massivement. Mais, elle repose sur une économie extractiviste, une industrie cimentière particulièrement énergivore et un matériau obsolescent. Son existence même et sa démultiplication interroge donc l’habitabilité de la planète toute entière.
Des villes africaines laboratoires du futur
En Afrique de l’ouest, un nombre croissant d’initiatives cherche des alternatives à la ville de béton pour répondre à la fois à la demande de logements abordables et au besoin de confort thermique. Des nombreuses expériences sont conduites pour valoriser d’autres savoir-faire vernaculaires et des matériaux aux valeurs thermiques reconnues tels que la terre, le bois ou la paille.
Au Sénégal, l’entreprise ElemenTerre promeut la construction en terre grâce à l’utilisation du bloc de terre crue comprimée (BTC). L’Association Worofila propose quant à elle des constructions en terre et typha, cette plante invasive qui pousse dans les zones humides de la banlieue de Dakar. Dans la zone sahélienne, La Voûte Nubienne diffuse l’utilisation de l’adobe : cette technique originaire de Nubie, en Égypte, permet des constructions de terre en arcs et en coupoles pour couvrir les bâtiments sans utiliser de bois ou de tôle ondulée.
Le collectif Fact Sahel + est un autre réseau actif : il vise à fédérer des constructeurs, des architectes, des artistes et des étudiant.e.s africain.e.s et européen.ne.s qui explorent des méthodes de construction plus durables, notamment en terre. Sur les réseaux sociaux, plusieurs centaines de membres – en grande majorité originaires d’Afrique – envoient des photos de leurs chantiers, échangent sur les solutions techniques pour développer un secteur à faible émission de carbone, participent à des débats sur les alternatives au béton et font la promotion de matériaux de construction alternatifs.
À Lomé au Togo, L’Africaine d’architecture défend la possibilité d’une architecture « néo-vernaculaire » en exhumant le potentiel des principes anciens d’organisation spatiale comme la « fractale », qui reproduit des formes géométriques à différentes échelles, ou la « figure de gestation », qui renvoie au fœtus et à l’enfantement. Ces formes permettent de repenser l’habitat et plus largement l’éthique de l’architecture en temps de crise globale.
Pour l’instant, ces initiatives semblent dispersées et limitées à quelques individus. Mais l’émergence de ces réseaux et plateformes d’échanges pourrait rapidement changer la donne et donner une visibilité à ces alternatives écologiques. En outre, la reconnaissance internationale de l’œuvre de Francis Kéré marque une rupture majeure, notamment en matière d’enseignement de l’architecture.
À Lomé, l’École africaine des métiers de l’architecture et de l’urbanisme (EAMAU) propose désormais des cours sur l’architecture vernaculaire et les matériaux locaux. Kéré pourrait ainsi faire des émules et inspirer les nouvelles générations d’architectes. Mais les architectes ne peuvent insuffler le changement seul. Ils peinent à convaincre leurs clients de construire en terre, car ils trouvent que « la terre fait broussard ». Ce matériau est encore aujourd’hui trop souvent rattaché à des images négatives, lié au village et considéré comme non moderne.
Transformer le monde de la construction et les modes de faire suppose d’abord un réel portage politique pour inciter à la transition écologique, via des subventions. Mais cela nécessite également un changement de paradigme et d’imaginaires urbains.
Il est tout d’abord nécessaire d’appréhender les villes africaines autrement qu’à partir de dichotomies aujourd’hui obsolètes comme traditionnel/moderne. Prôner la redécouverte la construction en terre ne signifie pas retourner à des pseudo-racines « traditionnelles » et tourner le dos à ladite « modernité ». Il ne s’agit pas d’explorer avec nostalgie les modes de faire ancestraux. Au contraire, la redécouverte et la reconnaissance de l’architecture vernaculaire doivent être pensées comme des gestes ultra-contemporains, qui mettent au centre le souci d’habiter en commun.
Par conséquent, l’idée n’est pas de bannir le béton à tout prix mais d’en faire un usage plus rationnel. En parallèle, les villes africaines du futur pourraient intégrer des bâtiments en terre de verticalité moyenne, ouverts les uns sur les autres, permettant de maintenir les liens de voisinage. Ces villes du futur ne rejetteraient pas l’innovation technique et digitale. Au contraire, il est désormais possible de construire en terre grâce à l’impression 3D et donc d’explorer l’hybridation entre savoirs traditionnels, techniques et digitaux.
Mobilité, gestion des déchets et des ressources, économie, décisions politiques : les technologies pourraient rendre les villes plus intelligentes, durables et démocratiques mais à condition que ces technologies soient développées localement, par des fablabs par exemple, en fonction des besoins et non par les GAFAM en quête de nouveaux marchés. Elles ne s’inspireraient pas du principe capitaliste de la smart city, modèle de ville ultra-connectée et innovante au service du marché mais de l’intelligence collective des smart citizens, ces habitants qui pensent et produisent la ville ensemble à partir de leurs besoins et usages. Elles ne reposeraient pas sur la marchandisation des relations mais sur « l’ubuntisation », modèle qui s’inspire du concept d’Afrique centrale Ubuntu, qui désigne en langue bantou les liens d’humanité et de solidarité.
Les villes africaines pourraient ainsi ouvrir la voie à de nouveaux paradigmes urbains, à condition de mettre à distance les visions dystopiques qui les résument trop souvent à des espaces chaotiques et en retard. Elles peuvent et doivent être vues autrement, notamment comme des lieux d’innovation, dans la lignée de l’AfroFuturisme, ce courant artistique qui « combine science-fiction, techno-culture, réalisme magique et cosmologies non européennes, dans le but d’interroger le passé des peuples dits de couleur et leur condition dans le présent » (Achille Mbembe). Les films Black Panther et Wakanda Forever de Marvel, à travers les images de Birnin Zana, capitale du pays fictif du Wakanda invitent à imaginer cette ville de demain, à la fois bétonnée, végétalisée et technologisée.
•
Qu’elles soient fantasmées ou réelles, il est désormais certain que les villes africaines comptent, et pour beaucoup, dans l’avenir de la planète. Les bâtiments qui sortent de terre, l’architecture qui renaît et les relations sociales qui se tissent dans ces espaces urbains en pleine mutation sont peut-être les prémices d’une nouvelle « Afrotopia », comme le dit Felwine Sarr, c’est-à-dire une utopie qui prendrait l’Afrique comme point de départ. C’est bien ce que propose à son tour l’architecte et romancière ghanéenne et écossaise Lesley Lokko : elle a fondé à Accra la plateforme et l’école d’architecture African Futures Institute qui considère le continent africain comme « le laboratoire du futur ».
La nomination de Lesley Lokko comme curatrice de la Biennale d’architecture de Venise de 2023, tout comme la consécration de Francis Kéré, sont assurément des symboles forts. À l’évidence, en Afrique s’inventent d’autres modes d’habiter et d’autres manières de penser le monde, les relations humaines et l’environnement.
