Comment la délinquance a-t-elle vraiment évolué ?
La mesure de la délinquance, les débats qu’elle occasionne s’arrêtent souvent à des observations sur quelques mois, au mieux quelques courtes années. Cet enfermement dans le court terme est facilement trompeur : il donne une importance indue à des mouvements peu significatifs.
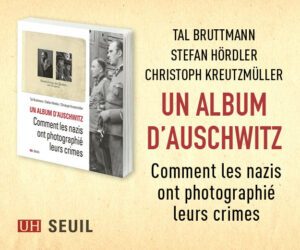
C’est particulièrement vrai à un moment où des changements des systèmes de mesure fragilisent les observations récentes. Il est donc utile de chercher à bâtir – puis à analyser – des observations de plus long terme. C’est l’objectif d’un Observatoire scientifique du crime et de la Justice développé au sein d’un laboratoire du CNRS (CESDIP – UMR 8183)[1].
Ainsi, on dit parfois : certes la délinquance patrimoniale diminue, mais la violence, elle, augmente.
Tentons de voir ce que vaut ce diagnostic.
Si l’on considère l’ensemble des vols et cambriolages, statistiques de police et enquêtes de victimation sont dans un rapport de 1 à 2, mais elles s’accordent à enregistrer une pente descendante depuis le milieu des années 1990, due à la diminution des atteintes aux véhicules plutôt qu’à l’évolution du nombre de cambriolages.
Toutefois cette évolution globale s’accompagne de deux réserves.
À partir de 1960, les comptages administratifs – seuls existants alors – suggèrent une forte poussée de la délinquance d’appropriation pendant trois décennies. On ne peut l’attribuer à un effet inflationniste de l’assurance-vol qui ne se généralisera qu’en fin de période, ni à une plus grande vigilance policière dont le taux d’élucidation s’effondre alors pour cette criminalité. Vraisemblablement, on a alors assisté à une explosion de la délinquance d’appropriation liée à l’entrée dans la société de consommation. Du coup, le mouvement ultérieur observé dans le dernier quart de siècle doit être relativisé : il n’est guère plus qu’une érosion en palier haut et le vol de tout poil demeure le risque le plus répandu.
Seconde réserve : le début du XXIe siècle voit certaines délinquances patrimoniales connaître une percée remarquable, témoin le débit frauduleux de compte bancaire qui tend à prendre la place d’infraction typique que le vol de voiture avait occupé pour la fin du XXe.
Quant à la délinquance violente, deux données émanées des comptages policiers sont évoquées pour affirmer son augmentation.
Les homicides et coups mortels y croissent depuis 2010, mais c’est dû seulement aux tentatives qui ont cessé d’évoluer – comme précédemment – en parallèle des homicides consommés. Ces derniers, eux, restent au contraire à l’étiage. Quelle explication à cette énigme ? Peut-être une tendance à user plus systématiquement de la qualification la plus élevée possible, à qualifier de tentative d’homicide ce qui l’aurait été naguère en coups et blessures (CBV)…
Y croit également la statistique des coups et blessures qui compte les délits, mais pas les contraventions. Jusqu’en 1981, on n’y dénombrait que les cas où la victime avait subi une incapacité de travail (ITT) de plus de huit jours. Mais, depuis, une bonne vingtaine de lois sont venus transformer en délits des agressions de moindre gravité soit pour afficher une réprobation particulière de certains comportements soit pour témoigner d’une sollicitude spéciale pour certains professionnels ou certaines personnes vulnérables.
À l’échelle nationale, la violence physique demeure à un niveau globalement bas, mais des zones échappent à ce diagnostic d’ensemble.
Du coup, la statistique policière ne compte plus du tout la même chose en 2022 qu’en 1980. La statistique judiciaire en témoigne : la part des agressions ayant entraîné une ITT de plus de 8 jours ne représente plus maintenant que le cinquième des condamnations pour délits de CBV. Quant aux enquêtes de victimation, elles ne montrent pas de tendance nette à la croissance des agressions ayant entraîné une ITT de plus de 8 jours ni même de l’ensemble des agressions physiques[2].
Mais là aussi le diagnostic doit s’accompagner de quelques réserves.
D’abord le niveau élevé de multivictimation des violences physiques laisse à penser que les populations exposées le sont à répétition.
Ensuite des enquêtes locales réalisées en 2005 avaient laissé voir des taux locaux d’agression bien plus élevés dans certaines zones, notamment en proche banlieue parisienne nord-est. Et il semble bien que ces survictimations se soient perpétuées dans le temps. Certaines zones s’écartent donc du diagnostic d’ensemble. Celles à forte distribution de stupéfiants représentent un cas topique. La prohibition de leur usage a permis la mise en place d’un véritable « marché » à rentabilité élevée. Une concurrence rude s’est dès lors installée pour son contrôle avec d’importantes poussées de violence.
Mais dans un pays centralisé où l’on rappelle sans cesse que les questions de sécurité sont de compétence étatique, on a plus de chances de retenir l’attention en affirmant de manière indifférenciée que la violence augmente. Et cette tendance globalisante est renforcée par l’adoption de l’insécurité comme message d’identification par l’extrême-droite, mais aussi de plus en plus par le ralliement d’autres forces politiques. Le procédé n’a aucun rapport avec l’évolution de la délinquance ; il consiste à présenter périodiquement un horrible mais rarissime fait divers comme la représentation exacte de l’ensemble de la criminalité. Des réseaux sociaux et surtout certaines chaines d’information sont spécialisés dans le blanchiment de ces messages incendiaires. En cas de succès, l’univers médiatique se sent obligé d’embrayer, et le monde politique avec.
Reste à comprendre l’écho que ces alarmes à l’insécurité rencontrent dans une partie de la population : c’est que le sentiment d’insécurité ne se réduit pas seulement à la peur du crime, à l’appréhension d’être atteint, soi ou les siens, par la criminalité ; il comprend aussi une autre facette, la préoccupation sécuritaire, qui proclame la gravité de ce problème de société, quand bien même on ne sentirait pas personnellement menacé[3]. Cette crispation sécuritaire se cristallise sur la criminalité mais la dépasse largement.
Si la première facette dépend de l’exposition au risque combinée avec la vulnérabilité que l’on ressent, la seconde exprime la crainte de la précarité, de n’avoir pas les moyens de s’adapter à un avenir menaçant. Alors que la peur du crime reste stable dans le temps, la préoccupation sécuritaire s’enflamme périodiquement pour revenir ensuite, plus ou moins vite, à son niveau de référence, autour du sixième de la population.
Enfin la statistique policière enregistre ces dernières années une hausse (modérée) des agressions sexuelles ou commises par un proche… on y lit vraisemblablement un effet de la « déprivatisation » de ces violences – dans la foulée de MeToo – qui incite les victimes à dénoncer un peu plus aux autorités publiques des crimes généralement survenus dans la sphère privée.
Au total, la délinquance d’appropriation est sur une pente descendante depuis un quart de siècle, mais il s’agit plutôt d’une érosion en palier haut de ce qui reste le risque le plus répandu ; pour autant de nouvelles délinquances patrimoniales – témoin les débits frauduleux – se développent à vive allure.
À l’échelle nationale, la violence physique demeure à un niveau globalement bas, avec cependant des zones qui échappent à ce diagnostic d’ensemble, notamment dans les quartiers à forte distribution de produits prohibés. Tout cela est sans beaucoup de rapport avec les joutes politico-médiatiques périodiques sur l’insécurité.
Enfin le recours aux institutions pénales est un peu moins rare pour la délinquance de l’espace privé (violences entre proches, violences sexuelles).
Ceci dit, ce diagnostic concerne l’évolution de la criminalité à victime directe (vols, agressions…). On est bien plus désarmé pour mesurer la délinquance sans victime ou sans victime directe. Pour ce type d’affaires, les statistiques de police n’enregistrent le plus souvent que les cas ayant entraîné une suite positive, une élucidation. Les enquêtes de délinquance autoreportée ne se sont développées qu’en matière d’usage de stupéfiants. Et le bloc des atteintes aux finances publiques ne pourrait être saisi que par des évaluations économiques, mais on ne perçoit aucune envie des responsables de mobiliser les (rares) économistes qui ont travaillé ce thème.
