Comment faire de la liberté scientifique un bien public
La longue incarcération en Iran de Fariba Adelkhah, qui vient de retrouver la liberté après plus de trois ans dans la prison d’Evin, a une fois de plus souligné la grande précarité des chercheurs confrontés à un contexte autoritaire. Cette heureuse libération intervient après trois ans de mobilisation exemplaire de la part de son comité de soutien, trois ans de veille médiatique, trois ans d’action diplomatique… mais surtout après que l’ayatollah Khamenei a souverainement décidé d’accorder sa grâce à des milliers de prisonniers arbitrairement arrêtés, comme il a l’habitude de le faire à l’occasion des principales fêtes religieuses ou nationales.
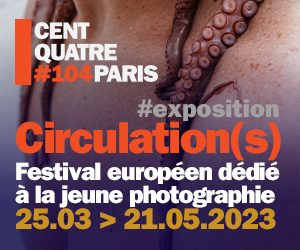
Les pressions venues de France ont-elles joué un rôle dans sa libération ? Nous ne le savons pas. Les chercheurs ont-ils des raisons de se sentir mieux protégés quand ils travaillent dans des contextes hostiles ? Certainement pas. L’emprisonnement de Fariba Adelkhah a-t-il suscité une émotion collective en France, au-delà de la communauté académique ? Que non. Le grand public sait-il ce que sont les libertés académiques (ou, c’est peut-être plus parlant, la liberté scientifique) et est-il prêt à s’indigner, pétitionner voire défiler en soutien à des chercheurs en péril ? Probablement pas.
Et c’est un problème. Car au-delà des cas les plus emblématiques, comme celui de Fariba Adelkhah, les libertés académiques – soit le fait de pouvoir librement, en tant que chercheur, chercher, enseigner et exprimer des points de vue critiques, connaissent de dangereuses remises en cause dans un nombre croissant de pays. Pour les protéger durablement, l’acteur décisif n’est, outre l’universitaire, ni l’État, ni le régime politique, même si elle passe par leur truchement ; il s’agit du public. L’enjeu de constituer la science en bien public et de considérer la liberté scientifique comme valeur collective apparaît en effet de plus en plus nécessaire.
La diffusion de ce que certains ont appelé la pensée unique alors que triomphait, il
