Se défaire de nos pétrofictions
Dans « La pompe à essence », une nouvelle parue en 1974, Italo Calvino relevait qu’en faisant le plein à la pompe, il était possible de vivre en même temps l’ascension, l’apogée et le déclin des sociétés modernes. À l’époque, Calvino s’inquiétait du pic pétrolier et de l’épuisement des réserves.
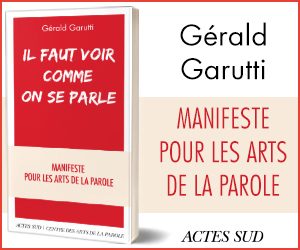
Aujourd’hui, c’est le dérèglement climatique qui nous glace d’effroi. Le pétrole qui s’échappe en fumée est devenu menace céleste, sécheresse, pluie diluvienne, fleuve qui s’assèche, glacier qui s’effondre.
À l’exception des esprits déboussolés (obsédés par la validité des constats du GIEC), et des cyniques (bien décidés à profiter de la manne pétrolière jusqu’au bout), l’humanité du XXIe siècle sait qu’elle se trouve face à un chantier colossal et intimidant : construire un nouveau système énergétique où les énergies carbonées, qui composent encore plus de 80 % du mix énergétique mondial, seront réduites à leur portion congrue. L’habitabilité même de notre planète est en jeu.
Dans le débat public, l’attention se focalise sur les aspects techniques de cette transition. Ils ne suffisent pas : démanteler le système fossile passera aussi par un gigantesque travail de déconstruction culturelle, de réajustement de nos subjectivités, ou encore, pour reprendre la belle expression de Camille de Toledo, de réinvention de nos habitats narratifs.
Car le pétrole imbibe tellement nos vies qu’il n’a pas seulement façonné nos paysages et nos modes de vie, la manière dont nous nous déplaçons, mangeons et consommons ; il s’est aussi emparé de nos imaginaires pour nous constituer en sujets pétroliers. Étrangement, nous peinons à le voir. Comme l’écrit Jean-Christophe Cavallin dans Valet noir (José Corti, 2021) : « nous court-circuitons le monde, et au volant d’une voiture, prenons la vitesse pour notre vitesse, la mobilité comme une évidence, sans jamais penser au pétrole. Nous pensons au prix de l’essence mais jamais au pétrole ni à ses infrastructures, ni à quoi ressemble vraiment la planète anthropisée dont il entretient la fiction. L’évidence de notre quotidien est spéculative. Elle est une spéculation sur l’éternité de l’essence. »
Alors que la nécessité de basculer dans une nouvelle ère énergétique se fait de plus en plus pressante, il faut sortir de cette myopie culturelle, élargir la focale et voir le pétrole pour ce qu’il est : une machine à fictions, qui nous a donné l’illusion qu’il était possible de nous affranchir des limites terrestres et de vivre hors-sols.
À la suite de l’invitation de Bruno Latour, il est temps de nous souvenir que « nous n’avons pas d’autre demeure qu’ici-bas, dans l’étroite planète », que nous sommes les résidents d’une bande atmosphérique de quelques kilomètres de haut, un espace minuscule entre terre et ciel aux instables équilibres chimiques, où la vie terrestre, sous sa forme actuelle du moins, joue son destin. L’heure est au détricotage des anciens récits, ceux qui projetaient loin, dans l’espace, dans un univers détaché du substrat matériel de nos existences. Des récits précisément entretenus par le pétrole, ce concentré d’énergies résultant d’un lent travail de digestion souterrain d’un plancton vieux de millions d’années.
Les conditions dans lesquelles s’exercent la démocratie dans les pays occidentaux sont largement tributaires des énergies carbonées, et de la manière dont on les exploite et distribue.
Avec ce paradoxe : si le pétrole est une machine à fictions, qui a structuré en profondeur notre paysage moderne, à la fois intime et collectif, il a lui-même généré peu d’identités, de discours et de représentations. « Vu le rôle central joué par les énergies fossiles, il est surprenant qu’elles n’occupent pas une plus grande place dans les histoires que nous nous racontons à propos de nous-mêmes, sujets modernes », observe Imre Szeman dans un entretien qu’il m’a accordé récemment. Ce professeur à l’université de Toronto est une des figures pionnières d’un champ académique particulièrement dynamique Outre-Atlantique, les humanités énergétiques (energy humanities), qui s’est construit sur un double mouvement : « il cherche à la fois à expliquer ce manque d’attention pour les énergies fossiles dans nos histoires culturelles, sociales et politiques, et à combler cette absence avec un travail de mise en récit où leur importance est mise en évidence », raconte le chercheur.
Ce déplacement épistémique a donné lieu à des travaux tels que ceux de Timothy Mitchell, historien, anthropologue, et spécialiste du Moyen-Orient. Dans Carbon Democracy (La Découverte), il montre que les conditions dans lesquelles s’exercent la démocratie dans les pays occidentaux sont largement tributaires des énergies carbonées, et de la manière dont on les exploite et distribue.
Elle n’est pas un régime politique qui peut être répliqué telle une simple « copie carbone », une abstraction transportable dans un attaché-case pour être présentée dans un powerpoint, comme l’ont fait tant d’experts américains en Irak, note Mitchell. Elle est indissociable de l’autoritarisme des pétromonarchies moyen-orientales, car les pays occidentaux, même s’ils se trouvent souvent à l’autre bout du pipeline, sont aussi des États pétroliers. Dans Petrofiction: The Oil Encounter and the Novel, un court essai qui a fait date, Amitav Gosh relevait déjà cette absence de pétrole dans les territoires de la fiction américaine, et en particulier, sur ce qu’il a produit au Moyen-Orient, région qui a pourtant une influence significative sur l’histoire et la géopolitique états-uniennes.
« Pourquoi, alors qu’il y a tellement à écrire sur ce sujet, la grande rencontre avec le pétrole a-t-elle été si stérile sur le plan de l’imaginaire ? » s’interroge Amitav Gosh, qui dans ce texte invente le terme fécond de « pétrofiction ». Cette question lui est inspirée par l’écriture de son propre roman, The Circle of Reason, dont l’action se situe dans un pays fictif du Golfe arabo-persique. L’écrire, raconte-t-il, lui a fait prendre conscience de la façon dont le pétrole échappe aux techniques familières de la fiction. « Le pétrole résiste à la forme en cinq actes », avait déjà constaté Bertolt Brecht en 1929. Mais la « pétrofiction », finalement, n’est-elle pas la substance même de tout roman moderne ? « Tout écriture moderne repose à la fois sur la promesse et sur les coûts et bénéfices cachés de la culture du pétrole. Si cette proposition semble grossière – et même grotesque – cela vaut tout de même la peine de penser que la domination du pétrole dans la modernité signifie qu’il se trouve partout dans la littérature, et pourtant nulle part, suffisamment raffiné pour être ramené à la surface de chaque texte », rappelle Graeme McDonald, professeur de littérature à l’université de Warwick.
Filant la métaphore fossile, ce chercheur invite une nouvelle génération de « pétrocritiques » à extraire cette matière à penser et à la tirer de son invisibilité.
L’essai de Gosh s’intéresse à l’un des rares romans à avoir imaginé la rencontre des bédouins avec le pétrole dans la péninsule arabique. Monument de la littérature arabe moderne, Villes de sel d’Abdul Rahman Mounif (seul le premier tome est traduit en français, chez Actes Sud) place le basculement vers l’ère pétrolière sous le signe de la violence et de l’aliénation. Comme un écho à Pétrole, « roman-monstre » de Pier Paolo Pasolini, qui met en scène Carlo, un manager de l’ENI, le groupe pétrolier italien, acteur majeur du développement de l’Italie d’après-guerre. Pour Pasolini, le pétrole est un noyau de sens autour duquel s’agrège une critique radicale du présent, de la société italienne, comme l’analyse le philosophe italien Federico Luisetti dans un article pour AOC. Il existe d’autres auteurs qui se sont directement saisis du pétrole dans leur écriture, mais ils ne sont pas légion. Citons, liste non exhaustive, Oil!, d’Upton Sinclair, plusieurs textes de Ken Saro-Wiwa, écrivain nigérian du peuple Ogoni qui luttait contre l’extraction pétrolière dans le delta du Niger et qui fut exécuté par le régime dictatorial de Sani Abacha en 1995, Pétroleum, de Bessora, ou encore le roman d’anticipation de Dalibor Frioux, Brut (Seuil), qui, depuis la Norvège, imagine la place du pétrole dans une société qui veut être à la fois riche et vertueuse.
Si les réflexions d’Amitav Gosh sur la pétrofiction ne sont pas fondatrices des humanités énergétiques, elles ont toutefois eu une grande influence sur ce champ interdisciplinaire où se côtoient anthropologues, philosophes, historiens, politologues, sociologues ou spécialistes de la littérature, qui citent souvent ce texte court comme une référence. En 2012, ces chercheurs ont organisé leur première conférence sur le thème des « Pétrocultures », en Alberta, où Imre Szeman enseignait précédemment.
Les sables bitumeux n’étaient pas loin, et il était impossible de ne pas les prendre en compte dans nos recherches académiques, commente-t-il. Depuis, le champ des humanités énergétiques ne cesse de prendre de l’ampleur, avec une vitalité dont témoigne l’édition de plusieurs ouvrages collectifs : Petrocultures : Oil, Politics, Culture (McGill-Queen’s University Press, 2017) ; Energy Humanities : An Anthology (John Hopkins University Press, 2017), et plus récemment Oil Fictions, World Literature and Our Contemporary Petrosphere (Penn State University Press, 2021).
« Cet intérêt intervient à un moment où le monde des énergies fossiles se défait, où nous entrons dans une nouvelle relation à ces énergies », poursuit Imre Szeman. « L’enjeu, ici, est donc aussi d’intervenir dans les récits sur la société post-pétrole, pour qu’ils ne mettent pas seulement en scène un simple jeu de substitution, de remplacement d’une énergie par une autre, ce qui est aujourd’hui la façon dont la transition est souvent représentée dans les discours médiatiques, politiques et économiques. Nous pouvons être dans une société dominée par les énergies renouvelables, même si j’ai des doutes à ce sujet, et rester des sujets fossiles, comme le propose la voiture électrique. Car nous sommes des créatures avec d’incroyables besoins énergétiques. » « C’est pourquoi se saisir de ce moment de transition comme d’un enjeu de narration et d’imagination peut ouvrir des perspectives révolutionnaires », ajoute-t-il.
En témoigne l’irruption de Donald Trump, qui a conquis son électorat en faisant revivre une Amérique fantasmée où règne une existence basée sur l’abondance de combustibles bon marché.
C’est dans ce contexte qu’il faut situer le travail de Cara Daggett, professeure en sciences politiques à l’Université Virginia Tech. Les éditions Wildprojet ont publié, en janvier 2023, trois articles écrits par la chercheuse entre 2018 et 2020. Réunis sous le titre de Pétromasculinité, ils questionnent les fondations des « pétrocultures » occidentales à partir d’une grille de lecture féministe. La question du récit, et de l’imaginaire, est centrale dans ces essais, car rappelle la chercheuse, « le mythe fossile a pour effet général de dépolitiser l’intensification énergétique qui s’est déroulée tout au long de l’histoire humaine. »
À la suite de Timothy Mitchell, elle appelle à écrire une contre-histoire des mutations énergétiques, à rebours du mythe qui voudrait que les transitions soient le fruit d’une « évolution naturelle » guidée par le progrès technologique. Au contraire, souligne-t-elle, elles sont le résultat d’« innovations politiques qui permettent à une poignée d’acteurs d’organiser et d’extraire le travail des autres humains. »
Dans un de ces textes, Cara Daggett se penche sur les ressorts du fascisme climatique, notant que « si les populations tiennent si fermement aux combustibles fossiles, au point de s’engager dans l’autoritarisme, c’est que ces énergies confrontent aussi des significations culturelles et des subjectivités politiques. » Ces subjectivités sont liées à l’ordre patriarcal blanc, qui entretient avec l’énergie fossile « une relation à la fois technique et affective, idéologique et matérielle » : ce qu’elle nomme « pétromasculinité ».
En témoigne l’irruption de Donald Trump dans la politique américaine. L’homme d’affaires a conquis son électorat en faisant revivre une Amérique fantasmée où règne le quasi plein emploi des hommes blancs, à même de subvenir aux besoins de leur famille, une existence basée sur l’abondance de combustibles bon marché dont on veut encore se persuader de l’innocence. L’autoritarisme, avance-t-elle, n’est pas une dérive, ni une menace tapie dans l’ombre, mais bien « la substantifique moelle d’une vie contemporaine qui s’affirme à travers la combustion d’énergies fossiles. »
Et d’appeler, à son tour, à ne pas se faire confisquer le scénario de cette transition énergétique, pour que « la décarbonation de nos approvisionnements énergétiques puissent fournir des opportunités de développer des modes de vie socialement plus justes, qui placeraient les intérêts des personnes les plus exploitées […] au cœur des politiques de transition énergétique ». Au-delà de la fable qui voudrait qu’il n’y ait que deux alternatives – continuer à croître ou retourner à l’âge de pierre –, Cara Dagget s’attèle, au sein du collectif de transition énergétique Mayapple, à jeter les bases de systèmes énergétiques féministes, dont le troisième article du livre dessine les contours politiques, économiques, socioécologiques et technologiques. Des systèmes où existeraient de multiples façons de concevoir l’énergie et de vivre avec elle. Des systèmes pluralistes, démocratiques, décentralisés, relationnels et pas forcément anti-technologiques, débarrassés du mirage de la croissance continue, et de l’idée qu’elle serait source de bien-être.
Leurs propositions sont à retrouver dans cet ouvrage qui en lieu et place d’une fiction marchande et dépolitisée ouvre un espace d’utopie féministe qui stimule l’imagination et convoque d’autres devenirs.
