Le nomadisme, un « exode urbain » invisibilisé ?
« Nous sommes tous aliénés. »
H. Lefebvre, 1940
Contrairement au cadrage médiatique dominant de l’« exode urbain » (un terme lui-même hautement problématique) depuis la pandémie de Covid-19, les cadres en télétravail (dont le style de vie reste ancré en ville) et les ménages disposant des ressources pour assurer leur « transition rurale » (en se lançant dans l’agriculture, l’artisanat, le tourisme etc.) ne sont pas les seuls groupes tentés par un départ hors des grandes villes. On observe ainsi depuis quelques années un « renouveau » de certaines campagnes déshéritées par l’exode rural – ce dernier constituant un processus historique bien réel, qui a modelé l’espace français et conduit à l’émergence de la « diagonale du vide ». Enclavés et pauvres, ces espaces restent peu attractifs pour les actifs bien insérés dans l’économie de services. En revanche, ces mêmes caractéristiques les rendent intéressants pour d’autres catégories de populations. Mais ces flux, qui semblent avoir augmenté depuis la pandémie, sont complètement passés sous les radars des médias.
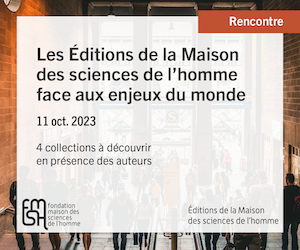
Co-animateur d’une étude menée en temps réel pour faire le point sur cet « exode urbain », j’étais bien placé pour mesurer ce décalage : les premiers retours de terrain ne laissaient guère voir la vague annoncée de cadres en télétravail ou de néo-ruraux capables de s’acheter une maison ou un terrain pour y développer une nouvelle activité ; en revanche, j’ai rapidement remarqué que dans mon quartier de résidence (un quartier mixte péricentral de Montpellier), plusieurs de mes voisins et connaissances étaient tentés, à l’issue du confinement, d’opter pour un changement de vie radical en achetant un van aménageable. Des ateliers collectifs ont été organisés, qui réunissaient jusqu’à une centaine de personnes. Bien organisés, ils évoquaient différents aspects concrets liés au déménagement hors de la grande ville : comment accéder à un terrain à cultiver, comment constituer un collectif, quel rapport aux institutions, quel montage financier et forme juridique, etc. Bref, selon l’un des organisateurs, l’objectif était de permettre la rencontre de gens à différentes étapes de leur projet, et de « créer une communauté de savoir et d’information ».
Nombre des participants à ces ateliers n’ont finalement pas franchi le pas. Certains parmi eux, toutefois, l’ont fait. C’était notamment des trentenaires, non propriétaires, non-salariés, diplômés et sans enfants, et qui ont concrétisé leur nouveau projet de vie par l’achat et l’aménagement d’un camion, prélude à un départ de la grande ville pour une région de moyenne montagne. Cette forme silencieuse de « grande démission » m’a particulièrement intéressé car elle repose sur un triple renoncement : quitter une activité, quitter la ville, et enfin quitter la sédentarité. Autrement dit, il s’agit d’une transition existentielle totale. Certes, la vie en camion a été récemment médiatisée par le film Nomadland, qui décrit un nomadisme contraint par la crise économique américaine de 2008. Mais dans le cas des personnes que j’ai rencontrées, la décision était davantage – mais pas intégralement – choisie. Même si les chiffres de ces migrations sont évidemment introuvables, on note une forte augmentation de la vente de véhicules aménagés d’occasion en France sous l’effet de la pandémie de Covid-19 ; par ailleurs, l’augmentation de ces départs pour une vie nomade m’a été confirmée par des élus des villages de prédilection de ces populations.
J’ai ainsi réalisé plusieurs récits de vie à Montpellier, avec différentes personnes, avant leur départ en van aménagé. Mon objectif n’est pas de proposer ici une analyse sociologique, qui aurait nécessité un dispositif méthodologique d’une toute autre ampleur, mais simplement de proposer quelques éléments de réflexion sur ce qui m’apparaît comme une bifurcation bien différente de celle, fortement médiatisée, des diplômés des grandes écoles. Cette transition existentielle, survenue chez des profils moins insérés et à un âge plus tardif, est d’autant plus silencieuse que ces personnes développent fréquemment une méfiance des médias et, plus généralement, de la parole publique – une méfiance (mais non un complotisme) à leurs dires encore accrue par la pandémie, sa gestion politique, et son traitement médiatique. Tout ceci s’est donc cristallisé durant le premier confinement, qui a débouché sur leur départ hors de la ville. Pourquoi ce moment ?
Il est possible d’envisager le confinement comme une rupture brutale dans l’accélération généralisée qui caractérise la modernité, et qui s’incarne particulièrement dans la grande ville. Or cette accélération, qui concerne l’ensemble des activités sociales (du travail jusqu’à la vie affective), débouche fréquemment sur un sentiment de dépossession, de perte de sens, bref, d’aliénation. Plus précisément, l’aliénation désigne un sentiment d’impossibilité de déployer ses potentialités, un assujettissement et une forme d’étrangeté (à soi-même ou au genre humain). Concept clé de la critique du travail industriel, l’aliénation n’a pas disparu avec la généralisation (dans les pays des Nords) de l’économie de service. Bien au contraire, celle-ci s’incarne dans de nombreux facteurs : précarisation de l’emploi et donc de l’existence, sentiment d’inutilité sociale du travail, intensification de ce dernier en raison de la numérisation et des techniques managériales déshumanisantes (comme le dit l’un de mes enquêtés, « ce qui est difficile est de faire un travail redondant et absurde, et le lien de subordination »), prolétarisation des métiers des services, bureaucratisation, politiques d’austérité silencieuse qui conduisent les actifs à prendre à leur charge les fonctions « coupées » car jugées improductives etc. Aux États-Unis, la montée du populisme et l’élection de D. Trump sont ainsi fréquemment interprétées par les géographes et les sociologues comme résultant en partie de l’aliénation croissante des couches populaires des espaces en déclin.
Pour plusieurs des nouveaux habitants qui se sont installés dans les Cévennes, le premier confinement a fourni une pause qui a révélé cette aliénation au travail. Par exemple, plusieurs des enquêtés étaient des travailleurs des services publics (infirmiers, instituteurs) qui ont démissionné à la suite de burn-outs. Mais l’aliénation ne s’arrête pas aux portes de l’usine ou du bureau. Comme le montraient déjà Henri Lefebvre et les situationnistes, la « colonisation de la vie quotidienne » et l’extension sans relâche des relations marchandes finissent par dégrader la sphère intime des individus. S’y ajoutent désormais les conséquences de la polycrise globale accentuée par la pandémie : érosion continue des services publics par la néolibéralisation, perte de confiance dans les institutions, crise économique, sociale et démocratique, et enfin sentiment d’impuissance et d’anxiété face à la dégradation accélérée de la planète. Dans de nombreux cas, le départ pour des espaces ruraux en déclin après le confinement résulte d’une prise de conscience de l’aliénation à l’occasion de la mise à l’arrêt brutal de la « ville comme machine à mobilité » provoquée par le premier confinement. Pour autant, cette réflexivité induite par la « pause urbaine » prend des formes évidemment différentes.
Le sentiment d’aliénation s’incarne par un rejet de la grande ville et une vision utopique des espaces délaissés de moyenne montagne.
Cette trentenaire, avec laquelle j’ai discuté peu après son achat d’un camion, a par exemple transité par une obsession de l’alimentation. Ce cheminement n’est guère surprenant : depuis plusieurs années, on note parmi les citadins des pays industrialisés une montée du rejet du régime agro-alimentaire dominant, un sentiment de dépossession provoqué par le système impersonnel de normalisation des aliments, et des tentatives conséquentes de réappropriation collective via une reconnexion avec la production (mouvements Cittaslow, Transition towns, AMAP, coopératives de consommation etc.). Pour certains, le confinement a simplement accéléré la prise de conscience d’une forme d’aliénation alimentaire, et a, en retour, radicalisé leur réaction.
Ainsi, cette personne (qui a depuis quitté la ville en van aménagé) établit un lien direct entre l’ingurgitation de produits difficilement traçables et celle d’une information et plus généralement d’une parole publique peu fiables : « Je voulais savoir ce que je mets dans mon corps de la même manière que je veux connaître ce que je mets dans ma tête par rapport aux médias […]. Tout est aligné. La pandémie a accéléré ça. Sinon on était distraits tout le temps. Mais enfermée toute seule chez moi je n’avais que ça à faire. […] J’ai été profondément choquée par tout ce qui se passe au niveau politique, social. » Pour cet autre récent propriétaire d’un camion, rencontré juste avant son départ, le confinement a plus généralement accru le sentiment de méfiance envers l’État : « Pendant le premier confinement, j’ai réalisé qu’on ne pourrait pas compter sur l’intelligence collective face à la panique. J’ai aussi réalisé que le blocage économique ne suffira pas, car ils ont appuyé sur un bouton et réinjecté de la monnaie, donc ça tient toujours. J’ai aussi appris que je ne pouvais pas compter sur l’État pour garantir ma protection […]. Je trouve ça aussi dans mon réseau social. Il y avait déjà de la méfiance, mais beaucoup se sont radicalisés. Ce sont des gens qui se retirent du système, de leur cursus d’études, de leur travail, et qui essaient de vivre sans, de lutter contre le système, ou de s’en affranchir, de s’en émanciper, ce que je fais maintenant. Ce monde-là n’est pas à protéger, mais à détruire, puisqu’il détruit la vie. »
Une fois conscientisé, le sentiment d’aliénation se voit ensuite spatialisé. Il s’incarne plus précisément par un rejet de la grande ville et une vision utopique des espaces délaissés de moyenne montagne. Ce type de réponse n’est pas si nouveau, mais il est favorisé par la diffusion de publications hostiles aux grandes villes depuis quelques années. Mû par des raisons écologiques ou d’émancipation, ce « retour à la terre », qui puise ses racines dans le romantisme, ne s’est véritablement concrétisé que dans la foulée de Mai 68 (il est donc beaucoup plus récent que l’urbaphobie réactionnaire réactualisée par une partie de la presse à l’occasion du déferlement sur l’ « exode urbain », qui date, elle, du XIXe siècle). Ce mouvement a débouché sur plusieurs vagues de néo-ruraux, dont la dernière, selon la sociologue Catherine Rouvière, relève de deux catégories : les « civiques » (engagés dans des démarches d’installation compatibles avec l’écologie mainstream) et les « pirates » (proches des mouvements libertaires et qui par choix ou contrainte prennent leurs distances avec le cadre réglementaire). Ce sont donc ces derniers, qui à la différence des premiers sont très peu présents dans le débat public, qui constituent l’objet de ce texte.
La critique sociale, dans l’ensemble, développe historiquement une vision dialectique de la ville, qui apparaît à la fois comme un espace d’aliénation (car il s’agit du terrain de jeu favori du capitalisme) mais aussi d’émancipation (car elle favorise la rencontre, la prise de conscience d’intérêts communs, et l’émergence de mouvements transformateurs). Les personnes avec qui j’ai pu discuter avant leur départ en camion sont généralement proches de ce courant. Mais la fermeture des villes a rendu insupportable non seulement l’isolement, mais aussi le sentiment de déconnexion avec la nature. C’est la raison pour laquelle selon ces personnes, politiser le renoncement a in fine pris la forme d’une fuite, individuelle et collective, hors de la grande ville, de ses atouts et de son confort : « Le confinement accélère les projets. On a la culture, le social, le bien être, le boulot etc. Donc c’est facile de laisser passer le temps pour profiter de la vie en ville. Mais quand on ne peut pas profiter de ces choses-là on se retrouve face à ce qui est important. Or là il n’y a plus rien à profiter de la ville. Il n’y a que du béton, du goudron, on étouffe. Même à la plage il y a trop de monde. »
Pour d’autres, les raisons sont plus explicitement politiques. Pour reprendre la terminologie de Henri Lefebvre, la grande ville dans son intégralité en est venue à apparaître, toujours à l’occasion du premier confinement, comme un « espace dominé » (un espace verrouillé par le pouvoir politique) dans lequel l’autonomie, et donc l’émancipation, seraient par essence impossibles – contrairement à ce qui leur apparaît comme des « espaces appropriés » (des espaces naturels adaptés au besoin d’un groupe): « La ville est violente, avec les publicités partout, les interactions difficiles, il faut toujours payer un truc… […]. Pendant le confinement il y a eu comme un mouvement de panique, ou tout le monde s’est dit on va à la campagne. Mais beaucoup se sont ravisés au cours du temps, ils ont retrouvé le confort de la ville. Mais je pense que ça a planté des graines. Car les gens ont changé, ils ont un autre regard sur la ville. […] Aujourd’hui j’ai plus l’envie de m’affranchir de ce monde-là, de développer mon autonomie énergétique, d’être mobile, de m’inscrire dans une dynamique éco-citoyenne, dans les Cévennes. Je n’irai dans aucune grande ville. Parce que l’erreur est urbaine (rires). »
Si pour ces personnes, la ville en vient à symboliser l’espace d’aliénation par excellence, alors le camion concrétise le rêve d’émancipation. Il permet l’autonomie énergétique (par l’installation de panneaux solaires) voire favorise l’autonomie alimentaire (l’un de mes enquêtés a ainsi équipé l’arrière de son camion d’une extension translucide lui permettant de cultiver quelques fruits et légumes). Mais la concurrence est rude : « quand tu vois une annonce, il faut y aller, car le camion est vendu en trois heures. Beaucoup de gens comme moi cherchent à acheter un van et à l’équiper. Et ça emmerde ceux qui vivaient comme ça avant. Moi je dis que c’est un bon signal, il faut qu’un maximum de gens vivent comme ça. Il y a même pas mal de bobos poussés par la peur ou par une perte de sens de ce qu’ils faisaient en ville, qui se sont mis dans cette voie. »
L’un des enquêtés s’en tire pour moins de 4 000 euros, pour un camion d’occasion équipé d’un panneau solaire. D’autres déboursent jusqu’à 15 000 euros. Certains empruntent à leur famille, certains vendent leurs biens, certains héritent. Ici apparaît un autre avantage du camion : il peut contribuer à l’autonomie financière. Comme me l’a expliqué un enquêté (qui vit du RSA complété de quelques journées mensuelles de travail au noir), « cela faisait un moment que je voulais un camion pour en tirer des revenus, en faisant des déménagements. »
La vie nomade n’est généralement perçue que comme une étape provisoire dans le processus d’identification d’un espace approprié. // Vivre provisoirement de manière nomade tout en amassant des ressources économiques, sociales, voire politiques, est ici conçu comme une manière de contourner l’impossibilité d’envisager directement la transition rurale
Une fois le diagnostic, urbain donc, posé, la solution est également spatiale : celle d’espaces de faible densité, enclavés, faiblement anthropisés, dans lesquels il semble possible de déployer une vision de l’émancipation conçue comme appropriation, parce que leur déclin les rend précisément peu stratégiques aux yeux de l’État et des grandes entreprises (Pyrénées, Massif Central). Une telle vision marque évidemment une profonde rupture avec la vision propriétariste et/ou identitaire déployée par une large part de la presse nationale durant sa promotion de l’ « exode urbain ».
Plus généralement, elle prend ses distances avec la définition négative de la liberté qui caractérise l’imaginaire occidental depuis deux siècles, et formule une vision en matières d’autonomie, impulsée par des penseurs anti-productivistes dans les années 1970 (A. Gorz, H. Lefebvre, H. Marcuse, I. Illitch, M. Bookchin, C. Castoriadis…) et réactualisée par la crise climatique et écologique. Par exemple, selon l’un des enquêtés (un récent détenteur de camion, qui venait de mettre son appartement détenu par un marchand de sommeil en sous-location avant de quitter la ville), que je relançais sur sa perception de l’effondrement : « les dominants n’ont pas produit d’autres récits que l’apocalypse. Mais elle est peu crédible au vu de la diversité des situations. L’effondrement est déjà en cours, sur les ressources et la biodiversité. Le monde qui me semblerait à la hauteur des enjeux est un monde relocalisé, où on cultive non pas l’interdépendance entre les territoires mais l’indépendance alimentaire et énergétique, et où la politique est régie sur le modèle anarchiste. Et donc, avec des règles décidées par ceux qui en sont sujets. Un peu comme ce qu’ont fait les gilets jaunes, à l’Assemblée des assemblées. »
Si mes enquêtés s’apprêtaient à partir individuellement, leur horizon d’autonomie est pensé de manière collective. Ils fonctionnent en réseau : « J’ai des amis qui vivent en camion, que j’ai rencontré en manifestation, à l’université, en festival, en soirée… » Dans un premier temps, cette solidarité leur permet de franchir le pas du déménagement et d’une vie incertaine, avant dans un second temps d’espérer concrétiser le rêve d’une autonomie pensée à l’échelle collective. Car la vie nomade n’est généralement perçue que comme une étape provisoire dans le processus d’identification d’un espace approprié. En effet, comme l’oublient parfois les promoteurs du néo-ruralisme, accéder à l’occupation pérenne d’un terrain nécessite le cumul de nombreuses ressources.
Vivre provisoirement de manière nomade tout en amassant des ressources économiques, sociales, voire politiques, est ici conçu comme une manière de contourner l’impossibilité d’envisager directement la transition rurale. Celle-ci constitue l’horizon, mais dans un contexte perçu comme concurrentiel : « Le camion est un outil de prospection. Mais c’est aussi un outil d’autonomie, car il permet de pouvoir changer d’environnement. C’est une chambre mobile. Mais c’est aussi rassurant de se dire qu’on peut se déplacer avec sa maison, dans un monde aussi fragile que le nôtre aujourd’hui. Donc là l’idée est de sillonner les territoires, et de m’arrêter une fois que j’en aurai trouvé un sympa, où je pourrai m’insérer dans une dynamique préexistante. À terme, je souhaiterai m’installer dans le Sud, idéalement, dans un petit village situé à côté d’une petite ville. Je voudrais m’insérer dans une dynamique dans mon village, développer quelque chose, mais au-dessus de 250 habitants, ça devient difficile de s’organiser. Quand j’aurai trouvé, je poserai le camion, et j’y habiterai, avant de finir par acheter ou louer avec des amis. »
Pour une autre, « L’achat de terrain c’est difficile, on est tous indépendants, on n’est pas salariés, donc l’accès à la propriété par des crédits c’est compliqué, et puis dans les Cévennes ou autres trouver un terrain c’est le loto. Donc mes amis ont trouvé des locations. Ils jonglent entre la ville et là-bas… D’autres se mettent en pause. Aucun ne compte prendre un crédit et chercher sur le boncoin car ce n’est pas possible. Ils cherchent par réseaux. Une location, c’est bien, car ça permet de connaître les gens. Ça permet de montrer aux gens qu’on n’est pas là juste pour s’installer dans une résidence secondaire. Certains sont dans des roulottes, sans eau, ce n’est pas légal… C’est super compliqué de s’installer. »
- •
Je n’ai pas encore repris le contact avec mes enquêtés depuis leur départ. La quête d’autonomie par une telle vie nomade débouche sur des résultats aléatoires. Les personnes qui font ce choix de vie limitent les risques en se partageant sur les réseaux sociaux les listes réactualisées des communes susceptibles de les accueillir selon différents critères (ouverture politique, mais aussi présence d’une source, accès à une connexion internet, possibilité de cultiver…).
Alors que les communes touristiques ont tendance à se fermer, celles qui s’ouvrent sont généralement des communes de territoires de moyenne montagne en déclin depuis l’exode rural. Leurs élus, qui catégorisent (et souvent hiérarchisent) les populations vivant en camion (saisonniers, circassiens, « teufers » etc.), se déclarent inquiets de l’agonie des sociétés locales sous l’effet de la multiplication des résidences secondaires, et désireux de les accueillir en raison de leur jeunesse, de leur profil social – rappelons que ni le travail indépendant ni le nomadisme, vantés par AirBNB depuis la pandémie sous le concept de « digital nomads », ne constituent en eux-mêmes des dangers pour le néolibéralisme – et de leur volonté d’implication sociale, culturelle et écologique. Plusieurs dangers les guettent toutefois : la crainte d’une réglementation des camions aménagés, qui favoriserait une gentrification de ce mode de vie (un danger qui pèse déjà sur la transition rurale dans son ensemble) ; mais aussi la conditionnalité du RSA, sur lequel beaucoup comptent pour réaliser leur transition existentielle, et qui se traduirait ainsi par des difficultés accrues pour les espaces en déclin.
NdA – Je remercie mes enquêté.e.s, le POPSU-PUCA (projet « Exode urbain »), la MSH SUD (projet URBASENS), la Région Occitanie (projet ROCC’ALTER) ainsi qu’Éric Charmes pour sa relecture attentive d’une première version de ce texte.
