Faussaire de vie – sur Le plus menteur d’entre nous de Nicole Lapierre
C’était un faussaire. Il ne fabriquait pas de faux papiers (enfin, pas vraiment), il ne copiait aucun peintre, ne frappait aucune monnaie, mais il s’inventait des aventures à n’en plus finir, se présentait aux autres en déroulant un ruban d’origines et d’aïeux dont le mélange était exotique, des héritiers d’histoires qui n’avaient rien à voir les unes avec les autres, et qui toutes étaient prestigieuses.
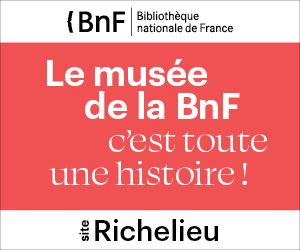
Des victimes, il en avait derrière lui, il en avait sous le pied. « Quel splendide cumulard ! », écrit Nicole Lapierre. L’essayiste et sociologue, autrice de Sauve qui peut la vie (Seuil), un récit littéraire récompensé du Prix Médicis Essai en 2015, a bien connu ce menteur. Il appartenait à sa bande d’amis lorsqu’elle avait vingt ans. Le nom de cet original était invraisemblable, Ulysses Moïse, « Ulysses avec un « s » à l’américaine, évidemment) ». Il est mort en 1991, des suites d’une maladie qui n’a pas été précisée ; la cause en est restée floue. Ulysses était jeune pour mourir, âgé seulement d’une quarantaine d’années.
Après son décès, les langues se sont déliées et ses amis ont réalisé que ceux qu’Ulysses prétendait fréquenter – Barbara Hendricks, Isabelle Adjani, le philosophe Habermas, ainsi qu’une ribambelle de femmes séduisantes avec lesquelles il aurait entretenu des relations amoureuses – n’étaient pas du tout ses proches. Après l’enterrement, quelqu’un du groupe a téléphoné à Habermas, pour l’avertir : « “Moïse, votre disciple, est mort.” Après un moment de perplexité, le philosophe s’est vaguement souvenu que quelqu’un lui avait demandé de signer un papier pour une bourse à ce nom. C’était bizarre mais, ébranlés par ta disparition, on n’y a pas prêté attention. On s’en est souvenu plus tard ». Nicole Lapierre garde un ton neutre quand elle remet les pendules à l’heure ; la vérité parle d’elle-même et cette impassibilité donne à son livre un mélange d’affection et de piquant.
Elle avait rencontré ce personnage « très attachant » en 1968, à Nanterre. Trente ans après sa mort, y voyant plus clair sur la mythomanie de son ami, elle lui offre un roman, en écho à la vie romanesque qu’il s’inventait. Le Plus menteur d’entre nous est publié dans la collection « Traverse » que dirige Ivan Jablonka et qui accueille des textes hybrides. Celui-ci est un, à la croisée du témoignage sur une époque et un milieu intellectuel, et du récit. Quant au roman, il prend forme dans le portrait que dresse Nicole Lapierre d’Ulysses Moïse.
À Nanterre, en 1968, c’était l’effervescence. Tout le monde voulait en être. Les bourgeois issus des lycées de l’Ouest parisien, catégorie dans laquelle se range Lapierre, se grimaient en prolétaires. Elle et d’autres militaient à la LCR. À une époque où chacun se croyait le plus malin, il fallait se distinguer ; Ulysses Moïse a fait très fort pour sortir du lot. Il s’est singularisé en se présentant comme l’héritier de plusieurs combats politiques et de plusieurs minorités.
Ce dandy et « séducteur impénitent » se donne en spectacle, aime être admiré et n’aime pas qu’on lui vole la vedette
Il était « un Noir américain à Paris », comme James Baldwin. Opposé à l’impérialisme de son pays natal, Ulysses épatait son monde parce qu’il avait déserté la guerre du Vietnam. Plus tard, il parla de sa mère comme d’une femme élégante et cultivée qui vivait dans un beau condominium à Miami. Ce n’est pas tout : le père de sa mère, donc le grand-père maternel du héros, avait été le premier rabbin noir de Jackson, dans le Mississippi. La judéité est donc arrivée dans son pedigree « quand cela est devenu, publiquement, un destin intéressant auquel d’autres minorités pouvaient s’identifier. C’est-à-dire à la faveur de ce mouvement de revival juif amorcé à la fin des années 1970 et devenu ample dans les années 1980 (…). » Noir et juif, Ulysses avait encore une corde à son arc, un trésor dans son sac de voyage : « Un père chinois, un affairiste sans finesse ni tendresse », qu’il ne voyait plus. De cette ascendance asiatique, « ni ton visage, ni ton nom, ne portait trace. » Dès la première phrase de ce livre bref, l’autrice s’adresse à son personnage. Ainsi, elle le met en joue et pose amicalement sa main sur son épaule en même temps.
Le plus menteur d’entre nous fait éprouver au lecteur d’abord de l’agacement vis-à-vis d’Ulysses, puis de l’attachement, et l’on sent que Nicole Lapierre a traversé elle aussi ces différentes émotions, mais selon une chronologie moins linéaire. Longtemps, les amis d’Ulysses sont séduits par les récits de ses péripéties et ne mettent pas frontalement en doute ce qu’il leur raconte. Il y a bien néanmoins des moments où cela coince. Ulysses par exemple ne prend pas part à la journée du 22 mai 1968, qui porte en germe les jours suivants. Plus tard, il s’est vanté d’y avoir participé. Nicole Lapierre, elle, sait que c’est faux : « gare au témoin ». Mais ce n’était pas une raison pour se fâcher avec lui.
Ce dandy et « séducteur impénitent » se donne en spectacle, aime être admiré et n’aime pas qu’on lui vole la vedette : il exagère, il est crispant. Fallait-il que les narcissiques soient légion à cette époque pour qu’il soit supporté. D’ailleurs ce titre, Le plus menteur d’entre nous, reflète un moment où les postures et les poses étaient accentuées. Ulysses n’était pas le seul menteur de la bande, tout le monde se la racontait, chacun en rajoutait, se décalait pour se faire une place au soleil parmi les amis.
Ulysse prit en grippe un autre camarade de cette bande, Omar, un Sénégalais, normalien, maoïste, qui fit une apparition dans La Chinoise de Godard. Noir et cultivé comme Ulysses, Omar lui faisait concurrence. Lorsqu’Omar est mort, soi-disant après s’être suicidé, Ulysses en a parlé comme s’il était l’un de ses amis. C’était faux, mais personne ne l’a contredit. La réussite de Nicole Lapierre consiste à dérouler avec placidité la biographie invraisemblable et la mauvaise foi d’Ulysses.
La peinture qu’elle fait des étudiants de Nanterre en mai 1968 est moins originale. Nicole Lapierre égrène des prénoms – Denis, Sylviane, Martin – et les cours d’amphis. Elle écrit : « Les origines, les racines, les places assignées, on s’en fichait complètement, à l’époque », ce dont on doute puisque les étiquettes, les appartenances, les clans étaient alors primordiaux.
Le charme que dégageait Ulysses venait bien de la quantité d’étiquettes qu’il arborait, de la pléthore de clubs dont il avait la carte. Son aura venait de l’abondance de ses identités. Un anti-impérialiste noir américain et bientôt juif avait tout pour lui, notamment l’exotisme. Il alliait le militantisme à la légèreté car il était « l’homme-qui-savait-contenter-les-femmes ». On le sait, plus un mâle se vante d’être un homme à femme, plus il y a anguille sous roche. Après la mort d’Ulysses, il s’est avéré qu’une histoire qui avait beaucoup compté pour lui n’était qu’une « petite aventure » dans la mémoire de l’intéressée. « Étais-tu un chic type ? Oui, en tant qu’ami drôle et prévenant. Pour le reste, vois-tu, on en discute encore. » Nicole Lapierre trouve des expressions délicieuses pour qualifier l’affabulation dont son personnage était le champion, celle-ci notamment : « Il te fallait achalander sans arrêt ton magasin de nouveautés. »
On ne révèlera pas les résultats de l’enquête que mène Nicole Lapierre après être partie à la recherche de la vérité sur Ulysses Moïse, dans la dernière partie du Plus menteur d’entre nous. La filiation entre ce livre et les précédents de l’autrice apparaît alors noir sur blanc, même si elle se dessine en filigrane dès le début du texte ; l’état dépressif de son héros est la première pierre des raccordements futurs. On pense à Sauve qui peut la vie, dans lequel Nicole Lapierre évoquait la sidération qui l’a envahie après le suicide de sa mère et de sa sœur. La disparition d’Ulysses plonge les vivants dans la stupeur. Elle évoque aussi le véritable nom de son père à elle, Lipsztejn, qui s’est métamorphosé en Lapierre, changement dont il est question dans Changer de nom (Stock, 1995).
Plus l’on se rapproche de la fin, plus le livre devient littéraire – notons à ce sujet qu’Ulysses Moïse méprisait à la fois la littérature et la psychanalyse, peut-être parce que ce sont deux sources de connaissance et qu’il fuyait la vérité. Nicole Lapierre cite Marthe Robert, Giono et Borges, qui dans Neuf essais sur Dante rapproche l’Ulysse d’Homère et le capitaine Achab, « l’un et l’autre courant, avec une folle hardiesse, à leur perte. Deux aventuriers suicidaires, en somme. » Elle analyse la figure de Corto Maltese, le héros d’Hugo Pratt. D’après elle, Ulysses lui ressemble : « Pas trait pour trait, bien sûr. Ta silhouette était nettement moins longiligne, elle était même – pardonne-moi, je sais le sujet est délicat – légèrement grassouillette (…) Au fait, sais-tu que Corto Maltese n’avait pas de ligne de chance ? Il en a tracé une avec le rasoir de son père, un homme qui partait loin et revenait de moins en moins. L’outil coupant d’un père manquant pour trancher vif dans la chair et ouvrir les possibles, quelle trouvaille ! » Le Plus menteur d’entre nous est un beau livre, délicat, elliptique, sur le manque.
Nicole Lapierre, Le plus menteur d’entre nous, Éditions du Seuil, septembre 2023.
