L’exclusion scolaire : entre discours idéologiques et réalité quotidienne
La campagne électorale des législatives a été, encore une fois, l’occasion de raviver les débats autour de la restauration de l’autorité à l’école et nous avons pu assister à une surenchère des candidats de la droite et de l’extrême droite autour de mesures disciplinaires toujours plus strictes : Jordan Bardella et son « big bang de l’autorité » a proposé par exemple de scolariser définitivement dans des centres spécialisés tous les élèves exclus deux fois de leur établissement.
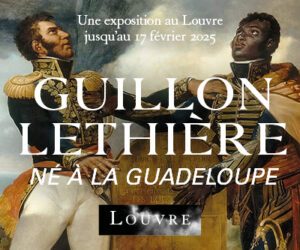
En janvier 2024, le conseil supérieur des programmes préconisait « le rétablissement de mesures de sanction réelles et immédiates pour les élèves perturbateurs, avec exclusion automatique de la classe, pouvant aller jusqu’à l’exclusion de l’établissement en cas de récidive[1]». Ces interventions font de l’exercice du régime disciplinaire un marqueur politique fort témoignent d’une méconnaissance absolue de la vie quotidienne des écoles, des collèges et des lycées.
On retrouve ici la vieille rengaine du camp de la réaction qui répète inlassablement, dans les tribunes d’opinion ou les ouvrages à succès, que sous l’influence de mai 68 et de la sociologie bourdieusienne, l’école serait tombée aux mains des gauchistes avec une bienveillance coupable, refusant l’exigence scolaire, les notes, les punitions. Cette idéologie permissive qui bénéficierait de la complicité de l’ensemble des ministres de l’éducation serait à l’origine de la disparition du respect et de l’autorité, de l’explosion de la violence, de la chute du niveau et de l’échec de notre école.
Face à ce bruit médiatique récurrent, il est nécessaire de repartir des connaissances concrètes établies par la sociologie de l’éducation, non pas par des idéologues qui n’ont jamais mis les pieds dans une école publique, mais par des chercheurs des chercheuses qui passent du temps long dans les salles de classe et les espaces de vie scolaire pour en documenter la réalité quotidienne. Si la recherche en éducation française s’intéresse
