Les défis de l’IA à la philosophie
La réflexion philosophique sur l’intelligence artificielle s’est imposée dès le début de la cybernétique avec les célèbres propositions d’Alan Turing sur la notion d’intelligence dans les années 1950, en réarmant de vieux débats philosophiques sur l’homme système ou l’homme machine et la nature possiblement mécaniste de la cognition.
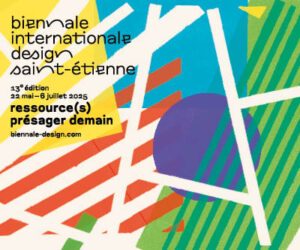
Mais avec l’avènement contemporain des intelligences artificielles connexionnistes fondées sur de l’apprentissage profond par des réseaux de neurones artificiels et les prodiges des modèles de fondation génératifs, ce sont à toutes les sphères de la philosophie que l’IA pose question : la philosophie de l’esprit évidemment, qui cherche à penser les bénéfices et les limites d’une approche computationnelle de l’esprit et de la conscience, l’éthique, qui se confronte à des questions originales sur l’agentivité et la responsabilité, la philosophie politique, tenue de penser à nouveaux frais l’action augmentée et la gouvernance algorithmique, la philosophie du langage, mais aussi l’esthétique qui doit s’intéresser à des productions artistiques issues des espaces latents des IA et où ses catégories traditionnelles dysfonctionnent, ou la métaphysique qui doit réfléchir elle aussi à nouveaux frais la supposée exception humaine ou la question de la finitude.
Savoir et penser : que nous disent les IA ?
Si le lien désormais établi entre IA, sciences cognitives et philosophie de l’esprit est nouveau, questionner philosophiquement l’intelligence artificielle exige de replacer bien des questions dans la longue durée. Le projet d’améliorer la vie humaine en automatisant des tâches cognitives, aussi radicalement original qu’il nous semble depuis l’arrivée de ChatGPT, développe une vieille intuition d’Aristote pensant à des automates qui résoudraient nos tâches de routine et remplaceraient nos esclaves ; les jalons en sont des automates célèbres (le canard de Vaucanson, le turc mécanique, etc., jusqu’aux exubérants robots de Boston Dynamics).
