Le roman d’apprentissage du capital humain : ghostwriter de sa propre vie (2/2)
À l’automne 2021, sur TikTok, une jeune fille ouvre une enveloppe en tremblant, filmée en gros plan sous un éclairage blanc. Sur la table, un kit 23andMe. Elle parcourt les résultats, les yeux emplis de larmes : « Je suis à 18 % d’origine Navajo… je ne savais pas… » La vidéo explose en nombre de vues. Les commentaires affluent : « Bienvenue dans la famille ! », « Tu portes en toi tant d’histoires… » En quelques heures, la séquence est reprise sur Twitter, des milliers d’internautes publient leurs propres tests.
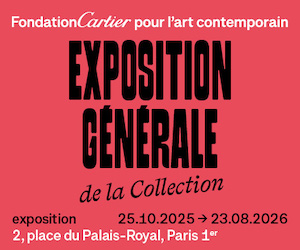
Un garçon de Londres rit nerveusement en apprenant qu’il est « 28 % scandinave ». Ces extraits, partagés sur TikTok puis compilés sur YouTube, deviennent viraux. Le génome se convertit en récit de soi : loin de se contenter de détenir un patrimoine génétique, on l’investit dans une narration destinée à capter l’attention – parfois attractrice de sponsors. Le génome se fait dramaturgie avec toutes les dérives racialistes que l’on peut imaginer.
Durant l’année 2021‑2022, des vidéos virales issues de campagnes 23andMe ou MyHeritage montrent des personnes découvrant leurs origines ADN en direct : souvent émues, apprenant être « 20 % ukrainiennes » ou « 15 % d’origine nigériane ». Le patrimoine génétique devient ainsi l’occasion d’une performance identitaire : on capitalise symboliquement sur son hérédité pour renforcer son capital narratif.
Selon une étude conduite sur cent vidéos TikTok liées aux tests ADN, 94 % mentionnaient explicitement la découverte d’origines familiales, et 92 % mettaient en scène la personne au moment même de la révélation. Ces vidéos ont rassemblé plus de 9,6 millions de likes et des dizaines de milliers de commentaires empreints d’enthousiasme ou d’empathie. Une autre analyse de 418 vidéos YouTube (entre 2014 et 2020) révèle comment ces révélations sont performées : les sujets accordent une autorité indiscutable aux résultats, souvent en conflit avec les traditions familiales ou les récits transmis oralement. Se développe alors
