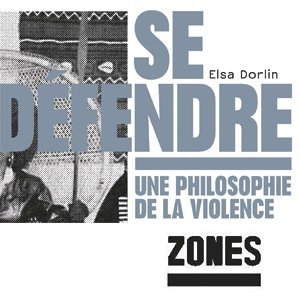« Discorde » ou l’art du chaos
Comment navigue-t-on dans un monde redevenu manichéen après que le mythe de la fin de l’histoire cher à Francis Fukuyama s’est dégonflé ? Un monde où tous les mouvements, qu’ils soient de gauche ou de droite, féministes ou sexistes, républicains ou religieux, sont en train de se radicaliser et de prétendre dur comme fer qu’ils détiennent la vérité ? Quelle est à présent la différence entre le bien et le mal, et quelles sont les forces qui parviennent à écrire ou réécrire l’histoire de cette différence ? Le Palais de Tokyo vient d’ouvrir ses portes à une série d’expositions spectaculaires sur les plus grands combats et confusions idéologiques contemporains.
L’une des plus impressionnantes est L’Ennemi de mon ennemi, conçue par le Wunderkind du monde de l’art français Neïl Beloufa, et son Virgile, le commissaire d’exposition Guillaume Désanges, connu pour ses nombreuses expositions à la fois narratives et conceptuelles. La première salle baigne dans la pénombre de quelques vidéoprojecteurs accrochés à une lanterne magique moderne qui diffracte, avec ses nombreux jeux de verres et de lumières, des films sur la société de la transparence et de l’hyperconnectivité. C’est une magnifique mise en abyme du Grand Verre duchampien, sauf qu’ici, ce n’est pas la mariée, mais le vide du monde qui est mis à nu par ses célibataires. Dans un film, un homme fait l’éloge d’une cité idéale, où l’on peut faire du canoë le matin, aller à la plage l’après-midi et skier le soir. Si Marx désirait une société où l’on pouvait chasser le matin, pêcher l’après-midi, s’occuper d’élevage le soir et philosopher après le repas, afin d’abolir l’aliénation d’un travail répétitif, l’homme contemporain ne semble désirer qu’une chose : l’aliénation elle-même. Le désir d’aliénation se retrouve également dans les capsules rétrofuturistes de Beloufa dispersées dans l’espace comme des lieux de couchages pour des explorateurs ou des SDF modernes, annonçant un monde où la différence entre les nomades volontaires et involontaires n’existera plus.
Comment sort-on de cette caverne ? Par la prise de connaissance du rôle ambigu de l’artiste contemporain, déchiré entre désir de soumission et d’insurrection. La salle suivante est vouée à Courbet, le diplomate révolutionnaire, qui sut aussi bien décrire la misère du monde qu’en tirer un profit économique. Beloufa montre ici quelques peintures de Courbet lui-même, des documents décrivant ses combats politiques et esthétiques, son engagement dans la Commune de Paris, ses exils et ses manifestes mais aussi des caricatures de lui, par des gens qui le trouvaient trop imbu de lui-même, et surtout trop contradictoire dans ses actions. Peut-on participer au déboulonnage la colonne Vendôme et, en même temps, se frotter aux mondanités ? Quoi qu’il en fût, Courbet est le premier en France à avoir mis en place l’idée d’une autonomie hétéronome qui arrive à fusionner le capital économique et symbolique, tout en gardant la liberté artistique. Nous savons tous quels dégâts la philosophie du « en même temps » a produit et produit encore dans le monde de l’art contemporain. Beloufa semble en être plus que conscient car, dans la même salle, il a exposé deux objets qui complexifient les choses encore. La première est un manifeste crypto-anarchiste de Timothy May écrit en 1988 qui annonce, d’une façon absolument vertigineuse, les effets que la révolution numérique aura sur nos vies et nos identités, tout en revendiquant une économie d’images et d’idées qui échapperont aux fils barbelés de la propriété intellectuelle. À côté, une installation, qui n’est pas une œuvre d’art, expose les fluctuations en temps réel du bit coin, le capital décapité ultime, qui est en train de révolutionner ou de détruire le monde financier actuel. Qui vivra saura. Mais une chose est sûre : tous ces éléments fonctionnent comme une parfaite cartographie des problèmes esthétiques et économiques à venir, qu’on peut en quelque sorte déjà visualiser dans la salle suivante, qui est aussi l’acmé de l’exposition.
Beloufa a réussi ici à mettre en scène un monde diaboliquement chaotique, où la production du sens et du non-sens entre les œuvres est déterminée par l’intelligence artificielle de quelques robots, engagés tels des Sisyphes infatigables dans un raccrochage incessant de l’exposition. À première vue, on se croirait dans une foire d’art où les œuvres se sont mises à faire littéralement la révolution, car elles bougent dans tous les sens, à l’intérieur d’un espace clos, dogvillien, portés par les mêmes robots qu’Amazon utilise pour ses distributions, ici couverts par des citations et des messages subliminaux.
Mais lorsqu’on s’approche, on se rend vite compte qu’il ne s’agit pas d’œuvres d’art au sens classique du terme que les robots exposent, mais de réappropriations, des documents politiques et publicitaires, qui créent des rapports ahurissants entre la propagande des jihadistes, des dictateurs, des humoristes qui moquent des dictateurs, ou de la Maison Blanche devenue un véritable asile psychiatrique, et les chefs d’entreprises, les activistes ou les politiciens soi-disant éclairés qui ont trouvé le Graal sacré de l’humanité, semblent aussi fous à lier. Ici et là, quelques discours sortent de cette lutte antagoniste entre ennemis en faveur d’une lutte agonistique entre adversaires. Le plus bel exemple est le discours d‘Amaryllis Fox, un ancien agent secret de la CIA, au look de femme fatale, qui sort de l’ombre, pour livrer une lecture du monde très complexe et captivante, notamment sur les vrais rapports entre Al Qaida, ISIS et l’Amérique.
Malgré ces zones grises, l’installation reste non seulement une parfaite parodie de l’art supposé « politique » qui a besoin de gommer les nuances et crier haut et fort ses messages dans la crainte de ne pas se faire comprendre, mais aussi de la théorie duchampienne, car ici ce n’est plus le regardeur, mais le robot, qui fait l’œuvre. La Silicon Valley a déjà inventé une application qui propose un psychanalyste 24 heures sur 24, offrant au monde entier de s’allonger sur le divan d’un même psychanalyste numérique – Orwell, lui-même, n’aurait pas pu imaginer pareil dispositif … Et il ne faudra sans doute pas longtemps avant qu’elle n’imagine une application critique d’art. Si le film Matrix présente le désert du réel comme un ground zero planétaire sur le plan écologique, mais offre tout de même à Néo le luxe du choix entre deux consciences, le réel qui menace le monde beloufien est un ground zero intellectuel, où l’homme a perdu la capacité de croire en ses propres facultés. Les deux scénarios vont de pair bien sûr, et se complètent plus que jamais.
L’exposition montre aussi des œuvres faites par Thomas Hirschhorn et Jean Luc Godard, que je vois comme les deux pères symboliques de Beloufa – le premier pour le coté horror vacui, l’autre pour le coté méta –, des affiches de Rauschenberg et de Warhol, les dessins de Van Nath (l’un des rares rescapés de Tuol Sleng, le centre de torture de Pol Pot), des dispositifs muséaux qui mettent en scène des détonations de bombe, oui, vous avez bien lu, des jeux de vidéos interactifs réalisés par l’armée britannique et, last but not least, des œuvres d’art réalisées par les nouvelles générations du post-internet art (Katja Novitskova) ou sur la guerre du combat numérique des réseaux sociaux, où les armes de séductions se mêlent aux armes de destruction. La plus forte et terrifiante reste celle de Grégoire Beil, qui a fait une compilation des scènes diffusées en direct par des utilisateurs de l’application Périscope – c’est une œuvre qui nécessiterait un texte en soi.
Si l’exposition de Neil Beloufa joue d’une manière ludique et quelque part distanciée sur l’ambiguïté permanente entre le bien et le mal, nous permettant de vivre la dynamique intrinsèque du chaos, où il s’agit de faire du chaos un allié, comme Lao Tseu, sans essayer de le contrôler, l’exposition L’un et L’autre, conçue par les artistes Kader Attia et Jean-Jacques Lebel, nous invite à traverser le chaos d’une humanité dépourvue d’humanité et à vivre la continuité des barbaries anciennes dans le présent, tout en nous offrant quelques zones de réconciliation et de reconstructions possible.
Le parcours conçu comme un labyrinthe sombre et théâtral, démarre avec l’extrait d’une vidéo figurant le maître du théâtre cruel en personne, Antoine Artaud, dont les lamentations quasi-indéchiffrables annoncent la folie à la fois violente et douce, destructrice et salvatrice de l’exposition, qui présente deux labyrinthes de nature très différente. Celui de Kader Attia, présent dans le labyrinthe de façon verticale à travers une bibliothèque à la fois gigantesque et austère, l’histoire du colonialisme et du terrorisme de nos jours, comme l’une et la même face de la même médaille ; celui de Jean-Jacques Lebel qui entraîne le visiteur dans des dédales qui nous obligent à nous confronter aux images des horreurs de l’armée américaine en Irak, où l’on peut voir encore une fois les corps des détenus, avec leurs excréments et leur sang, leurs têtes couvertes par des cagoules, leurs sexes à la main, et les visages follement souriants des officiers américains exposant leurs trophées, ici agrandis à l’échelle humaine. La pornographie de la terreur devient ici, encore une fois, objet de contemplation, juxtaposant les regards des colporteurs avec nos regards de consommateurs. Quand « le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître, et dans ce clair-obscur surgissent les monstres », disait Gramsci. Comment faire face à ces monstres qui adorent montrer leurs monstruosités ? Aux monstres en nous-même ?
Les salles qui entourent ces deux labyrinthes avec des masques de guerre, des armes et des instruments musicaux, venant du monde entier, et de tous les temps, exposés comme des reliques sacrées, proposent une réponse, car ici et là, sur des vidéos discrètement installées, on voit Kader Attia et Jean-Jacques Lebel, assis, côte à côte avec ces mêmes objets dans leurs mains, se parler à travers eux, exposant ici l’importance de la proximité physique, du lien tactile avec le monde qui nous entoure, mais aussi celui de la parole et de l’écoute, bref, du récit qui pourrait réparer le monde. Alors le récit de ces deux sages, qui arrivent à garder leur calme et leur joie de vivre en plein œil du cyclone, n’est plus totalisant mais subjectif et dialogique. Si le chaos du réel se donne à nous sous le masque de l’unité d’une théorie totalisante qui pointe du doigt un ennemi unique, il faut chercher une autre façon de l’aborder, de l’attaquer car, à défaut de changer le monde, c’est lui qui finit par nous changer. Là où Beloufa expose la politique à son stade le plus caricatural et l’internet comme la création d’un Leibnitz sans dieu (pour reprendre l’idée de Michel Serres), d’un monde sans père ni repères, l’exposition d’Attia et de Lebel réinstaure la possibilité d’un dernier jugement, d’une loi, à laquelle personne ne peut échapper – celle du droit humain.
S’il y a un enjeu commun entre ces deux expositions et les remarquables expositions de George Henry Longly, Anita Molinero, Nina Chanel Abney, Daiga Grantina et Marianne Mispelaëre, qui mériteraient chacune un texte, c’est le désir, cette source d’énergie humaine qui est en train de se tarir, tout comme se tarissent les gisements pétroliers. Est-ce vraiment le capitalisme, le pharmakon numérique, ou l’amour du conflit pour le conflit qui est en train de la vider ? Je dirais non car le véritable mal n’a pas de visage, ni de nom. Et c’est précisément à cela qu’il tient.
Discorde au Palais de Tokyo, à Paris, jusqu’au 13 mai.