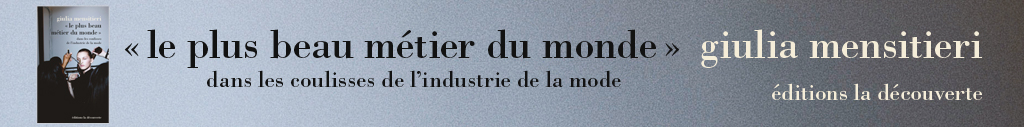Les secrets verrouillés d’Aki Shimazaki
Aki Shimazaki est née au Japon en 1954. Elle a d’abord construit sa vie là-bas, apparemment comme institutrice et prof d’anglais, avant d’émigrer au Canada dans les années quatre-vingt, d’abord à Vancouver, ensuite à Toronto, pour enfin s’installer à Montréal en 1991. Et puis, elle s’est mise à écrire. En français.
Si les courts romans qu’elle publie avec régularité sont désormais attendus à travers le monde par un cercle de lecteurs transis d’admiration, c’est sans doute que ses textes délicats sont sans équivalent dans la littérature d’expression française. Shimazaki a développé une technique narrative très personnelle, en travaillant avec subtilité sur une ligne de crête entre sa langue maternelle et sa langue d’écriture, construisant un français qui lui est propre, qui semble parfois être une traduction du japonais ou plutôt une reconstruction du japonais à l’intérieur du français, comme si la langue d’origine colorait la phrase de la romancière, qui en outre évolue dans une magnifique économie de mots, une écriture où le silence est élevé au rang d’art majeur.
Dès son premier roman, Tsubaki, paru en 1999 chez Lémeac/Actes sud, comme toute son œuvre par la suite, Aki Shimazaki a joué avec son multilinguisme. Tous les titres de ses livres sont toujours constitués d’un – et d’un seul – mot japonais : Tsubaki, Hamaguri, Tsubame, Wasurenagusa, Hotaru, Mitsuba, Zakuro, Tonbo, Tsukushi, Yamabuki, Azami, Hôzuki, Suisen, et enfin aujourd’hui Fuki-no-tô. De ce fait-là, non seulement chaque titre a une sonorité exotique pour un lecteur de langue française, mais celui-ci est placé de fait devant un terme dont il ignore la signification, comme si chaque roman débutait sur un secret soigneusement verrouillé. Ce n’est pas un hasard. Toujours, quelque chose nous échappe chez Shimazaki.
La romancière fait partie de la grande famille de ceux qu’on a pu appeler les écrivains de l’exil, dont le français n’est pas la langue maternelle mais, au gré de circonstances de leur vie souvent indépendantes de leur volonté, celle qu’ils ont choisie comme langue d’écriture : Hector Bianciotti, Andreï Makine, Agota Kristof, Brina Svit, Nancy Huston, Dai Sijie, Atiq Rahimi, pour n’en citer que quelques-uns.
C’est d’abord précisément de ce dernier, de l’écrivain d’origine afghane Atiq Rahimi et son Syngué Sabour, prix Goncourt 2008, qu’on serait tenté de rapprocher Shimazaki. Tous deux ont choisi un titre en langue étrangère, ils ont écrit des textes brefs, centrés autour de quelques personnages et qui se déroulent dans leur pays d’origine. Pourtant, c’est peut-être de l’autrice du Grand cahier, Agota Kristof, romancière hongroise installée en Suisse francophone et décédée en 2011, que Shimazaki est la plus proche, par sa phrase presque austère, d’un minimalisme assumé. Par les non-dits qui peuplent son œuvre.
Car ce qui surprend et séduit chez elle, c’est bien entendu son sens de l’épure, qu’elle semble affiner de livre en livre. Une économie de mots et d’effets qu’on associe parfois d’un art japonais de l’ébauche ou du haïku, certes, mais qui est peut-être plutôt lié à son approche prudente de la langue française. « En japonais, mes phrases sont plus longues. En français, c’est beaucoup plus minimaliste », a-t-elle concédé lors d’une de ses très rares interviews, accordée à un journal québécois. Mais alors que Kristof qualifiait la langue française de « langue ennemie » contre laquelle elle avait la sensation de devoir se battre, selon ses propres termes, Aki Shimazaki semble plutôt apprivoiser le français et faire de lui un vecteur pour nous conduire vers l’élément central de son univers, un fantasme désormais inatteignable, le Japon abandonné.
Pourtant, tout en écrivant en français, Shimazaki sait jouer avec sa langue maternelle, et pas seulement en titrant ses textes d’un mot japonais dont on ne découvre le sens qu’en lisant le livre. Rares sont les auteurs francophones à être allés aussi loin dans une sorte d’interlinguisme expérimental et extrêmement fécond. Tous les personnages ont des noms japonais, évidemment, et Shimazaki jalonne ses textes de mots dans cette langue, dont elle donne un lexique à la fin : enju, hiragana, nakaï, ofuro, ryokan, yukata. Ce n’est pas seulement pour la couleur locale, l’écrivaine travaille sur les sonorités et ces mots venus d’ailleurs confèrent à ses textes une discrète poésie. Elle va d’ailleurs plus loin dans un travail cette fois-ci graphique très intéressant puisqu’il lui arrive de placer des idéogrammes dans ses phrases. Faisant ainsi de l’illisible un élément même de son texte.
En cela, la présence d’une telle romancière dans le champ littéraire de langue française revêt une importance considérable, puisqu’elle a une manière absolument unique de travailler, et parce qu’elle crée un espace chargé d’imaginaire qui permet aux lecteurs francophones de regarder leur langue maternelle avec une sorte de distance. Et ces expérimentations linguistiques ne sauraient être réduites à de simples jeux formels vides de sens. Elles permettent d’ouvrir des possibilités narratives spécifiques.
Ce n’est d’ailleurs pas seulement sa phrase qui surprend ses lecteurs, mais aussi la structure générale de son œuvre, qui là encore démontre une maîtrise absolue de son travail. Aki Shimazaki frappe par la régularité métronomique de sa production littéraire, organisée en pentalogies, soit des groupes de cinq romans, que son éditeur préfère nommer des cycles. Le premier, « Le poids des secrets », a été publié entre 1999 et 2004 et regroupe Tsubaki, Hamaguri, Tsubame, Wasurenagusa, Hotaru, le deuxième, « Au cœur du Yamato » a été publié entre 2006 et 2013 et regroupe Mitsuba, Zakuro, Tonbo, Tsukushi, Yamabuki, et enfin le troisième, « L’ombre du chardon », a démarré en 2014 avec Azami, Hôzuki, Suisen et se poursuit donc cette année avec le tout récent Fuki-no-tô. Chaque cycle tourne autour d’un même récit, explore les mêmes thématiques –la guerre, les non-dits familiaux, la violence des codes sociaux- regardées de livre en livre par différents protagonistes qui peuvent se retrouver d’une histoire à l’autre, et en deviennent tour à tour les narrateurs. Les romans qui constituent un cycle sont reliés les uns aux autres mais peuvent être lus séparément. Ainsi chaque cycle forme une sorte de puzzle mouvant, agencé de pièces qui ne coïncident jamais tout à fait exactement, car d’une à l’autre il y a du jeu, d’infimes interstices qui laissent au lecteur une part d’intuition et d’interprétation.
« Je flâne dans le bosquet de bambous.
C’est le début de mars. A l’ombre, il reste encore de la neige ici et là. Je marche lentement sur la terre humide. Les camélias rouges au cœur jaune apparaissent entre les vieux bambous vert grisâtre. C’est une beauté simple et sereine que j’adore depuis mon enfance ».
Dans le dernier roman, Fuki-no-tô, on retrouve des personnages présents dans le livre précédent, Suisen. Atsuko, la narratrice, jeune mère de famille d’une trentaine d’années, a réalisé son rêve : créer une ferme biologique sur un terrain que lui a légué son père. La nature sauvage, les arbres et les fleurs, sont toujours très présents dans le travail d’Aki Shimazaki et apportent une touche poétique à son univers. Le mari d’Atsuko, Mitsuo, est rédacteur en chef d’une revue dans la ville voisine. Tous deux ont vécu des moments difficiles, dus à une infidélité de Mitsuo, mais semblent aujourd’hui former un couple paisible, quoique muet. L’entreprise d’Atsuko est fructueuse, et elle décide d’embaucher quelqu’un pour l’aider. Ce sera une jeune femme en plein divorce, Fukiko, qui s’avère être une très ancienne amie de lycée perdue de vue. Et peu à peu la vie d’Atsuko va basculer.
Le poids du passé était le titre du premier cycle de romans de Shimazaki, et c’est toujours un thème extrêmement présent dans ses textes : la résurgence dans le présent de ce qui n’est plus, que l’on n’a cru oublier, de ce que l’on n’a jamais su parce qu’on nous l’avait caché. C’était le thème du tout premier roman, Tsubaki, dans lequel un personnage reçoit une lettre qui lui raconte l’histoire de sa famille à Nagazaki. Le dramaturge canadien né au Liban Wajdi Mouawad a récemment expliqué tout ce que la lecture de Tsubaki lui avait apporté au cours de l’écriture d’Incendies, et notamment le ressort dramaturgique de l’apparition d’une lettre qui représente le passé. Cette thématique, sous différentes formes, n’a jamais quitté l’œuvre de Shimazaki, et elle est liée au thème de l’enfance, telle qu’elle surgit parfois dans notre vie d’adulte, au cours d’une rencontre fortuite par exemple. L’enfance est le lieu des secrets, de ce qui enferme notre personnalité, elle détermine la trajectoire des personnages de Shimazaki, à leur insu.
Comme les précédents romans, Fuki-no-tô se déroule au Japon. Contrairement à d’autres auteurs francophones d’adoption, comme Dimitri Bortnikov, l’exil n’est pas un sujet pour Shimazaki. Mais c’est peut-être justement l’éloignement de son pays natal qui lui permet d’écrire et de regarder, de l’extérieur, la société japonaise et ses codes, comme la rigidité de l’institution du mariage. Sa situation d’expatriée est probablement lisible à un autre niveau, car Aki Shimazaki est avant tout la romancière des exils intérieurs. Ses personnages sont en général des gens qui prennent un jour conscience de s’être éloignés d’eux-mêmes. Enlisés dans un mariage de convention, ils retrouvent soudain leurs véritables aspirations, ou un amour perdu, ou découvrent un secret de famille qui bouleverse leur existence à jamais, et tentent alors de vivre autrement qu’ils ne l’ont fait jusqu’alors.
En cela, dans cette valorisation de l’individualité, cette observation de ce qu’il y a de plus intime dans ses personnages, Shimazaki pourrait être considérée comme une écrivaine plus occidentale que japonaise. Cela dit, il est peut-être inutile aujourd’hui de tenter de la rattacher soit au Japon soit au Canada. Comme tout grand écrivain, elle porte en elle son identité et son originalité, remarquable dans chacun de ses textes, par son étude précise des séismes intérieurs, son observation fine et sensible de ce qui constitue une personnalité.
Ainsi l’art romanesque de Shimazaki permet de faire ressurgir les sentiments enfouis qui sont en chacun de nous, que sa condition d’exilée a tout simplement rendus plus aigus. Et ce lent processus de surgissement de fantômes, travaillé phrase à phrase, est ce qui donne à ses livres une subtilité inégalée. Ainsi elle a confié en interview : « Quel est le sens d’écrire ? Je le trouve moi-même en écrivant, car je ne connais pas la fin. […] Quand je comprends ce que j’avais à dire, je recommence du début à la fin. Je me psychanalyse moi-même ».
Aki Shimazaki. Fuki-no-tô. Actes sud. 15 €, 152 pages