Chevillard en poète baroque de « vanités » – à propos de L’explosion de la tortue
Personne ne sait pourquoi j’ai dit que j’allais écrire douze mille signes sur le dernier roman d’Eric Chevillard. Douze mille signes, c’est beaucoup, surtout si je ne veux parler que du texte, sans user des habituelles ficelles dilatoires que j’ai maniées durant vingt-cinq ans dans la presse. Surtout s’il s’agit d’avoir une idée. Une idée, mon dieu, comme dit l’autre, on n’en a pas tous les jours et quand on en a une, c’est une fête.
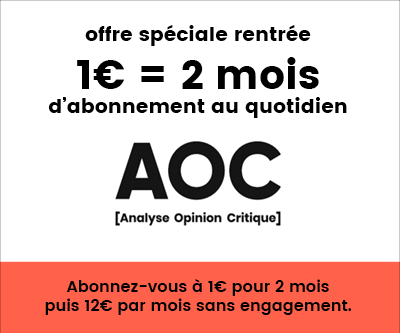
On peut taper « Eric Chevillard » dans un moteur de recherche universitaire du genre Isidore, et tout de suite c’est la cata : ils sont 659 à avoir eu des idées avant moi. Il suffit de se pencher pour ramasser trois ou quatre thèses. D’éminents collègues ont déjà écrit ce que j’avais envie de traiter en partant sur ce chemin de croix critique : que chez Chevillard, « on ne sait pas si on est le lecteur ou si on joue son rôle. (…) personne n’y est jamais à la bonne place. Dès qu’une place est trop bonne, elle est aussitôt refermée et l’on est conduit dans une autre, par jeu et non par une quelconque manœuvre d’intimidation. » (1) Mais quelle idée d’avoir voulu faire un commentaire de L’Explosion de la tortue… Ne savais-je pas bien que « l’œuvre d’Éric Chevillard réjouit le lecteur, mais désespère le critique » comme l’écrit Dominique Viart ? (2) Bien sûr, cette désespérance critique vient du plaisir explicité par Samoyault : il n’y a pas une seule place pour le lecteur mais une infinité. A peine une porte ouverte, elle se referme et une autre apparaît. Ou pour le dire encore autrement, comme l’écrit Ryoko Sekiguchi (mais à propos de tout autre chose), la littérature ne consiste ici qu’à essayer de découdre les deux faces d’une même porte (c’est dans Calque, P.O.L, 2002).
Douze mille signes d’amour pour Chevillard donc, c’est toujours risquer de ressembler à l’épris lourdaud qui, en croyant déclarer sa flamme, recouvre l’aimé.e de sa bave médiocre. Dans la presse, c’était facile, l’enchantement du lecteur permettait au critique de chanter, il n’avait pas besoin de tenir un métadiscours, il lui suffisait de mimer sa lecture. Par exemple, écrire à propos de Choir (Minuit, 2010) que la vie n’est pas rose sur l’île de Choir, la preuve, ses habitants disposent « de trois cents douze mots pour dire gris ». Forment-ils un choir, un chœur, en anglais ? Ou alors, à propos du Désordre AZERTY (Minuit, 2014) : « on ne sait pas, de l’autobiographe et de l’autofictif, lequel court devant l’autre ou lui mord la queue, car la littérature d’Eric Chevillard, c’est toujours la poursuite burlesque de la poule et de son œuf. » Puis finalement, l’année suivante, pour Juste ciel (même éditeur), livre qui se passe après la mort, je pouvais noter que je ne divulgâchais rien en révélant « qu’il y a une sorte de temporalité dans l’au-delà ». Vu que le livre a cent quarante pages, c’est bien qu’il doit y avoir une sorte de durée dans l’éternité.
Donc on peut se glisser dans le métatexte que propose Chevillard et y faire le clown avec plus ou moins de bonheur. On peut aussi relever les thématiques chères à l’écrivain. Parmi les 659 articles évoqués, un certain nombre semble s’accorder sur quelques points. On peut commencer par un qui est d’actualité. Par exemple, Chevillard serait écologiste. De fait, il aime bien les crabes (La nébuleuse du crabe, Minuit, 1993), les hérissons (Du hérisson, Minuit, 2002), les orang-outans (Sans l’orang-outan, Minuit, 2007) et, désormais, les tortues. Ou, plus précisément et symétriquement, il n’aime pas ce que l’humain fait à la planète, à lui-même et aux autres espèces (3). C’est un motif récurrent chez lui : dans Juste ciel, on apprend ainsi (en direct des limbes) que si les désirs des vivants pouvaient se réaliser, « un groupe composé de mille individus disparaîtrait en soixante-treize jours, du fait des antipathies réciproques et de la haine de soi. »
Dans L’explosion de la tortue, le salaud de narrateur a laissé crever sa tortue de Floride durant les vacances d’été, faute d’eau et de nourriture. Quand il revient, elle fait « crac » entre ses doigts, la carapace décalcifiée, puis elle agonise : « Et mon pouce avait touché le corps mou, l’inconcevable corps de tortue, et j’avais eu un frisson. » Est-ce que ce genre de choses arrive dans la réalité ? Chevillard m’a obligé à consulter le forum en ligne « ma tortue ne va pas bien ». J’ai beaucoup pleuré à la fin car malgré les injections d’antibiotiques, les lampes à UV, supplémentations vitaminiques, la tortue du forum mourait au terme d’une longue agonie. Au fil de ma lecture, j’ai aussi dû vérifier dans le dictionnaire le sens de « éburnéen » et « sous-prote », puis chercher « oaristys », « mégir », « chaussons de lisière », « oribusier », plus une palanquée de noms d’affections de l’appareil génital masculin que je vous déconseille (le syndrome de Lapeyronie, en particulier). La tortue de Chevillard s’appelle Phoebe. On suppose que son nom de famille est An.
L’explosion, ça tombe bien, est aussi un motif chevillardien. Selon ses critiques. Ceux-ci parlent volontiers d’« éclatement » ou de « déplacement » et Chevillard n’a-t-il d’ailleurs pas écrit un Démolir Nisard (Minuit, 2006) ? Mais ce qui explose le mieux, bien sûr, chez Chevillard, c’est la figure de l’auteur. Comme pour Nisard, Crab (Un fantôme, Minuit, 1995), Thomas Pilaster (L’œuvre posthume de Thomas Pilaster, Minuit, 1999) ou Oreille rouge (Minuit, 2005), le narrateur fait ici la peau à son alter ego. Dans L’explosion de la tortue, l’écrivain fictif (certes, Nisard est issu de la réalité historique, admettons) qui morfle s’appelle Louis-Constantin Novat. Mais enfin, c’est une question d’inexistence avant tout, comme celle du hérisson dans Du hérisson, du capitaine Cook dans Les absences du capitaine Cook (Minuit, 2001) ou de Dino Egger (Minuit, 2011). Chevillard adore prendre pour point de départ l’absence (voire la faire parler, comme dans Juste ciel) et doubler son narrateur d’une « auteurisation » fictive : « On emménage bien dans la maison du mort – sauf quand la charpente aussi a cédé –, pourquoi ne pas habiter son œuvre ? » A ce point, on se dit que « l’inconcevable corps » (formule récurrente) de la tortue sous sa carapace brisée décrit aussi bien l’auteur dans son livre. Inconcevable car on n’imagine pas le corps de la tortue séparé de son exosquelette, pas plus que le bébé d’Eraserhead (1977), le film de David Lynch, ne peut être démaillotté. On l’ignore trop en dehors des forums spécialisés, la fracture de la carapace est une blessure mortelle chez la tortue. Et dans Commentaire autorisé sur l’état de squelette (Fata Morgana, 2007), Chevillard note que « nous ne connaîtrons jamais notre squelette. Parfois, une fracture ouverte nous en donne une vue partielle et décevante puisque c’est là précisément qu’il a cassé » ; mais également que « la main qui écrit engage une partie d’osselets qui vaut aussi pour elle-même ».
Une fois qu’on a dit qu’il pourrait s’agir d’une entreprise de memento mori, on n’a pas forcément dit grand chose. Quoique, à picorer de ci de là, l’hypothèse se révèle peut-être plus productive que prévu. Je lis ceci dans un excellent article de Muriel Pic (4) à propos du texte de Walter Benjamin sur le baroque allemand : « La puissance de la physis est d’abolir la signification. Le cours des choses ne fait plus sens, il n’est plus que continuité sans fin de la destruction. » Et un peu plus loin : « dans l’opération qui consiste à épingler la vie pour l’observer morte se joue la césure entre la physis et la signification à l’origine du choc du memento mori. La nature scrupuleusement observée perd sa signification véritable, la vie, et devient, à proprement parler une nature morte (…). Planches de botanique, atlas d’anatomie ou de géographie reproduisent la vie comme un schéma ou une mécanique. » Cette analyse, outre qu’elle me paraît idoine pour décrire certains traits de l’esthétique de Chevillard, pourrait expliquer aussi sa rhétorique encyclopédique (3). Mais là, il faudrait noter qu’on n’est pas chez Bouvard et Pécuchet. Je ne pense pas que, contrairement à ce qu’on peut lire parfois, Chevillard ressortisse à la tradition du « livre sur rien ».
Alexandre Gefen parle à son propos de « littérature sans la littérature » (5) qui détruirait « l’idée de littérature en tant que projet intégrateur ». Et il propose entre autres de « voir dans les fantaisies de Chevillard un dernier combat contre la vague de la littérature de non-fiction ». Cette position combattante est très claire dans les textes semi-théoriques de l’Autofictif ou dans l’hilarant Défense de Prosper Brouillon (Notabilia, 2017). Mais pour ce qui concerne les romans, si l’on suit le parallèle que j’établis entre littérature de la réparation et néoclassicisme (6), Chevillard serait, moins qu’un combattant peut-être, un symétrique : le versant néobaroque de notre néoclassicisme, son miroir tendu où l’autre peut admirer son portrait entre les os d’une « anatomie » (un squelette), comme écrit ce plaisantin d’Agrippa d’Aubigné.
Si Chevillard est une sorte de poète baroque de « vanités », on peut lire autrement que comme une écologie sa tendance au rabaissement de l’humain. Comme le note telle universitaire, « la poésie de la vanité est une invitation autoritaire et pédagogique à la contemplation de notre inanité au regard de Dieu. » (7) En remplaçant bien sûr « autoritaire » par « ludique » (mais en gardant « pédagogique » sous l’aspect du méta-), ce serait une description assez convenable de Juste ciel. Le narrateur de L’explosion de la tortue est assurément un « misérable et périssable eschantillon de nature » comme dit Jean de Sponde. Non content d’avoir par incurie déshydraté sa tortue à mort, il entreprend de voler l’œuvre de Louis-Constantin Novat (d’usurper sa maison-carapace). On apprend aussi plus loin qu’il a été un enfant monstrueux et qu’il applique à la lettre l’éthique minimale de Ruwen Ogien au cas de son concierge Forcinal, dont tout laisse à penser qu’il est un tueur pédophile, plus quelques broutilles assez viles – toutes ces informations étant emballées dans 250 pages de pure mauvaise foi. Aussi n’est-on pas tout à fait sur de devoir lui faire confiance quand il justifie (p. 92) l’existence du texte que nous avons entre les mains en se glissant dans la peau de l’auteur et en notant, après avoir cité Thoreau à propos d’une sombre anecdote d’œuf de tortue (« je l’ai brisé. La petite tortue était parfaitement formée, jusqu’à la colonne vertébrale que l’on voyait distinctement ») : « Si la littérature ne s’empare pas de ces histoires de tortues précocement anéanties, tuées par un brave homme qui n’avait pourtant pas l’intention de leur donner la mort, alors on voit mal de quoi elle pourrait se soucier et quelle est sa légitimité. »
Donc, la littérature, c’est peut-être l’œuf cassé en soi (Palafox, Minuit, 1990). Et la poule avec, on l’a déjà dit. N’en étant qu’à 12866 signes, j’ai le temps de reprendre ma question déjà résolue en partie par Tiphaine Samoyault. A savoir : l’intrigue, on s’en fiche un peu, ce qui nous intéresse, c’est de savoir ce que Chevillard fait à la littérature et ce que le texte nous fait à nous, lecteurs. Car en lisant L’explosion de la tortue, on ne peut en effet qu’être admiratif de cette longue irrésolution en quoi consiste la narration, et l’on ne cesse de se demander : « mais qu’est-ce qu’il raconte ? » Ce « il » étant, on l’a dit, vide, usurpateur, crevé comme la carapace de la tortue. Une piste pourrait être donnée par Cernogora quand elle note que chez le poète baroque, « le “voir comme” se substitue (…) à un vide ontologique » et que son texte est plein « d’interrogations incessantes sur l’essence du monde et de l’homme ». Certes, s’agiter en poète rédime toujours quelque chose, du moins dans l’appréhension du réel, si ce n’est dans celui-ci.
Il faut commencer par redire que, contrairement aux métaphores qu’on emploie habituellement pour parler de la fiction, le lecteur n’entre pas en elle, ne visite aucun pays, fût-il imaginaire. Une fiction n’est pas une fenêtre, on n’agit pas envers elle. C’est le contraire : à la rigueur, elle est « immersive » si l’on veut. C’est elle qui entre en nous et agit sur nous. Elle nous assigne à des places et modifie ainsi momentanément, dans la célèbre « suspension de l’incrédulité », la représentation que nous nous faisons de nous-même (c’est-à-dire du monde). Exemple, la première phrase de Madame Bovary : « Nous étions à l’étude, quand le Proviseur entra, suivi d’un nouveau habillé en bourgeois et d’un garçon de classe qui portait un grand pupitre. » Il me semble, mais j’ai peut-être tort, que le lecteur (englobé dans le « nous ») est ici invité à ne pas se penser en bourgeois (qu’il le soit ou non en réalité importe peu), sinon quel sens la précision pourrait-elle avoir pour lui ? La fiction introduit nécessairement un décollement, un interstice. Elle déplace le lecteur. En outre, ce narrateur ne dit pas « un bourgeois » mais « habillé en bourgeois » : il nous invite à partager son jugement. Un exemple inverse serait l’incipit de L’arbre du pays Toraja, de Philippe Claudel (Stock, 2016) : « Sur l’île de Sulawesi vivent les Toraja. L’existence de ce peuple est obsessionnellement rythmée par la mort. » Ici, « obsessionnellement » est évidemment un jugement de la narration (on doute que les Toraja s’estiment obsessionnels, sinon ils arrêteraient de l’être) mais il n’est pas présenté comme tel. Au contraire, l’obsession est donnée pour une qualité intrinsèque de l’existence des Toraja, de même qu’on apprendra à la page suivante qu’un arbre peut-être en soi « remarquable et majestueux » sans que le sujet qui le remarque et le juge tel y soit apparemment pour rien. Là, la littérature ne nous assigne pas à une place différente : elle nous laisse à la plus reposante et la moins ouverte, celle où je confonds tout (les choses et ce que j’en pense).
Donc, qu’est-ce que la narration de Chevillard nous fait, où nous met-elle ? « Crac / Car mon pouce avait crevé la carapace fine et sèche comme une feuille morte. Et il y avait eu en effet un petit bruit de promenade en forêt. J’avais touché dessous, oh j’avais touché dessous le corps mou, l’inconcevable corps de tortue, et j’avais eu un frisson, quelque chose vibrait dans cette chair, le cœur pulsait, ou une veine. » C’est le début : il y a d’abord, suspendu en haut de la page un « Crac » en italiques, sans point. Puis le paragraphe. Donc un bruit. Puis du toucher. Il existe des thèses, on l’a dit, sur l’art de Chevillard (8). Mais pas besoin d’être docteur pour voir ici qu’on glisse avec le narrateur, on entre par une promenade automnale en forêt dans l’absence de la tortue. Peut-être que le narrateur chantonne (c’est ça qui est bien avec Chevillard, comme on ne sait pas où l’on est, on cherche) : « J’avais touché dessous, oh j’avais touché dessous », on dirait du Bashung. Deux pages après, il en est toujours à son gimmick sonore : « Me craquer entre les doigts plutôt, oui, plutôt crac que clac. » Assez vite, le narrateur révèle une monstruosité qui, comme d’habitude chez Chevillard, repose sur une logique renversée, presque sadienne : « Que faire de Phoebe ? Curieusement, ne nous était pas venue l’idée pourtant très humaine – nous y songeons bien pour nos vieilles mamans – de l’abandonner. Ce n’était pas la dernière fois que nous manquerions d’humanité dans cette affaire ». Si être humain c’est abandonner son prochain, en effet, on pourrait ici souhaiter que le narrateur soit un peu spéciste et traite l’animal moins bien que l’homme, puisque l’échelle des valeurs est cul par dessus tête.
Donc on ne sait pas sur quel pied danser, mais ce qui est sûr c’est qu’on danse, et qu’on chante. On est assigné (puisque c’est une fiction) mais à tous les vents. Peut-être cela est-il dû à un trucage très simple : si j’écris « roman » sous le titre, je charge la barque apophantique, mais si j’indique « poème », je résous en quelque sorte le problème, d’autant que L’explosion de la tortue est présenté en versets… Ce qui est en jeu, c’est la co-création du sens par l’auteur et le lecteur dans un jeu sans fin (voilà bien une platitude usée). On est du côté de l’action plutôt que de la contemplation. Mais une action néobaroque qui, comme dirait Cernogora, substitue au vide ontologique un « voir comme », comme si ce songe était notre vie.
