Faire Virgile — Traduction d’un grand poème par Frédéric Boyer
Qu’est-ce donc que « Faire Virgile », ainsi que l’annonce Frédéric Boyer dans le texte de présentation de sa nouvelle traduction des Géorgiques ? Faire Virgile : refaire, d’abord, le voyage d’une langue, de la sorte ranimée, retrouvée vivante sous le français qui paradoxalement la révèle, la réveille. Faire Virgile : rendre présent un texte qui a vingt siècles, non pas dans la fiction d’un contemporain factice, mais la réalité, vocale, physique, d’une présence…
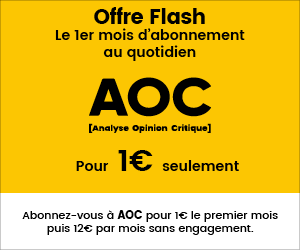
Cela passe par le rythme, la mise en espace sur la page d’une sorte de dramaturgie du poème, dont est donné à voir le principe de digression, et l’espèce de folie géniale dans les variations d’échelle et le scrupule du détail, puisque Virgile y parle d’Orphée et des abeilles, du printemps et de la guerre, du poids du travail et des roses séchées… Les Géorgiques sont un monde en quatre chants et 2000 vers : quelque chose comme un territoire rêvé, d’une « familière étrangeté », dans lequel on peut s’aventurer, se perdre aussi.
La langue latine, à force d’exercice, permet quand on la possède un peu cet étrange dépaysement d’un texte-lieu : mais la possède-t-on jamais ? Cette langue, on a commencé à l’apprendre au collège, puis les études ont pu faire qu’un jour on croyait la savoir assez pour lire à demi des livres, du moins dans leur version double, celle des fameux exemplaires de la collection « Budé » qui ont fait loucher des générations d’étudiants soumis à l’exercice du « petit latin ». Et puis, on l’a oubliée, simplement. On fait parfois semblant de la savoir encore un peu, assez pour que nous revienne la familiarité de sa syntaxe, mais ce n’est pas suffisant, quelque chose s’est éloigné… Langue morte ? Langue savante, en tout cas, palimpseste, presque fantôme, dont l’usage sincère et souple est réservé à un si petit nombre ! Alors on tourne autour de ce vieux rêve, les traductions de Virgile en français sont nombreuses, pour l’Enéide surtout (ainsi une récente Pléiade, le travail de Paul Veyne, etc.), mais rien n’y fait : quelque chose reste de l’ordre de l’étrange, comme le songe lointain, même pas nostalgique, d’un monde quitté — nullement la mélancolie de l’école, qu’on ne s’y trompe pas.
Et voilà que Frédéric Boyer, qui déjà avait fait des Confessions d’Augustin des Aveux, et mis la Bible à l’épreuve (presque au sens d’une révélation photographique) des meilleurs écrivains d’aujourd’hui, nous donne Le souci de la terre, sa traduction des Géorgiques, précédée de ce qui est davantage qu’une introduction : une sorte de présentation-manifeste, extrêmement personnelle et extraordinairement belle, sous le titre, donc, de « Faire Virgile ». C’est une émotion : une (re)découverte, le sentiment immédiat d’une reconnaissance, et l’impression qu’on a là, pour le dire d’un mot usé, mais d’un enthousiasme sûr, un chef d’œuvre.
Rendre présent : rendre audible, accessible, praticable, « traversable » dans sa matérialité textuelle problématique le poème de Virgile, voilà ce que réussit Frédéric Boyer.
Rendre présent : rendre audible, accessible, praticable, « traversable » dans sa matérialité textuelle problématique le poème de Virgile, voilà bien ce à quoi réussit Frédéric Boyer. Il a pour cela trouvé une forme, laquelle parvient à adapter dans la langue française contemporaine l’hexamètre dactylique (le vers latin scandé, que ne saurait rendre, comme l’a cru une longue tradition, notre alexandrin syllabique) : c’est celle de « versets libres, aux rythmes divers », qui procure à l’ensemble du poème une respiration inédite, une tension nouvelle. Le résultat est sidérant, qui dynamise et dynamite, d’une certaine façon, le texte de Virgile, en lui donnant toute sa puissance d’éclat, en rendant aussi possible son actualité ainsi sensible dans l’élan propre de notre lecture.
Son actualité ? La question se pose forcément, pour un poème rédigé, nous rappelle son traducteur, dans la campagne italienne il y a plus de deux mille ans, probablement dès 37 avant J.-C., et qui se propose de traiter en quatre livres des techniques et des arts de la res rustica, la matière agricole : les travaux des champs, les arbres et la vigne, l’élevage et l’agriculture. Bien sûr, les Géorgiques sont davantage qu’un antique traité d’agronomie, même composé en des temps politiques troublés, mêlé de considérations cosmogoniques, constellé d’anecdotes mythologiques… Le texte se révèle avant tout un « acte poétique », qui consiste à « écrire le chant de la terre, de ses transformations » et à « célébrer notre obscure condition terrestre dont nous semblons nous éloigner toujours davantage. »
Qu’on ne réduise pas, pourtant, cette version moderne des Géorgiques à une sorte de tract écologiste anachronique, revisité dans l’urgence de nos (légitimes) préoccupations contemporaines. C’est à notre monde que l’on pense évidemment, en lisant le monde de Virgile ; mais c’est surtout dans le mouvement de l’un à l’autre que se joue pour nous la beauté, presque le risque, du geste de traducteur – et d’écrivain – de Frédéric Boyer. Ainsi explicite-t-il le dialogue actif, et pour tout dire vivant, que nous pouvons entretenir avec un texte antique : « les textes anciens ont certes toujours quelque chose à nous apprendre, à condition pour cela de les transmettre dans leur littéralité pour les interroger de nouveau, mais plus encore d’une certaine façon les textes anciens ont quelque chose à apprendre de nous. Notre tâche est de leur parler de nous, de les interroger depuis notre condition, notre éloignement, et de bâtir ce lointain-près, dimension sans laquelle nulle civilisation n’aurait de profondeur, et ne saurait se transmettre et se renouveler.
De cette hybridation de notre présent et de ce très lointain, du sang mêlé de l’ancien et du contemporain dépend notre avenir. Qu’un nœud gordien ait attaché le futur et l’ancien, comme les textes et les âmes, voilà qui demeure embarrassant, indu pour notre temps. Nous avons la particularité d’avoir imposé progressivement la partition des vivants et des morts, des contemporains et des très lointains. Or ce que nous nommons encore Antiquité devrait ici apparaître comme un texte-épreuve offert au monde futur. »
Nous voici autorisés à reproduire, par notre propre lecture du texte livré à notre rencontre à « faire Virgile », à notre tour.
Fascinant retournement de perspective ! Nous voici autorisés à reproduire, d’une certaine manière, le travail du traducteur par notre propre lecture du texte ainsi proposé, livré à notre rencontre, notre parole même : comme une invitation, précisément, à « faire Virgile », à notre tour. Parler, en somme, à ce(ux) qui nous parle(ent), de loin. Et dans cette expérience, son trouble même, il est normal que se joue ce que nous vivons, ce que nous avons à vivre… Frédéric Boyer relie de la sorte son ouvrage à la double expérience du deuil qui fut la sienne il y a peu, alors même qu’il travaillait à ses Géorgiques, perdant à quelques mois d’intervalle deux de ses êtres les plus chers, les plus proches, qui « furent (ses) interlocuteurs de longues années durant, Anne et Paul ».
Le lointain-près du texte antique trouve un écho dans l’épreuve, individuelle et universelle, premièrement douloureuse, de l’absence subie. Et la poésie retourne alors, possiblement, le « faire » du deuil en un « être » de la terre… « Le miracle qui sauve la terre de la destruction, c’est la naissance d’être nouveaux. Le fait que d’autres nous succèdent sur la terre pour occuper les lieux. Les seuls. Non, pas de lieu dans la mort. Lecteur contemporain des Géorgiques, je comprends, écrit Frédéric Boyer, que le chant de la terre et de la vie sur terre s’oppose à l’étrange nostalgie de ce passage possible entre terre et non-terre. »
Le grand sujet du poème virgilien, du coup, c’est peut-être ce dont il ne parle (presque) pas en apparence, sinon à la fin du Livre IV, dans la réécriture de l’épisode mythologique d’Orphée (figure à laquelle l’auteur-traducteur consacra naguère une sorte d’essai autobiographique, magnifique), mais qui se révèle partout présent, comme par contraste : la vie des morts. « Que savons-nous de la terre et, par conséquent, de la « non-terre » ? Quelle connaissance en avons-nous ? Avec cette ambition poignante de porter notre attention, notre langage, aux objets de la terre. À tout ce qui nous fait être et exister sur terre parmi d’autres vivants. Si notre destin fut illusoirement de conquérir la terre, il est vain d’imaginer pouvoir la quitter et la retrouver. Notre souci, c’est elle. Moins dans la conquête que dans le désœuvrement qui conduit à son observation et à l’amour. Au lieu de vie, l’unique lieu. Et au poème. » Jamais alors, disons-le, on n’avait lu de plus belle invitation à « faire Virgile », ici et maintenant.
Virgile, Le Souci de la terre, traduit du latin par Frédéric Boyer, Gallimard, 264 pages.
