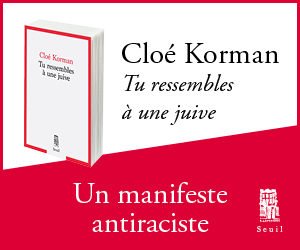La critique selon Jean Douchet (1929-2019)
« Ma méthode est fondée sur la sensibilité. » Lorsqu’au mois de mai 1987 il dit cela à ses confrères de la génération suivante, Serge Daney et Jean Narboni, Jean Douchet est exactement au milieu de son parcours de critique. Cela fait 30 ans qu’il a commencé d’écrire aux Cahiers du cinéma, et quasiment jusqu’à sa mort, à 90 ans, le 22 novembre 2019, il continuera d’exercer l’idée très personnelle qu’il se fait de son activité.
Critique de cinéma, il a donc écrit des articles (135, ce qui n’est pas un chiffre si élevé au regard de la durée de son activité), et des livres, deux sous son seul nom, consacrés à Hitchcock en 1967 et la Nouvelle Vague en 2004, un autre, Paris cinéma : une ville vue par le cinéma de 1895 à nos jours, avec Gilles Nadeau, à quoi s’ajoute deux recueils d’articles, L’Art d’aimer et La DVDéothèque de Jean Douchet, plusieurs contributions à des ouvrages collectifs, et un livre d’entretiens avec Joël Magny, L’Homme-cinéma.
Conséquente mais limitée, cette bibliographie ne rend pas compte de l’ampleur gigantesque de la pratique critique de Douchet. C’est que sa manière de faire de la critique aura surtout été orale. Jeune critique aux Cahiers du cinéma, qu’il codirige aux côtés d’Eric Rohmer de 1959 à 1963, contributeur un moment de la revue Arts, plume occasionnelle de plusieurs périodiques, à nouveau collaborateur régulier de la revue fondée par Bazin à partir des années 2000, Douchet n’a certes jamais mésestimé l’importance de l’écrit.
Mais l’énoncé oral, et plus encore la présence incarnée de celui qui se livre à l’exercice critique, aura toujours été le cœur de sa pratique. Celle-ci se sera manifestée lors d’innombrables discussions de films, dans des salles ou tout autre lieu public qui lui en donnaient l’occasion, y compris l’université où il a enseigné durant les années 1970 et 80. Mais aussi dans un exercice assez particulier, qu’il a développé avec une maestria sans égale, celle des bonus pour les DVD.
Ce rapport triangulaire – le film, lui, les mots – n’est nullement anecdotique. Il est entièrement en phase avec la critique selon Jean Douchet, et la manière dont il aura pensé et transmis le cinéma durant une soixantaine d’années – une manière extraordinairement cohérente. Il l’évoque en des termes quasiment identiques en 1961 dans son texte réflexif sur cette activité, article des Cahiers du cinéma n°126 dont le titre, « L’art d’aimer » deviendra 26 ans plus tard celui du premier recueil de ses textes, en 1987 dans l’entretien avec Daney et Narboni qui ouvre ledit recueil, et près de 20 ans plus tard dans sa conversation avec deux autres rédacteurs des Cahiers, en ouverture du livre qui réunit ses chroniques concernant des DVD.
Douchet ne s’est jamais voulu un théoricien. Il aura incarné jusque dans sa silhouette rabelaisienne une relation corporelle, sensuelle, tactile avec les films. Lorsqu’il quitte les Cahiers du cinéma en 1964 suite au « coup d’état » qui a renversé Rohmer pour faire place à Rivette, il commence cette pratique intensive de la parole à propos des films, pratique qui ne s’interrompra plus. Il y déploie de manière encore plus reconnaissable cette approche qui « passe par la sensation », selon sa formule.
Si Douchet est évidemment aussi un érudit, qui connaît remarquablement l’histoire du cinéma, celle-ci n’apparaît dans ses écrits et dans ses paroles qu’en renfort du « ressenti » que lui inspire un film. Bien que contemporain du déploiement de la politique des auteurs aux Cahiers du cinéma, et y ayant volontiers souscrit, se faisant par exemple le héraut du génie de Mizoguchi et de l’importance de Preminger, au fond pour lui les auteurs importent moins que les films, pris un par un.
Il pouvait avoir la dent très dure, voire parfaitement injuste, c’est qu’en fait l’art d’aimer concernait, plus encore que tel ou tel film, tel ou tel réalisateur, le cinéma lui-même.
Son dogme, qui ne variera jamais, est qu’il faut parvenir à percevoir le mouvement intérieur d’un film, dans la proximité absolu de ce qui le meut, c’est à dire sa mise en scène, et de ce qui l’émeut, lui, le spectateur. Il sera temps ensuite, éventuellement, d’identifier les permanences d’un film à l’autre du même auteur, de repérer la continuité de ce mouvement, qu’il lui arrive d’appeler « l’écriture » : c’est à dire l’ensemble des décisions de réalisation qui caractérisent un cinéaste particulier.
Le film avant l’œuvre complète, donc, et pour s’approcher du film, très souvent, son composant de base : le plan. Douchet deviendra célèbre par sa manière d’analyser les mouvements internes d’un plan, mettant en évidence, et en relation, le déplacement des personnages, les éventuels mouvements de caméra, la circulation des regards (ceux des protagonistes à l’intérieur du cadre et ceux des spectateurs par l’utilisation de points d’attention), mais aussi l’organisation de l’espace, par la lumière, par le son, par la profondeur de champ, etc.
De Fritz Lang à Hou Hsiao-hsien en passant par Renoir et Brian De Palma, les styles, voire les idées du cinéma diffèrent considérablement, les ressorts, souvent intuitifs, sont les mêmes. Pour avoir, étudiant au début des années 70, suivi toute une année un cours de Douchet uniquement dédié aux films de Minnelli, je peux témoigner de l’extraordinaire faconde avec laquelle il pouvait parler une heure durant d’une coupe entre deux plans, du recadrage d’un geste ou d’un changement de focale.
Rien de superflu dans cette parole enjouée, toujours comme traversée d’un rire intérieur, qui était plutôt la trace du plaisir qu’il éprouvait à voir les films et à en parler. Parler de Minnelli toute une année à cette époque ? On mesure mal l’exploit, devant un amphithéâtre toujours plein, mais plein d’un auditoire qui d’ordinaire ne voulait entendre parler que de brulots révolutionnaires et de films politiques – ce dont Douchet ne se sera jamais soucié. Sa crinière de lion déjà argentée en bataille, immuable foulard de soie autour du cou, il parlait des films avec une gourmandise à la fois inspirée et amusée.
Lui qui se sera toute sa vie revendiqué épicurien aura fait du plaisir, le sien propre et celui de ses auditeurs et éventuellement lecteurs, une vertu cardinale de la pratique critique. Amateur de bons vins et de bonne chère, munificent dans ses amitiés et ses amours comme dans ses enthousiasmes littéraires, théâtraux, d’opéras tout autant que cinématographiques, il faisait de cet impératif du plaisir le pendant logique de ce qui lui faisait désigner la critique comme « l’art d’aimer ».
Mais si la formule avait quelque chose de provoquant à propos d’une activité, la critique, couramment perçue comme vouée à l’attaque, à l’ironie, à la mise en crise (son étymologie grecque : krinein), Douchet n’était certes pas du genre à tout aimer. Même s’il affirmait préférer écrire des textes en faveur des films qu’il critiquait, il pouvait aussi avoir la dent très dure, voire parfaitement injuste. C’est qu’en fait l’art d’aimer concernait, plus encore que tel ou tel film, tel ou tel réalisateur, le cinéma lui-même. Et c’est au nom de cet amour illimité pour ce qu’il attendait et espérait du cinéma qu’il pouvait être extrêmement violent contre ceux qui, à ses yeux, le trahissait ou le servait mal.
Sans recourir aux dispositifs de réflexion et de formulation de la théorie, il revendiquait malgré tout un projet théorique, la construction, par les mots de la critique, d’une pensée de ce qui fait que l’art du cinéma est ce qu’il est, et même une pensée de ce que c’est que l’art dans le monde. Lorsqu’il écrit « au-delà de l’artiste, le critique vise à comprendre et à expliquer l’art », il faut entendre à la fois cet art particulier, celui que pratique l’artiste en question, donc l’art du cinéma, et l’art « en général », ce que Douchet désigne comme « le mystère de l’art ».
Mais cette généralité ne sera jamais formalisée en tant que telle, elle n’existera et ne sera éclairée que de la multitude des approches que permettent ses manifestations concrètes, les œuvres, toujours considérées une par une. Et non seulement considérées mais, si on peut dire, reconsidérées, autant de fois que possible.
Douchet affirmait que chaque fois qu’il devait parler d’un film ou écrire à son propos il le revoyait pour l’occasion, au plus près du moment de s’exprimer, sans jamais prendre de notes – « il faut revoir, c’est impératif, au plus près de l’article à écrire. À chaud, pas huit jours avant. Prenons La Règle du jeu : j’ai beau l’avoir vu deux à trois cent fois si d’aventure je dois faire un article ou une intervention, je le revois. Toujours surgissent des choses nouvelles ou de choses oubliées. ».
Cette proximité sans cesse réactualisée, si elle permettait à Jean Douchet de ranimer en lui-même non pas la flamme de son amour du cinéma mais la flamme très particulière alimentée par ce film-là et aucun autre, lui sert également à éviter ce qu’il tient pour deux des principaux écueils, que dis-je, des principaux péchés mortels – avec lui, on fait rarement dans la demi-mesure.
Un de ces péchés est, on s’en doute, l’abstraction. Lui que le cinéma dit « expérimental » n’a jamais intéressé se défie de toute généralisation qui troquerait un point de vue plus ample mais surplombant contre le voisinage immédiat, charnel, avec les films. D’où, aussi bien, son inintérêt viscéral pour les films militants, ou à message politique.
Son départ des Cahiers de cinéma en 1964 tient bien sûr à ce qu’il faisait partie de la « bande à Rohmer », qui vient d’être remplacée par « la bande à Rivette », mais Douchet se sentira aussi d’emblée étranger à ligne de celle-ci, animée par Jean Narboni et Jean-Louis Comolli, avec à la fois une forte inclination à gauche sur le plan politique, et un intérêt prononcé pour les grands débats intellectuels de l’époque. C’est au moment où sont conviés dans les pages de la revue Roland Barthes, Claude Levi-Strauss, Pierre Boulez… que Douchet s’en va.
Toute sa vie il aura refusé l’esprit de système, au principe du structuralisme qui domine alors la vie intellectuelle française. « Aucun ordre ne préside » dira-t-il à nouveau en 2006. Le deuxième écueil vigoureusement dénoncé par Douchet est ce qu’il nomme « l’extrapolation », ou parfois le délire d’interprétation. C’est à vrai dire un défi exigeant que lance ici le critique, y compris à lui-même. Car lui qui affirme « la vraie critique « invente » une œuvre, comme on le ferait d’un trésor : elle capte, entretient et prolonge sa vitalité » n’a pas de mots assez durs contre ceux qui s’emparent des films pour développer leurs propres constructions. Il faut, selon lui, aller très loin, mais toujours « avec » le film, sans jamais lâcher ce qui vient directement de lui. « Inventer », oui, mais plutôt au sens de déployer au plus vaste, au plus sensible, au plus lisible ce qui était déjà là.
Douchet en vient à faire des cinéastes les observateurs critiques de la réalité, avec des moyens qui sont ceux de la mise en scène, avec leur écriture.
Aussi paradoxal que cela puisse paraître, le rapport le plus direct de Jean Douchet à la théorie sera passé par… le théâtre. Comme ses pairs critiques aux Cahiers dans les années 50, il s’est, au moins un peu, aussi voulu réalisateur. Il signe en 1965 une élégante contribution au film à sketches qui servit alors de manifeste à la Nouvelle Vague, Paris vu par… aux côtés de Godard, Rohmer, Chabrol, Rouch et Pollet.
Il tournera également souvent pour la télévision, mais son seul long métrage, tardif dans son parcours, est une admirable mise en scène cinématographique d’une pièce de Goldoni, La Serva amorosa, sous le titre La Servante amoureuse (1995). Subtils et enjoués, les jeux de masques à l’intérieur du déroulement de la pièce servent de carburant à une méditation implicite, mais très lisible, sur les écarts et possibles circulations entre réalité et multiples formes de représentations et d’apparences.
Le réel des sentiments et des rapports de force décrits par Goldoni, mais aussi le réel de l’appareil théâtral, et bien sûr le réel des corps des acteurs participent de cette méditation à la dialectique acérée, sous les apparences de la comédie. Mal connu, ce film mériterait pourtant de figurer auprès des grandes œuvres où le cinéma s’interroge par le détour de la scène, de Welles et Renoir à Oliveira en passant par Rivette, Fassbinder et Jacquot. Mais il ne s’agit pas seulement, ni même principalement de relations entre deux arts de la représentation, théâtre et cinéma, il s’agit du monde, de la réalité.
Ayant toujours professé un dédain sans réserve pour ceux qui privilégient, dans les films, la question du sujet, et s’étant tenu éloigné de toutes les formes d’instrumentalisation du cinéma, notamment à des fins politiques, Douchet n’en était pas pour autant un esthète coupé du monde.
Et s’il lui importait au plus haut point que ce rapport à la matérialité des êtres et des choses se place sous le signe d’un hédonisme revendiqué, celui-ci ne masque pas entièrement une attention, à l’occasion inquiète, à la présence active des forces qui gouvernent les existences, privées et sociales.
Il admettait la présence active, décisive du réel, mais en en confiant la charge aux artistes, aux cinéastes plutôt qu’aux critiques – ou à tout autre commentateur. S’appuyant sur une formule attribuée à Fritz Lang, « tout art doit critiquer quelque chose », il en vient ainsi à faire des cinéastes les observateurs critiques de la réalité, avec des moyens qui sont ceux de la mise en scène, avec leur écriture.
Aux critiques, ensuite, de mettre en lumière cette écriture, ses modes de fonctionnements, pour permettre à chacun de se rendre mieux sensible au travail critique effectué par le film. Mais surtout pas de prétendre parler à la place de l’artiste, la paraphrase figurant en bonne place parmi les péchés honnis par Jean Douchet.
Si les artistes du cinéma ont la capacité de critiquer le monde grâce à leur mise en scène, il revient aux critiques de cinéma de rendre perceptibles les processus que mobilisent les réalisateurs, et ainsi de suggérer, plutôt que démontrer, la relation au monde de chacun d’eux – chaque film, et si possible chaque ensemble de films du même auteur.
Il s’agit ainsi d’entrer, à tâtons, dans ce que Jean Douchet définit en référence à un des rares philosophes qu’il ait jamais invoqué, Gaston Bachelard (dont il avait suivi les cours après guerre) : l’imaginaire.
À ses cadets Narboni et Daney, qui furent l’un après l’autre des figures intellectuelles majeures de la critique aux Cahiers du cinéma, Douchet résume d’une formule aussi lapidaire que fulgurante le processus de ce qu’il dévolue à la critique : chaque cinéaste a son écriture, soyons son Champollion. Encore faut-il que le réalisateur du film critiqué soit aussi cinéaste. Mais des autres, les plus nombreux, tous ceux qui réalisent des films sans qu’il se puisse repérer chez eux une écriture, Douchet ne se sera pratiquement jamais soucié.