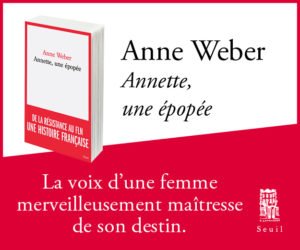Gazouillis et grognements – sur Sátántangó de Béla Tarr
« Qu’est-ce que t’as de mieux à faire » ? Rien. Question qui m’accule autant qu’elle me libère. Cet après-midi-là, je suis, en outre, effroyablement triste, rongée par le sentiment d’être vieille et finissante. Dans la salle de cinéma où j’ai rejoint mon ami, nos voisins ont préparé des thermos de café. Certains s’équipent, pour assister aux 7 heures 30 minutes de Sátántangó, chef d’œuvre de Béla Tarr, fresque monumentale et enténébrée aux confins d’un monde.
Un envoûtement qui commence par des vaches. Dans l’atmosphère détrempée d’une campagne boueuse, devant une grange délabrée, un plan-séquence enregistre des vaches en train de ne rien faire ou presque, indifférentes à la bruine. Lents mouvements de caméra, ambiance de désolation brumeuse, disparition des hommes : pas de doute, on est chez Béla Tarr, cet obsessionnel du cosmos – dont il ne cesse d’envisager la fin et la recréation à longueur de film –, juste avant l’engloutissement dans ses nappes de noir et blanc crépusculaires, au seuil étrange du printemps qui commence dehors, et de la décomposition sur écran noir d’un monde de vent et de pluie, de plaines rases et de fermes soviétiques. Je pense : Sátántangó, go.
Un événement vient secouer le climat de déréliction stagnante du village : une rumeur annonce le retour de deux anciens supposés morts, Irimias et Petrina. Tandis que certains attendent une mystérieuse parousie, conciliabules et conjectures commencent, entre espoir messianique et crainte satanique. À la suite de l’étrange apparition d’Irimias, magnétique semeur de zizanie lente dont personne ne sait qui il est, les villageois complotent les uns contre les autres pour empocher des gains agricoles. Sous l’effet de ce prophète infernal ou ange exterminateur, c’est toute l’utopie collectiviste qui révèle son effondrement.
C’est cette humanité grimaçante, à l’image de celle de Bosch et Bruegel, que capture Béla Tarr, dans des plans-séquences qui semblent porter chacun au bord de son monstre. Au bar du village, tous se rincent à la Palinka, soliloquent et radotent, s’engueulent et, frénétiques et macabres, dansent jusqu’à l’épuisement. La caméra scrute leurs inlassables logorrhées, leurs mouvements mécaniques d’ivrognes hantés, en les dilatant à l’extrême, produisant un effet de narcose visuelle, peut-être de nausée, celle qu’on éprouve dans un manège qui se refuse à finir.
Si Sátántangó dépeint la fin d’un monde, c’est parce qu’aucun renouvellement humain n’y est possible.
Pris dans d’interminables schémas répétitifs, les personnages de Sátántangó sont pétrifiés dans une mécanique du même, transformés en momies par une temporalité qui ne s’écoule plus comme par les innombrables couches de manteaux qu’ils ne cessent de porter, de retirer, de ré-enfiler. Rien n’avance, tout piétine : ni le tic-tac des horloges, devenue scansion permanente, ni la perpétuelle réitération des gestes quotidiens – manger une soupe, s’installer sur son lit – n’épousent ce qui devient. À l’image du personnage du docteur, qui tente de consigner la totalité des faits et gestes des habitants du village, Béla Tarr filme les mêmes scènes selon une multiplicité de perspectives : le cosmos est clos, clôturé, rien ne peut s’y métamorphoser. Le temps, à force d’être étiré, s’est suspendu.
Les marches des personnages ont beau être opiniâtres, les chemins qu’ils empruntent ne semblent mener nulle part, silhouettes rivées dans un éternel surplace ; les gouttes de pluies dégoulinent en flux continu à la surface des visages burinés, chassées les unes par les autres dans un insécable perpétuité ; les turpitudes des êtres sont noyées et aussitôt ressassées dans l’eau-de-vie. Si Satan Tango dépeint la fin d’un monde, c’est parce qu’aucun renouvellement humain n’y est possible. Seuls les animaux abritent, peut-être, de l’imprévisible, du neuf : sous la pluie battante, les vaches se montent dessus, tandis que dans la nuit, une chouette s’évapore. Par la procréation ou la disparition, seuls les animaux ouvrent une brèche dans la répétition.
Dans ce réel lugubre qui patine, toute figure du temps – l’enfant ou l’animal – est abolie. À l’image de cette scène sidérante de violence dilatée, où se concentre une triple mort – celle de la petite fille, du chat, du temps. Sans urgence, avec la détermination de ce qui doit arriver, une petite fille empoisonne un chat avec de la mort-aux-rats, avant d’en avaler à son tour.
Le rythme des films de Béla Tarr n’est ni le temps, ni l’éternité, quelque chose de l’ordre de la persistance, d’une durée sans devenir. Pendant les 7 heures 30 minutes, les (mes) divagations fluctuent. Je pense aux paresseux de Zootopia, qui prennent une minute pour prononcer un mot. À mes angoisses de temps qui passe – que Sátántangó soudain éloigne en en suspendant le décompte.
Rien ne semble pouvoir interrompre Sátántangó. Telle est son aura de film suprême, monstre, sublime, hors-norme : rien ne peut y finir. Voilà bien ce que serait un tango avec Satan : une danse infernale parce qu’interminable, une valse sans rupture, aux mouvements inépuisables car identiques. Les plans-signatures de Béla Tarr prennent alors tout leur sens : ne nous reste à voir que le dos des personnages, puisque l’horizon n’est plus. Est-ce la présence massive et empesée des hommes qui rendent le lointain inscrutable ? C’est finalement la porte d’un manoir ouvrant sur un abîme de noir qui, dans un plan grandiose, ouvre une brèche.
Béla Tarr dissout les limites de son cadre, suggérant la continuité ad infinitum d’une plaine.
Plus le film avance, plus l’hypnose s’intensifie. Il paraît que je me suis assoupie au début. Avant d’être embarquée dans la double sensation de lévitation et de pesanteur que produisent les travellings de Béla Tarr. Les ivrognes s’écroulent de toute leur masse à même le sol, les femmes sont en chair et en gorge, puissantes et denses, les plaines sont lourdes de l’eau qu’elles absorbent : des blocs de matière qui germinent à même l’image. Et le son postsynchronisé qui donne la même matérialité bruyante au ploc pluvieux et aux murmures : impression que les atomes – des plaines, des voix – persévèrent.
Les voisins au thermos de café sont partis. Les images de Béla Tarr sont denses et impénétrables, mélanges de substance et de surface. Béla Tarr dissout les limites de son cadre, suggérant la continuité ad infinitum d’une plaine. Tout est là, dans le cadre, sous nos yeux, dans l’émergence d’une grange, d’un arbre noir, de routes battues par la pluie, de nuances de gris qui semblent s’intensifier à mesure qu’on les regarde. Dévoré par les travellings, le hors-champ, subsiste l’inexploré. L’énigme change de place : elle est dans le plein des images, au sein de leur matérialité envahissante, dans le mystère de cette caméra qui, scrutant jusqu’à l’écœurement, nous ramène à notre désir de voir quelque chose.
Mais y a-t-il autre chose dans une pomme de terre, qu’une pomme de terre ? Il n’y a pas de salut au ras-des champs, ni de transcendance dans une fuite en carriole ou un envol de chouette. Clarté et ténèbres cohabitent, sans se mélanger, tandis que le gris n’exprime aucune réconciliation. Subsiste quelques trouées de légèreté, de soupapes d’air dans l’obscurité viciée et terreuse qui environne les personnages : il y a bien du grotesque dans ces prostituées au chômage, chez ce docteur qui s’écroule en se piquant la fesse, ou dans cette chouette qui pète. Béla Tarr est plus joueur qu’il n’y paraît, pratiquant un humour de carnaval, à la limite d’un éclat de rire (jaune).
Des « gazouillis et des grognements » en somme, pour reprendre le titre d’un chapitre de la Mélancolie de la résistance – texte qui par ailleurs a inspiré Les Harmonies Werckmeister – de l’écrivain hongrois Laslo Krasznahorkai, avec lequel Béla Tarr tisse son œuvre. « Gazouillis et grognements », deux mots qui évoquent à la fois l’aurore et l’aigreur, l’innocence et la déception. Des sons, peut-être des langages, capables d’être émis ensemble, tout comme l’engloutissement tragique d’un monde peut se fêter au son d’une mélodie d’accordéon.
Béla Tarr, Sátántangó (Le Tango de Satan), 1994.