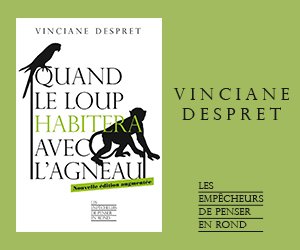Candeur crapule et musique folk – à propos de l’album Gueuseries de Paris Banlieue
En 1988, concluant une chronique amoureuse du duo espiègle Les Calamités, j’écrivais : « Combien de fillettes se mettront-elles à la guitare en usant cet album sur le mange-disques familial ? » Les trois adolescentes de Paris Banlieue n’étaient pas nées quand « Toutes Les Nuits » ou « Vélomoteurs » égayaient la bande FM. Pourtant, le filiation est frappante, dans ces dégaines de catéchisme et ces grosses attitudes délurées.
À elles trois, Clara Pernas, Léonor Pernas et Adèle Duhoo n’ont pas 50 ans. Elles connaissent pourtant Les Calamités. Par des connections familiales. Peut-être le même réseau qui a fait passer une maquette du trio à Sylvain Quément, de la station pour enfants Radio Minus. Étonné, il s’est déplacé chez Adèle avec ses micros et sa bienveillance pour enregistrer Paris Banlieue dans son habitat naturel. Sans se douter que ces enregistrements bruts deviendraient Gueuseries, le premier album du groupe. L’un des plus frais, intenses et excitants de l’année en cours. À l’unisson, elles proclament, ferventes, que la musique a sauvé du néant leur vie, leur conversation, leurs humeurs, leurs corps… Ça compte, la musique.
Sage et cancre à la fois : le trio approche de très près la définition de l’anti-folk, excroissance monstrueuse et ravissante de la musique acoustique américaine du début du siècle. Un folk joué en toute incompétence, mais avec l’entrain, la fougue, le toupet qui compensent. « Nous ne sommes pas anti-folk mais nous sommes anti-cynisme, anti-Éducation Nationale, anti-Elton John, anti-Queen… »
Musicalement, les trois filles de Paris Banlieue ne se sont pourtant pas construites anti, contre, en réaction. Elles étaient pour. Pour la fureur de dire, pour les désirs hormonaux de musique, pour l’approximation, pour l’art brut, pour l’urgence de faire, sans respect des règles. Du coup, toute pauvrette mais jamais négligée par snobisme, la musique de Clara, Léonor et Adèle n’appartient qu’à elles. Comme dans la période déblayée de l’after-punk anglais, le do it yourself fait à nouveau ici des étincelles avec peu, du vacarme avec des murmures. C’est l’école Marine Girls ou Raincoats de la pop anglaise d’autrefois que ravivent sans le savoir les trois ados.
Car on a l’impression que Paris Banlieue, sans posture, sans frime, est de la famille de monsieur Jourdain. La musique que jouent les trois filles, en toute candeur crapule, elles ne la connaissent pas. Mais elles sont curieuses de tout, sur le qui-vive. On les voit noter immédiatement les noms d’artistes ou les titres de chansons qu’on leur suggère : « Le Petit Chevalier » de Nico ou les deux new-yorkais de Moldy Peaches… Surtout quand on leur dit que l’une des influences profondes de ce duo n’est autre qu’un de leurs héros absolus : le mini-mâle Jonathan Richman, dont elles pleurent chaque jour l’absence sur les scènes parisiennes. « C’est une quête, confirme Adèle. Quand on découvre un nouveau groupe, c’est la lumière de notre journée, on ne parle que de ça, on imagine des histoires, on s’immerge dans un univers… Nous sommes totalement geeks de musique. »
Adèle aussi est tombée en admiration devant cette esthétique ligne claire, devant le son aussi sauvage qu’épuré du rock primitif.
Pour les deux sœurs Parnas, la quête a commencé dans une famille où règne la musique, dès leurs 5 ans. On leur offre une compilation de rock, elles tombent en admiration devant une musique burinée et agitée comme des grands-parents indignes : le rockabilly. Eddie Cochran, Jerry Lee Lewis, Gene Vincent ou Elvis deviennent une obsession. Les copines d’écoles, définitivement, ne comprennent pas. Une raison de plus de détester leur scolarité, ces programmes imposés. « Ceci dit, heureusement que nous avons l’école, sourit Léonor. Ça nous donne de bonnes raisons de nous plaindre ! »
À l’école pourtant, en classe de cinquième, fraîchement transbahutées de Madrid vers Paris, les sœurs Parnas découvrent dans leur classe une fille qui non seulement ne les moque pas, ne les juge pas, mais s’intéresse à leurs goûts d’OVNI. Après tout, Adèle aussi est tombée, grâce à Ricky Nelson ou la série Happy Days, en admiration devant cette esthétique ligne claire, devant le son aussi sauvage qu’épuré du rock primitif. « Autant j’adore cette musique, rigole Adèle, autant je suis incapable de danser le rock’n’roll. Je suis trop rigide. » Pas grave : elle jouera de la guitare. Elle pique d’abord celle de sa mère, avant de s’en faire offrir une dès le prochain anniversaire.
Les trois filles inventent alors une nouvelle forme de soirée pyjama : leurs légendaires « Soyons Stray Cats Pour Une Nuit ». Des nuits blanches entre copines, à rêver de leur futur groupe de rock, à papoter sans fin de postures rebelles. Elles commencent même à écrire des chansons en anglais, forment un premier groupe, qu’elles imaginent extraverti, flamboyant. La musique qu’elles jouent n’existe pas dans leur école : c’est de la country-music américaine, sous le nom de The West Bees. Qui implose lamentablement sur la scène d’un tremplin inter-collèges, où les trois filles redécouvrent qu’en réalité, elles sont timides et coincées. La vie n’est pas une Soyons Stray Cats Pour Une Nuit. Dommage.
Très vite, l’émulation tourne pourtant à plein régime entre les trois adolescentes, avec Adèle en fournisseuse officielle de « nouveaux sons » dénichés sur le net immédiatement partagés, adoptés avec intimité. On parle du Velvet Underground, des Kinks… On parle de filles de 13 ans…
Au cinéma, aux concerts, Adèle et les fangines Parnas sont ainsi régulièrement les plus jeunes dans la salle, souvent d’au moins cinquante ans. « Ça été notamment le cas au concert des Pretty Things, où la moyenne d’âge était de plus de 60 ans, que des messieurs… Mais beaucoup sont venus nous féliciter de nous intéresser à cette musique », se souvient Clara. Ça ne leur arrive jamais au lycée, où les rares fans de guitare ne partagent avec elles que leur passion pour les Beatles et Clash… « Joe Strummer est trop beau », minaude Clara. C’est un moment délicieux de remise en perspective. « Mais pour moi, lui répond Adèle, le punk ultime, c’est Jonathan Richman, pas les Sex Pistols. »
Devant une boîte aux lettres jaune des PTT, Adèle a alors une révélation : la fente pour le courrier Paris Banlieue. Elle tient le nom du trio. Et une publicité gratuite et massive pour le nom de son groupe ! Très vite, elle déniche aussi une première vraie chanson, « Déprime Song », sur un texte écrit par Léonor au sujet de sa propre dépression, écrasante. Adèle : « La mélancolie est mon sentiment préféré, je me complais dans la nostalgie. » Ça semble nettement moins confortable chez Léonor.
Si nous sonnons comme une réaction à notre époque, c’est inconscient.
C’est le moment de se souvenir que fillette, Adèle écoutait des chansons de Boris Vian. Ça n’est pas tombé dans l’oreille interne d’une sourde : ses chansons aujourd’hui portent le joug joyeux de cette influence surannée, mélange de loufoquerie et de gravité, de potache et de macabre. « On adore l’humour noir, répond-elle. Il existe trop peu de chansons sur les estropiés. Comme Katerine, on aime écrire des paroles qui donnent l’impression de n’avoir aucun sens mais qui sont très personnelles. Mais ça va évoluer. On n’exclut pas de jouer un jour accompagnées d’un orchestre symphonique ! On n’a jamais réfléchi à notre style musical, à une direction… On a joué ce qu’on pouvait jouer. Si nous sonnons comme une réaction à notre époque, c’est inconscient. »
À part les années 50 et 60 pour leurs musiques, Adèle vénère aussi les années 80. On parle de 1280, des peintures de Giotto, des poèmes de Dante, du Moyen-âge auquel les trois copines rendent régulièrement visite au musée de Cluny. « J’ai toujours été une geek du Moyen Âge. Et puis un jour, alors que je cherchais à percer le mystère de la musique médiévale depuis des années, j’ai trouvé un accord qui évoquait ces ballades anciennes », se réjouit Adèle. Ça donne notamment « Prompt Chevalié », une des choses les plus bizarres entendues en confinement.
La musique du Moyen Âge, la création de vêtements, la mise en scène ou le dessin comptent ainsi parmi les nombreuses passions d’Adèle Duhoo, par ailleurs auteure prolifique de fanzines, de BD, dont le truculent Magazine WiFi. « Je suis incapable de ne rien faire car quand je ne fais rien, je suis assaillie par les idées. »
Parfois, quand elles vont au cinéma, les trois amies ferment les yeux. Pas parce qu’elles ont peur : juste pour jouir pleinement de la musique. Et de BO, elles sont gourmandes, citant Bernard Hermann, le générique de Ben-Hur par Miklos Rozsa, François de Roubaix ou Eric Demarsan comme des ascenseurs pour l’extase. On ne saura pas ce qu’elles, à 15 et 16 ans, pensent du cinéma pop-corn : elles répondent Eric Rohmer, Howard Hawks, John Ford, Alfred Hitchcock…
Ne leur dites pourtant pas que ces films et disques qui hantent leur Panthéon ne sont pas de leur âge : elles sortent alors vite de leurs gonds. Adèle : « Je ne supporte pas cette discrimination contre les enfants. Je déteste que les adultes me tutoient par principe, qu’il existe des menus enfants sans choix au restaurant, que les familles séparent les tables enfants et adultes… »
Sur l’album, une chanson explique cette rébellion, cette rage que ne trahissent jamais, à leur désespoir, leurs airs sages. Elle s’appelle « Punk dissimulé » et restera comme une des choses les plus bouleversantes lues en 2020. « Mon cher Sid Vicious / Je t’admire tellement / Tu oses montrer / Ta haine envers la société / Alors que moi / J’ai peur de tout / De la police, de mes parents / Et encore plus de mes enfants / Inconsciemment j’ai opté / Pour la forme pathétique du punk / Celle qui nous fait faire en cachette / des actes dissimulés… » Clara se souvient ainsi du jour où, à un surveillant de son collège, elle avait affirmé : « Je suis une punk ». Son éclat de rire la traumatise encore. « Je me suis rendu compte que je passais pour une fayote. » « Il y a pire, conclut Adèle. C’est d’être décrite avec paternalisme non comme une punk, mais comme une punkette. »
Combien de fillettes se mettront-elles à la guitare en usant Gueuseries sur le Spotify familial ?
Paris Banlieue, Gueuseries, 2020