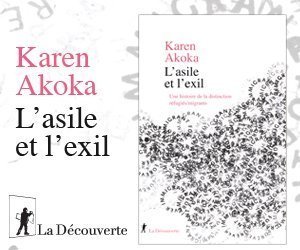Faire taire le silence – sur Chienne de Marie-Pier Lafontaine
Chienne, de Marie-Pier Lafontaine, est un roman. C’est en tout cas ce qui est écrit sur la couverture du livre paru en septembre 2020 en France aux éditions Le Nouvel Attila, juste en dessous du titre.
Pourtant, de nombreux signes paratextuels viennent détromper le lecteur, en tout cas flouter, troubler la frontière de la fiction juste après qu’elle a été posée, comme pour l’inviter à ressortir, à rester sur le seuil en tout cas. Le livre est entouré d’un bandeau, dont le recto annonce la couleur en sepia : le portrait en verre d’une petite poupée, brisé. Le verso, lui, résume l’histoire et la présente comme une fiction, ou presque :
« Deux sœurs sont soumises durant leur enfance et leur adolescence à toutes les humiliations. Tenues en laisse, obligées de marcher à quatre pattes, empêchées d’uriner, frappées. La mère est le témoin muet de ces agressions répétées qui provoquent au père un plaisir sadique renouvelé. Viol suspendu, inceste latent, jamais consommé. Un style lapidaire pour dire l’innommable et la monotonie de l’horreur. Chienne est, racontée à la première personne, l’histoire d’une jeune fille démolie qui s’appuie sur les pouvoirs de la littérature pour retrouver un corps et une parole. Et quand elle mord, ça fait mal. »
La dimension littéraire de la démarche est attestée par un autre élément du bandeau, plus discret : le parcours de l’autrice dont l’enfance est alors évoquée uniquement comme berceau d’une vocation d’écrivaine (« toute son enfance elle écrit des nouvelles ») qui la conduit à « des études de création littéraire ». Avec cette précision toutefois, qui vient recoller l’image de l’autrice et celle du personnage : « aujourd’hui elle boxe, et pas seulement dans l’écriture ». En dessous, quand on ose ôter le bandeau, courant de la quatrième à la première de couverture, écrits à la perpendiculaire et à l’envers, en très gros caractères rouges, ces mots :
« Je dissimulais mes désirs dans des textes de fiction, enfant. Deux sœurs en fugue. Pourchassées par un monstre à deux têtes. Elles s’enfuyaient dans de sombres forêts. S’armaient de branches, de bâtons. Aujourd’hui, je ne cache plus mes désirs. Je voudrais que ce texte décime ma famille entière.
Si papa dit jappe. Je jappe. Si papa dit rapporte. Je rapporte. Si papa dit lèche ta patte. Je lèche ma patte. Si papa dit sens les fesses de ta sœur. Je sens les fesses de ma sœur. (…) Si papa dit grogne. Je grogne. Je grogne et reçois un coup de pied ça t’apprendra à grogner après moé, sale chienne. Papa dit aussi les animaux, faut les attacher avec une chaîne. Si je refuse les rouli-roulades, les biscuits en forme d’os, les donne la papatte, il sort la laisse.
Le père adore jouer. Les jeux l’excitent.[1] »
Répétés, ces mots font aussi les premières lignes du texte, juste après la dédicace, qui elle aussi vient ajouter à l’indétermination, au brouillage des frontières entre l’histoire vraie et la fiction, entre le personnage et l’autrice, à peine le livre ouvert : « À ma sœur, nous deux contre le reste du monde ». Il n’empêche, la qualification de « roman » s’impose, c’est-à-dire à la fois qu’elle s’est imposée à l’autrice (et sans doute aussi à l’éditeur), qui entendent la proposer au lecteur, et enfin qu’elle s’impose au lecteur, ici à la lectrice, comme une qualification juste, une fois le livre refermé. Et rouvert. Puis refermé encore, et ainsi de suite, jusqu’à la dernière page.
L’écriture de l’inceste affronte autre chose encore, de spécifique : le tabou.
Car Chienne ne se lit que par petites doses, tant le texte est dérangeant, irrespirable, violent. On pourrait estimer que le travail complexe d’extension du domaine du roman et plus largement de la fiction, autant que le trouble dans la frontière entre fiction et réel, auquel se livre Chienne, n’est pas inédit. On le situerait alors au croisement de deux types d’entreprises qui agitent régulièrement les rentrées littéraires : d’une part, les gestes d’écriture de soi qui brouillent la carte entre fiction et autobiographie, entre vie privée et intimité transformable en matériau pour un texte public ; d’autre part, la littérature qui se confronte à la représentation de l’irreprésentable, à l’entreprise de donner à voir et à entendre l’impensable et l’insupportable de la violence extrême. C’est sur ce site inconfortable entre deux lieux et deux natures de lieux, que se tient aussi, dans un équilibre intranquille, l’écriture de l’inceste.
C’est pourquoi elle pose en partie des questions bien balisées : comment mettre en mots l’innommable ? comment affronter le refus de voir et d’entendre l’horreur ? Mais l’écriture de l’inceste affronte autre chose encore, de spécifique : le tabou. Le mot, dont on rappelle volontiers qu’il vient des langues polynésiennes – façon, déjà, de tenter de mettre à distance la chose ? – désigne l’interdit collectif de faire. En l’occurrence, l’interdit de sexualiser l’amour au sein de la famille, c’est-à-dire de confondre eros et filia, de mêler l’amour désirant des adultes et ascendants à celui non encore érotisé des plus jeunes soumis à leur autorité. Mais dans les faits, y compris aujourd’hui, y compris ici, chez nous, le tabou désigne souvent (oui, souvent, hélas) plutôt l’interdit de dire ce qui est fait que l’interdit de faire, comme l’a justement résumé Charlotte Pudlowski dans le podcast aussi documenté que sensible Ou peut-être une nuit (une mine pour qui veut comprendre les effets sociaux et politiques mais aussi psychiques, cognitifs et même esthétiques de l’inceste).
Cet interdit est imposé à la victime, la personne incestée, par l’auteur des faits, l’incesteur, et souvent aussi, tacitement, par leur entourage voire la société tout entière, qui savent mais refusent de voir et d’écouter ou même d’entendre ce qui a pourtant et d’autant mieux lieu. L’inceste, c’est l’apprentissage du silence. Dès lors, c’est le douloureux privilège de la littérature de pouvoir, de savoir dire ce que l’inceste nous fait, à tous, à travers les mots.
Ce sont ces questions qu’affrontent des textes comme celui de Marie-Pier Lafontaine : comment rendre compte des cercles de silence, de victimes, de complicités ? Comment s’adresser au lecteur pour rendre de tels récits partageables, et quelle place lui donner au sein de ces cercles pour œuvrer à les détruire ? Derrière la question de l’interaction entre l’auteur.trice et les lecteurs, une autre question, donc : comment dire l’inter-dit, ce que tout le monde, en tout cas tant de monde sait, sent et tait ? Comment faire taire le silence ? Comment écrire l’inceste et comment écrire contre l’inceste ?
Dans Chienne, « roman » est une des formes que prend l’affrontement à ces questions. Commençons donc par cette qualification. D’abord, on le comprend vite à la lecture, elle pourrait bien être apposée par l’éditeur, suggérée par des avocats, comme paravent juridique. La polémique autour du dernier texte de Carrère, Yoga, aide à comprendre l’intérêt mais aussi la limite de ce genre de stratégie. Le « roman » semble pouvoir protéger d’une plainte des proches de l’auteur pour atteinte à la vie privée – ou, s’agissant d’inceste, pour diffamation – mais pas d’un droit de réponse par voie de presse, de nature à entacher la réputation de l’écrivain non (seulement) comme personne mais, précisément, comme romancier. Yoga a finalement été déclassé, disqualifié de la course au Goncourt parce que requalifié comme simple « récit » et non fiction véritable, ne pouvant à ce titre prétendre au prix qui consacre un texte comme roman et un auteur comme grand écrivain, du fait de l’exigence testamentaire d’Edmond de Goncourt de n’honorer que des « œuvres d’imagination ».
Car « roman » est aussi, évidemment, un label. Un label qualité, bien sûr, l’entrée par la grande porte dans la littérature, la seule voie d’accès aux prix littéraires, et un point de repère solide pour le grand public. Le roman, c’est, aux côtés de la poésie et du théâtre, un des trois grands genres dûment authentifiés par tout un chacun dès la maternelle. Et puis, en France, la « fiction » ne fait pas recette, comme catégorie littéraire en tout cas. Et l’« autofiction », cette « fiction, d’événements et de faits strictement réels[2] », sonne aujourd’hui un peu daté. Quant à l’autobiographie, son pacte résumé par l’équation désormais classique « auteur = narrateur = personnage » (Philippe Lejeune) s’avère bien trop rigide pour tenter l’écrivain – ou le lecteur.
Chienne s’affiche et s’affirme donc comme un roman, soit. Ici, cela dit aussi un refus que le texte soit réduit au témoignage… On peut y lire une revendication que les récits d’inceste ne soient pas cantonnés au fait divers, qu’ils accèdent à la littérature, tant il est vrai qu’à l’excitation du lecteur d’être le témoin un peu voyeur d’une histoire vraie répond le mépris condescendant de la critique pour un objet infra-littéraire, particulièrement s’il est question d’affaires sordides. Dire « roman », malgré tout, peut s’interpréter comme une possible revendication pour l’autrice de témoigner, et plus précisément de témoigner de ce qui lui a été fait, c’est-à-dire d’être non pas le témoin-testis, extérieur à la situation qu’il a vue, mais le témoin-superstes, qui a traversé l’événement de part en part… tout en récusant la réduction au statut de témoin.
Dans un article consacré à la littérature qui a tenté de témoigner d’une autre forme de violence extrême, d’une autre expérience-limite, celle du génocide, l’historien Patrick Boucheron a émis l’hypothèse que le choix du roman et plus précisément de formes de roman qui partent à « l’assaut contre la frontière » entre réel et fiction, peuvent se comprendre comme une façon pour l’auteur de protéger le témoin réel de formes d’intrusion. Ici, parce que l’autrice est le témoin, et que ce témoin est aussi ou du moins a aussi été une victime, la transformation d’une histoire en roman ne fait pas le récit d’un processus d’empouvoirement, elle est le processus d’empouvoirement. Comme une façon de sortir de la position passive et réifiée qui fut celle de la victime qu’elle a peut-être été, en tout cas, au nom de laquelle et depuis laquelle elle prend la parole, pour sortir de cette position et donner à voir ce processus.
Chienne n’écrit pas seulement l’inceste, Chienne, c’est l’écriture littéraire comme anti-inceste.
Le geste d’écriture fait en lui-même réparation. D’abord, parce que, comme le rappelait récemment Édouard Louis, le fait même d’écrire déplace hors d’une position de dominé, que par exemple, « à partir du moment où tu écris, tu ne fais plus partie des classes populaires. Les classes populaires, ce n’est pas seulement économique, c’est aussi le capital culturel, le rapport à la lecture et à l’écriture ». Écrire, c’est prendre le pouvoir, et ici, le reprendre. Ensuite, le geste littéraire est empouvoirement par la façon dont le livre écrit l’inceste et par là, en fait sortir le personnage, la narratrice, l’autrice… et le lecteur.
Chienne n’écrit pas seulement l’inceste, Chienne, c’est l’écriture littéraire comme anti-inceste. L’inceste, c’est d’une part le brouillage, la confusion, l’ambiguïté, entre les rangs générationnels, entre les types d’amour ; et c’est, d’autre part, un rapport de force absolu. Impression de paradoxe de prime abord si on se focalise sur la place à laquelle est mis le lecteur : on retrouve la confusion et le brouillage entre réalité et fiction qui vise à conduire le lecteur à voir en face l’inceste, dans toute sa clarté. Son horreur nue. C’est parce qu’il est d’une violence insoutenable que le texte contre l’abjection, et contre l’attaque au langage. Le détour de la comparaison avec les stratégies mises en œuvre par une des grandes écrivaines de l’inceste, Christine Angot, permet je crois de mieux saisir la stratégie de Lafontaine.
Angot a d’abord écrit l’inceste depuis l’inceste. Le titre de son premier texte en la matière (on ne sait trop comment dire), son premier grand succès en tout cas, L’Inceste (1999), n’est pas à comprendre comme une entreprise de nomination – qui supposerait une prise de distance et la construction d’une position extérieure depuis laquelle l’inceste serait regardé et dit. Le texte dit au contraire l’impossibilité de sortir de la chose, qui occupe tout l’espace, il est écrit depuis cet intérieur monstrueux. C’est donc un texte fou, qui décrit mieux que tout article de psychanalyse l’arme de destruction massive du langage et de dévoration de la psyché qu’est l’inceste – la folie étant une des stratégies désespérées du psychisme humain pour lutter contre la perversion.
Angot le dit d’ailleurs dans le texte, quand elle rappelle que l’inceste « est réprouvé par l’opinion et toujours vécu comme une tragédie issue de la déraison ou conduisant à la folie et au suicide. » L’Inceste est pour l’essentiel un texte inintelligible, où règne la confusion absolue. Tout est dans tout et réciproquement, rien n’est à sa place, les frontières sont poreuses, entre soi et non-soi, entre le sujet écrivant et son objet d’amour, entre une vie qui ne parvient pas à se constituer pleinement au présent, tant la scène primitive traumatique ne passe pas et contamine tout. Le texte, coq-à-l’âne vertigineux, dit la fusion des scènes, les instances, les places, et les temps :
« Dès que je la vois, ça s’embrase. Puis ça baisse, elle le sent, c’est un petit clou, un petit chou, un petit bout, un petit bout’chou qui manque. Je lui ai fait lire mon texte sur le foot, pendant ce temps-là j’ai lu sa lettre. Avec son écriture de médecin, très large. Un jour comme les autres sans toi. Un jour pâle, fade (Elle ne met pas de ponctuation.) Un jour comme les autres sans toi Un jour pâle fade Le manque de toi aigu et pourtant je ne bouge pas je ne fais pas un pas vers toi (Il n’y a pas de ponctuation du tout. Pas de limites, les métaux se confondent, la fusion, le mélange, pas de virgule, pas de point. (…)
Je pense à l’amour et c’est l’envahissement qui est là J’ai peur de ne jamais y arriver, tu sais et si je n’y arrive jamais Alors à quoi bon continuer »
Dans L’Inceste, l’inceste n’est pas ce dont on parle, il n’est pas le sujet, ni l’objet. Il est. Il prend toute la place. Il est ce dans quoi on est, le bain, le magma dont la narratrice ne parvient presque jamais à s’extirper, et dans lequel l’autrice plonge le lecteur. L’inceste est dit par une parole proliférante, délirante, mais qui ne sait pas, ne peut pas dire l’essentiel, nommer, et quand enfin elle vient, la nomination ne parvient pas à rompre avec la logique folle, à poser une limite. Notamment parce qu’elle ne parvient pas à qualifier correctement les faits (et notamment ce que sont le viol et la contrainte), quand elle écrit : « on appelle inceste une relation sexuelle sans contraintes ni viol entre consanguins, au degré prohibé par la loi propre à chaque société.[3] » Dix ans plus tard, Angot réattaque l’inceste, par plusieurs fronts cette fois, dans Une semaine de vacances (2012). L’inceste, c’est le non-lieu ? C’est l’enfant placé dans une position contradictoire et intenable de toute-puissance et d’impuissance absolue à la fois ? C’est la parole qui dit pour taire ? Dont acte. Les positions et les régimes d’adresse sont ici démultipliés, comme les qualifications, dans un jeu éprouvant de dedans-dehors.
Angot écrit l’inceste d’abord depuis le point de vue, pervers, de l’incesteur. Non pas parce que le narrateur serait le père incesteur, qu’on aurait accès à son point de vue, clairement situé, en position symétrique de celle de la victime dans le miroir. C’est que le geste littéraire ne prend pas corps dans l’après-coup de l’événement, ni pour la personne qui a vécu les faits et la personne qui écrit, ni pour les personnes qui lisent, dans la mesure où, quoi qu’on en dise, ici et maintenant, dans notre société, l’interdit proclamé de l’inceste qui fait consensus dans le discours public, coexiste pacifiquement avec sa pratique. Il s’agit donc par l’écriture de montrer combien l’inceste est présent, se vit au présent, et se vit précisément sur fond de silence. L’Inceste nous mettait dans la position ou plutôt l’absence de position dans laquelle errent les subjectivités victimes d’inceste, nous faisait éprouver ce vide saturé. Dans Une Semaine de vacances, le lecteur est amené à éprouver la perversion.
Plongé d’emblée dans des scènes de sexe très crues entre deux amants, clairement investis tous les deux dans une relation d’amour, qu’il peut en partie donc être amené à érotiser même si l’on n’a jamais accès qu’au désir et au plaisir de l’homme, il ne prend que très progressivement la mesure de l’écart d’âge, puis du fait que la femme est mineure alors que l’homme est d’âge mur, puis que la demande « dis-moi, papa, c’est bon », est bien pire qu’un jeu de rôle d’un goût douteux. Le lecteur est donc placé en premier lieu dans une position de complice du brouillage des formes d’amour et de la confusion des positions.
Et c’est parce que le dévoilement ne se fait que progressivement et que le voile ne sera jamais levé clairement, autrement dit parce qu’il n’y a pas de révélation véritable, que le lecteur est amené à partager les sensations et émotions de la position de victime, l’arrière-goût putride de l’abjection, du dégoût de soi, qui restent si longtemps en bouche – et qui expliquent le premier cercle du silence, celui de la victime qui n’ose se dire ce qu’elle a vécu. Mais aussi c’est par là qu’il est amené à éprouver le plaisir passif de la position de complice puis à la réprouver, à en être expulsé parce qu’il est révulsé, a posteriori, de ce qu’il a si longtemps, trop longtemps, laissé faire en prenant même plaisir à le voir sans le voir, puisque l’inceste c’est le caché-exhibé aux yeux de tous, complice du secret imposé à la victime par l’incesteur – le deuxième cercle du silence, c’est le premier cercle de la complicité.
L’inceste, c’est le règne de l’indéfini, et c’est le règne de l’absence de responsabilité collective.
C’est dans cette capacité à faire éprouver de l’intérieur quelque chose de ce rapport au langage, à rendre partageable ce que l’on ne veut ni voir ni entendre, que se trouve le privilège cognitif du geste littéraire, qui fonde Angot à dire qu’« il n’y a pas de vérité hors de la littérature ». Car l’inceste n’est pas un interdit, c’est une pratique qui existe dans nos sociétés et qui y coexiste avec un discours consensuel sur l’interdit de l’inceste. C’est bien pour cela que l’inceste est si souvent raconté comme un fait divers ou même un conte : une histoire qui glace le sang, peuplée d’enfants innocents et d’ogres, monstres effrayants mais aussi, en un sens, rassurants tant ils semblent éloignés de nous. Car l’inceste est près de nous. Trois enfants sur une classe de trente, quatre millions de personnes, selon les (sous-)estimations de l’AIVI (Association Internationale des Victimes d’Inceste). C’est précisément pour ne pas faire face à cette réalité statistique proprement scandaleuse qui oblige à réaliser que l’inceste est un phénomène de société, un fait ordinaire, bien de chez nous, qu’on le réduit au fait divers, ce « rebus inorganisé de nouvelles informes » (Roland Barthes).
On ? Oui, on, précisément. L’inceste, c’est le règne de l’indéfini, et c’est le règne de l’absence de responsabilité collective. L’inceste, c’est donc, aussi un fait de langage, et plus précisément un rapport collectif au langage. L’inceste, c’est le « on ». Le tabou, l’interdit sacré, n’est pas tant le fait que sa qualification. C’est qu’il serait insoutenable de réaliser que l’inceste pourrait même bien être une des racines de notre société, qu’il constitue le « berceau des dominations » patriarcales. Par cette puissante formule, l’anthropologue Dorothée Dussy a montré combien « l’intériorisation des abus sexuels et du silence qui les entoure pour les incestés, l’impact suffisamment fort de l’inceste sur les incestés pour que ceux-ci en donnent à voir les effets aux autres enfants (…) participent d’une description complète des processus de fabrication des dominateurs et des dominés[4] ».
Pour les victimes – les victimes directes, dans leur chair, mais aussi celles et ceux que la justice appelle à tort les victimes « par ricochet », dont le corps n’est pas directement impacté mais qui sont soumis au même ordre familial, c’est l’apprentissage du silence honteux, soumis et résigné. Et pour ceux qui vivent avec l’inceste non pas comme victimes mais comme « simples » témoins prétendument extérieurs, c’est l’apprentissage de formes de justifications du silence en tant que non-action. L’inceste n’est pas structuré comme un langage, l’inceste empêche la structuration du langage pour la victime, et déstructure le langage de tous ceux qu’il contamine.
Comprendre comment la dénonciation collective de l’inceste coexiste avec l’acceptation collective de son existence par l’opinion publique d’une ville comme par les tribunaux, et même dans une certaine mesure comment cette dénonciation rend possible cette existence, est la tâche entreprise par une autre anthropologue, Léonore Le Caisne dans Un Inceste ordinaire. Et pourtant tout le monde savait. Elle montre comment le troisième cercle du silence, celui de l’entourage et au-delà, de la société, est lui aussi fait de mots, comme le silence du discours fou de certaines victimes. L’inceste est inter-dit, il est dit entre les lignes, dit sans être dit tout en l’étant mais d’une façon qui permet qu’il continue à exister par une sorte de mécanisme de défense généralisé. Dans ce troisième cercle, ce ne sont plus des mots plus délirants comme ceux de L’Inceste, ce sont plutôt des mots déviants, qui dévient le sujet, qui déqualifient, rendent méconnaissable l’événement pour qu’il soit absorbable par la société et assimilable à l’ordinaire de la vie sociale, et qui visent surtout à permettre aux spectateurs de ne pas se situer dans une histoire qui pourtant les regarde, de faire comme s’ils étaient extérieurs à la situation. Ces mots, c’est l’apprentissage d’une forme de complicité.
Ces deux ouvrages d’anthropologie donnent à voir cette réalité sociale de l’inceste. Mais ils ne peuvent ni réparer, ni lutter contre, et manquent quelque chose de l’attaque au langage. C’est là le privilège cognitif de la littérature, dont l’affaire est la restitution du comment des choses et le comment de cette restitution, au moins autant que l’interrogation du pourquoi des choses qui serait, elle, plutôt l’affaire des sciences humaines et sociales. La ligne de partage est floue cependant, particulièrement ici, tant l’apport d’un texte si attentif à la phénoménologie de l’inceste s’avère précieux et peut-être même inégalable pour faire comprendre au lecteur ce qui est en jeu dans l’inceste, le rendre capable de prendre avec lui la vérité de ce que fait l’inceste au corps, au psychisme et au langage. De l’incesteur (un homme dans 98% des cas), de l’incesté.e (garçon ou fille) et de tout l’entourage.
C’est précisément parce qu’il est littéraire que ce geste présente un apport cognitif et politique, permet de dire de l’inceste quelque chose que le discours de type scientifique manque toujours un peu. Car le personnel est politique, la sphère privée, ce qui se passe dans les alcôves, les caves et les greniers est politique. L’inceste c’est sans doute le premier et le dernier rempart de la domination patriarcale. C’est la loi du Père portée à son absolu. C’est l’acceptation par la société qu’une loi lui résiste et continue à être hors la loi sociale. Ce n’est pas la famille qui est un bien sacré dans nos sociétés. C’est la loi des Pères.
Le lecteur n’est pas complice, et si le personnage et la narratrice sont victimes, par le gest d’écriture, l’autrice ne l’est plus.
La stratégie de Chienne peut sembler paradoxale, puisque le texte dénonce la logique incestueuse tout en reproduisant pour le lecteur une forme de brouillage des frontières, entre le réel et la fiction. Mais c’est ce qui permet de rendre partageable l’innommable, de rendre soutenable le spectacle de l’inceste montré en tant que tel, sans aucune ambiguïté quant à la qualification des faits, quant aux responsabilités, quant à la mécanique psychique pour les victimes, tout en sortant de la logique de l’inceste et en épargnant au lecteur le risque d’être plongé à son tour dans une forme de sidération traumatique qui pourrait advenir face au rappel que « ceci est une histoire vraie ». Cette écriture frontale confronte à l’abjection mais ne la fait jamais éprouver du dedans au lecteur, et l’épargne de l’éprouvé interne de l’abjection de la position de complicité. Le lecteur n’est pas complice, et si le personnage et la narratrice sont victimes, par le geste d’écriture, l’autrice ne l’est plus.
Réparer c’est d’abord répéter. Aux cercles de la répétition des passages à l’acte et des situations traumatiques, suivis des spirales de la répétition-transformation bien répertoriées par les experts en psycho-traumatologie, répond ici la répétition littéraire, comme style qui ne bégaie pas mais réaffirme, sans cesse, face aux faits fous et inqualifiables, une parole claire et précise. Réparer, c’est aussi faire advenir les mots qui disent le vrai, c’est cela, « tenir tête » – comme la narratrice dit avoir été la seule à tenir tête à son père, lui dire non, poser une limite. Ce processus est matérialisé : sur la page, le texte n’occupe jamais plus de la moitié de l’espace. C’est une coquetterie, parfois, de la littérature contemporaine. Ici, c’est une conquête sur le blanc, sur les couches de silence – y compris sur la parole comme silence – et sur les blancs d’une mémoire traumatique trouée.
La narratrice le présente comme une incapacité : « j’aurais voulu écrire un roman sur mon enfance avec des pages et des pages remplies d’écriture. Sans espaces blancs, sans pauses ni silences. Que l’on comprenne bien tout le vacarme que fait faire la peur de mourir à un cœur. » Au contraire, les blancs disent à la fois le trauma et la sortie du trauma. Le temps traumatique est aussi représenté grammaticalement, par une discordance des temps : passé et présent alternent et le texte dit combien, pour le personnage, le présent n’est trop souvent que la conséquence des traumas du passé. Mais le texte n’est pas inscrit dans ce temps traumatique, gelé, de la répétition redondante.
La répétition conforte la qualification des faits, et dit l’acte de résistance à leur déqualification perpétuelle : par exemple, contre le discours de « la mère », il s’agit de redire sans cesse qu’il y a bien eu inceste même s’il n’y a pas eu pénétration. Et de le lui adresser :
« La mère participe à l’inceste. Debout derrière l’îlot de la cuisine. (…) La mère s’est convaincue au fil des années. Convaincue jusqu’aux fibres maternelles. L’inceste n’existe qu’avec contact. Que ses filles-chiennes gonflent de sang le sexe de son mari, ça ne l’inquiète pas. Tant et aussi longtemps qu’il n’y aura pas d’orifice pénétré. Il n’y aura pas de raison d’intervenir. Mais bon. Il faut bien lui donner ça. Papa ne nous a pas violées. Merci, maman. »
Réparer, c’est donc remettre les choses et les personnes à leur place, et attribuer les responsabilités. Le Père ne sera pas vu autrement que depuis le regard de l’enfant victime : comme un bourreau, comme un ogre. Cela permet de le laisser là où il doit être : loin du cœur de son enfant. La mère, certes victime, est aussi remise à sa place. Sa place de victime, d’abord, posée presque d’emblée :
« Elle avait quinze ans, lui vingt-quatre. Il avait une maison et une épouse. Elle, elle habitait chez ses parents et avait de l’acné. (…) Il l’a embrassée. T’es ben trop belle, j’peux juste pas m’empêcher. L’a conduite jusqu’à sa chambre à lui. Il l’a pénétrée. (…). Puis pour ses seize ans, il l’a arrachée à sa famille. Il l’a exilée dans une autre ville et enfermée dans un appartement. Elle a arrêté ses études. A seize ans, ma mère a été kidnappée. »
Mais la mère est aussi mise à la place qu’elle n’a jamais su occuper, sa place de parent et, en l’occurrence, de parent qui a failli. Elle est mise, aussi, à la place de complice, qu’elle a occupée. La phrase revient sans cesse dans le texte : « la mère participe à l’inceste. » Le texte nomme ainsi tous les cercles de silence et de complicité collective, de l’entourage mais aussi des institutions chargées de faire respecter la loi et donc l’interdit de l’inceste (l’école, la justice) :
« J’ai une meilleure amie, enfant. Elle est incestée. Par son grand-père. Le père de sa mère, avec la langue et les doigts. Il l’assoit sur ses genoux. Lui donne de l’argent ensuite (…). Sa mère a dit tu me le diras s’il recommence. Sa grand-mère a dit tu me le diras s’il recommence. Mon amie, elle, me chuchote c’est un secret. Comme les adultes savent, pour la langue et pour les doigts, le secret est ailleurs. (…) Au procès, la procureure me demande de relire ce rapport de la policière. (…) Je sais le serment. Dire toute la vérité et rien d’autre. Je l’ai juré. Mais je ne lui fais pas confiance, au Juge.
À la barre.
La mère : Oui, des fois, des menteries d’enfant.
La grand-mère : Des massages innocents.
La procureure : Donc vous saviez madame ce que votre mari lui faisait.
L’avocat de la défense : Les enfants mentent.
(…)
Mais de toute façon, ce juge, il n’a entendu qu’une seule chose : Les enfants mentent. »
Et, plus loin :
« Mon père dit les enfants tombent. Ma mère répète. Les enfants tombent à la grand-mère. Les enfants tombent à la tante. Les enfants tombent à l’école. Les enfants tombent aux voisins. C’est bien connu. Tout le monde le sait. Les deux petites filles, elles tombent. C’est maladroit une enfant. Ça trébuche, s’enfarge, se cogne. Tout le quartier le sait. »
Les adultes soutiennent les mensonges des adultes, par un double discours que le texte nomme, là encore, explicitement. Tout le monde « le sait » : que les enfants tombent, et que les enfants se font frapper par leur père. Plus loin, encore : « nos voisins n’ont-ils jamais rien entendu ? » Face à ces responsabilités qui n’ont pas été prises, ces lâchetés, ces complicités, ce courage de nommer va jusqu’à affirmer la responsabilité progressive de la personne qui a été victime, enfant, dans ce qui lui arrive, à l’âge adulte :
« Les hommes m’aiment, m’ont toujours aimée, comme on aime une chienne. (…) Je n’habite mon corps que dans la douleur (…). Ils le sentent que je suis une enfant battue. Que je ne sais exister que dans la destruction. Ils savent qu’il n’y a que dans l’intensité que je peux souffler. Mettre ma détresse sur pause. Chaque nouveau coup me console un peu plus de mon enfance. [5] »
Loin d’enfermer dans une position de honte et de culpabilité, dans le plaisir morbide d’une position masochiste, sans s’attarder non plus à dénoncer le goût de ces hommes qui haiment les femmes, l’écriture affirme là la responsabilité du sujet, et par là le restaure dans sa dignité, sa liberté, son agentivité. Il ose, et c’est une audace précieuse, rendre compte des méandres d’une réparation qui passe par des formes de répétition-transformation qui sont peut-être bien les seules à permettre de sortir des cercles de l’enfer, par un chemin en spirale qui trace peu à peu, pas à pas (pour peu du moins que le petit poucet ne se perde pas dans un retour définitif dans la forêt de l’ogre), à partir de stratégies de survie fondées sur l’auto-destruction, une voie et une voix vers la sortie du passé, vers la liberté.
Au présent, le texte met à distance la mécanique de la répétition traumatique au moment même où il semble en décrire le ressassement. L’écriture répare par deux bouts : en reconnaissant le tort subi, ce qui fait qu’une personne a été victime, et en ne la figeant pas dans ce statut, en écrivant depuis une autre position. Chienne me semble proposer une réponse possible à l’épineuse question littéraire autant que politique des stratégies permettant d’écrire l’inceste contre l’inceste, mais aussi, plus largement, d’écrire la violence sexuelle faite aux femmes, quand on est une femme et d’autant plus quand on fait exister cette position de victime comme une position possiblement occupée dans le réel.
Ici, la stratégie consiste à faire exister cette position de victime dans le texte pour le personnage, sans jamais écrire depuis cette position, et en dessinant comme consubstantielles deux trajectoires de libération. D’un côté, celle de la victime (le personnage, la narratrice, possiblement l’autrice), qui advient à la position de survivante dans un texte écrit depuis la position de « thriver »[6], étape ultime de la reconstruction psychique de la victime, la position depuis laquelle un sujet pleinement restauré dans sa subjectivité et son agentivité est capable d’énoncer une parole claire, qui dit le vrai et trace des limites, non seulement pour soi, mais aussi pour autrui. De l’autre côté, donc, le texte permet la libération du lecteur, à qui le texte apprend à ne pas méconnaître l’inceste, et apprend qu’il existe une position autre que celle de témoin complice passif de la mécanique incestueuse, et qu’il peut l’occuper, individuellement, collectivement. Le lecteur, c’est nous.