Dix forêts pour un trèfle – sur JVLIVS du rappeur SCH
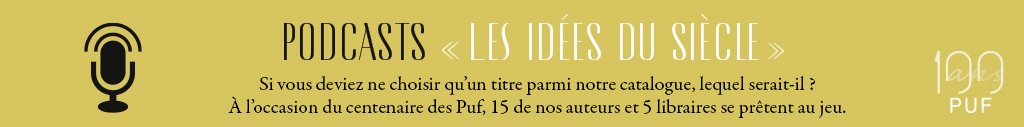
« Si la rumeur dit vrai, Dieu seul sait comment tout ça se terminera », Gibraltar
« Je l’ai vu naître, ce petit » : ainsi s’ouvre le tome I. L’unité du projet JVLIVS doit beaucoup à cette voix : celle de la doublure francophone d’Al Pacino, José Luccioni. Rocailleuse, elle construit par petites touches un portrait de plus en plus inquiétant, celui d’un « loup » : « C’est pas le Diable ce p’tit, il est simplement né dans un incendie qu’ont allumé ces prédécesseurs, et il en est sorti sur un tricycle en feu. »
La voix de la sagesse (« je l’ai vu naître ») expose les armes possédées, les lieux traversés, de Marseille à Gibraltar. Sur des textes de Furax Barbarossa, rappeur toulousain à qui SCH a confié l’intégralité des interludes qui ponctuent les deux volets de JVLIVS, elle campe un décor, donne des détails, et surtout, surtout, promet une progression narrative. Accompagnée des arrangements de Katrina Squad, empruntant à toutes les musiques et à tous les folklores, elle annonce un revers obscur du monde, un humain devenu bête sans merci.
Al Pacino, interprète de Michael Corleone dans Le Parrain et de Tony Montana dans Scarface, pourrait être, à lui tout seul, la figure tutélaire du rap. Les allusions à Tony et Manny sont devenues un passage obligé, tandis que la figure de la mafia italienne comme famille pourrait servir de double historique de Jvlivs, fasciné par l’Italie et sa mythologie (« t’as le choix : jugé par douze, ou porté par six », dans Otto).
Un cadre narratif, un suspense, une réécriture. La trilogie annoncée JVLIVS, dont vient de paraître le volume II, s’inscrit dans la lignée des concept-albums, et le rappeur revendique son goût pour la narration. Le rap comme avatar poétique du film noir ? « Je sais où va la trilogie », confie-t-il en interview à Mehdi Maïzi pour iTunes Music le 17 mars 2021. Mais SCH joue des rumeurs, et Dieu seul sait comment tout cela se terminera.
« J’suis au coeur de la brêche et du récit », Mannschaft
On ne sait pas exactement dans quelle fournaise Jvlivs a vu le jour : le cratère du Vésuve, l’enfer napolitain sous la Camorra, ou Marseille au goudron fondu sous le soleil. On ne sait pas exactement non plus depuis quand brûle le feu.
On sait par contre que les « zones à danger », le four, les courses poursuites sur la A7, le sombre web, les zones de non-droit sont ses terrains de jeu, et c’est du côté de Gibraltar, « carrefour sans signalisation où la moindre hésitation se paye cher », qu’il a récemment été aperçu. Car Jvlivs semble préférer les bordures de l’Empire. Et s’il s’annonce comme un héros profondément européen, ce n’est pas tout à fait de l’Europe de Bruxelles : « Méthode du Caucase, drogue des Pays-Bas, cause sicilienne, moteur allemand. » (Mannschaft)
La vie et les aventures de Jvlivs, gangster et trafiquant, nous sont livrées à travers les deux albums de SCH, alias « le S », alias « 19 », alias « Götze », comme un récit à facettes éclaté en mille morceaux, en mille voix, et en mille flows.
Il y a le récit, et il y a la brèche : « On tire et les parois se fragmentent » (Grand Bain). Comme une histoire qui montrerait ses trous, et comme une manière de raconter un film de gangster avec des pièces détachées et récupérées de Gomorra, du Parrain, et de Scarface. Une réactivation du récit de mafia, y compris dans sa glorification du lignage et sa codification des rapports familiaux : Jvlivs a succédé à son père, Otto (prénom réel du père décédé du rappeur), trafiquant tout comme lui dans la fiction.
Car si SCH a relancé la forme ancienne de la fiction mafieuse avec la trilogie JVLIVS, il est parvenu à la transformer profondément en y logeant en plein cœur un hommage à son propre père : « Dans les vitrines et les villas, quand s’élèvent le soleil et la brume / Quand les larmes se décomptent en litres / Yeux vers le ciel je ne suis qu’un homme / Je perds mon père mais je ferais les dates » (J’t’en prie).
Le récit autobiographique et ego-trippique du rap croise le film de mafia pour ériger le tout au rang d’un genre séculaire et noble : le tombeau.
« Glock blanc, ton sur ton, longue veste comme dans les feuilletons / Des bonnets troués dans un Vito et j’suis De Niro dans Vito », Crack
Une arme, un vêtement, et un véhicule. Les panoplies de Jvlivs sont nombreuses et importantes, précisément détaillées et découpées par les textes. Dans Crack, le premier couplet installe ainsi une scène d’enlèvement avec ses accessoires : un pistolet de marque allemande, un manteau inspiré par les costumes des membres de la pègre – on connaît le goût du rappeur pour les marques et les couturiers – et un véhicule utilitaire de marque allemande – il aime aussi les automobiles. Et ça semble suffire pour dessiner la silhouette de Vito Corleone, joué par Robert De Niro dans le Parrain II.
Le projet JVLIVS déplie ainsi tout un arsenal d’accessoires et d’outils. Il y a des objets cachés sous d’autres partout : des flingues sous des manteaux, des têtes sous des cagoules, des corps sous des draps, des crosses qui dépassent de l’anorak, des canons qui dépassent des fenêtres du « quatre anneaux ». Et l’écriture de SCH montre une prédilection toute particulière pour les matières, métaphoriques ou métonymiques : le ciment, le béton (des tours), le kevlar ou le teflon du gilet, les métaux, dont le fer et l’aluminium, le croco du costard, la « bolognaise » de la fusillade…
Ces accessoires logistiques et matériels construisent la poésie concrète des projets JVLIVS. Grâce à eux, « Jvlivs » devient l’enveloppe de Julien Schwarzer, un costume à enfiler, tout comme la voix se pare d’une multitude d’effets : « J’revêtis l’stard-co sur le cintre » chante-t-il sur le premier titre de JVLIVS II, Marché noir.
La description des panoplies destinées à faire peur, ce glock peut-être chargé à blanc, et cette manière de se prendre pour De Niro avec un bonnet troué, cachent un humour canaille et discret qui parcourt les albums : « Un trois-quarts Boss couleur pègre comme si on allait tuer l’juge et l’préfet » (Tokarev). On y entend comme une légère dérision de soi, parce qu’il n’y a « pas plus vrai que les rires des coins délabrés » (Raisons).
Dans le clip de Mannschaft, l’écran est splitté : d’un côté on voit le rappeur menotté, tout sourire la tête sur le capot, éclairée par des gyrophares, de l’autre on le voit dans une cour de ferme, tout sourire, occupé à plumer un poulet. À gauche les poulets, à droite un poulet.
« Euro, euro, euro, riche », Euro
La voix est distordue, ralentie numériquement, jusqu’à évoquer celle d’un monstre de conte ou d’un robot méchant. Voici un costume inédit parmi la garde-robe d’effets vocaux de SCH. « Yes, j’suis venu pour un chèque », entonne le cyborg, à un rythme qui tranche avec le débit des couplets ; puis : « Euro, euro, euro, riche ». L’ascension tonale, presque indiscernable, ramène toute l’histoire de la richesse à ces deux syllabes de monnaie, à peine, peut-être juste le symbole (car on pourrait transcrire : « €, €, €, riche ») sur une cadence ternaire qui n’est autre qu’un martèlement, et dont la chute se situe sur cette seule syllabe : riche.
Plus de grammaire, plus de causalité, plus de nombres, plus de langage, juste un ordinateur obsédé. C’est si simple que ça en devient parodique.
Et de fait, c’est peut-être une parodie : les histoires de flouze font partie des passages obligés du rap, et leur présence a subi ces dernières années une inflation plus indexée sur celle du bitcoin que sur l’économie réelle.
Thème parmi d’autres dans le rap des années 90, d’ailleurs plutôt décrié (« l’argent pourrit les gens », chantait NTM), l’enrichissement est devenu le but avoué de la nouvelle école, devenant le moteur même de la création (« je fais plus de € à chaque lettre sur ma feuille », affirme Ademo dans Naha de PNL) et la raison de vivre ultime, quoique sans doute ironique, de la pop dite urbaine – on se souvient du succès de « Aristocrate » de Heuss l’Enfoiré, l’un des tubes de 2019, qui questionnait en vocoder « Mais elle est où la moulaga ? », vite suivi par « La kichta » (la liasse), en duo avec Soolking.
SCH, qui a désormais « mis la pharmacie en gérance », dépasse la blague : l’enrichissement est devenu automatique, version sonore et mafieuse du trading haute fréquence. Économie virtuelle, économie réelle, « argent propre argent sale », les flux circulent dans le grand Marché noir qui donne son titre au tome 2.
Déjà, dans Facile sur le tome 1, le gangster convertissait l’argent en une liste de marques de luxe : la richesse est aussi symbolique. Symbolique à double tranchant : « Ça fait chuter le prix du mètre carré » souligne le rappeur dans Fournaise à propos du trafic et des grosses cylindrées : l’économie parallèle a des incidences sur le cours du foncier.
Car SCH parle depuis le début de cocaïne très pure – métaphore canonique de la musique que dealent les rappeurs. Ironique encore, quand on sait que la musique « urbaine » est celle qui se vend le mieux depuis plusieurs années en France, alors même qu’elle est boudée par le circuit des honneurs télévisuels, tourné vers la variété.
L’économie est aussi incarnée par les containers EVP, cette fameuse figure de la mondialisation dont SCH a fait l’objet de sa com’ : chargés sur un cargo, soulevés dans les airs sur le port de Marseille dans le clip de Gibraltar qui annonçait l’album, lequel finit, dans le bonus Fantôme, à Rotterdam. La richesse, métaphorique ou réelle, s’incarne dans ce qui circule – figuration d’un monde résumable à son infrastructure logistique.
Pour la sortie du disque, les mêmes containers floqués au nom JVLIVS ont été livrés dans la nuit devant les grandes gares de France (en partenariat avec la plateforme de streaming Deezer) : comme si la fiction narrative qui structure l’album s’invitait dans le paysage réel. La musique comme marchandise ou le monde comme fantasme – un peu des deux.
« L’image vient sans même une esquisse », Loup noir
Les mots éclatent, soulignés par un écho, sur le titre Loup Noir, à la toute fin du tome II de JVLIVS, et donc à un point stratégique. La phrase peut sembler écrite sous la dictée de l’ego trip classique du genre. Je suis un génie, pas besoin de brouillons, mon écriture suscite immédiatement des images qui sortent toutes armées de ma tête de rappeur.
L’image sans esquisse, c’est la peinture directe à même la fresque, avec un temps de séchage rapide – « J’ai repeint mes murs en blanc et mes peines restent en dessous » (Ciel rouge). Mais SCH nous livre aussi quelque chose de son écriture.
L’image sans esquisse, c’est par exemple : « une cave et tu sais qu’il y a pire que mourir » (Pharmacie). Pas besoin de vous faire un dessin, la violence de Jvlivs n’a pas besoin de décrire plus avant la cruauté dont il est capable, ses capacités suggestives suffisent. « Si on t’arrache, nous y’a pas d’ADN » (Crack) ou le fameux et charcutier : « On va t’ligoter comme un saucisson » (Otto).
L’image sans esquisse, c’est ce sens certain de la synthèse et de la condensation poétique calibrée dans la mesure, cette manière de composer des phrases qui explosent dans la tête, et se répercutent longtemps dans la cervelle l’auditeur. SCH a plusieurs fois revendiqué l’héritage de l’écriture imagée qu’ont développée certains rappeurs au tournant des années 2000, notamment Salif ou Nubi.
On a toujours à moitié raison, ou à moitié tort, quand on compare l’écriture poétique et celle du rap, puisque ça revient souvent à dépoussiérer la première et à anoblir la seconde, en perdant beaucoup des deux dans l’opération. N’empêche, le sens de la concentration dans l’écriture, les phrases chargées comme la poudre de SCH laissent pantois.
L’image sans esquisse et sans dessin préalable, c’est aussi celle qui apparaît, toute faite et toute armée, dans les rêves et dans les cauchemars. L’écriture, et surtout l’interprétation du S, rendent presque involontaire l’apparition de ces images, comme si elles surgissaient malgré lui, au détour d’une mesure, insensibles au passage du temps comme le serait, dit-on, l’inconscient : souvenirs de l’argot de la pègre version Touchez pas au grisbi : « t’as un larfeuille accroché au pif » (Aluminium, JVLIVS II) ou « Marie Curie dans la compteuse » (les billets de 500 francs qui portaient en effigie le visage de la scientifique).
Dans le morceau Loup Noir, les époques se confondent et les images pleuvent littéralement, avec une intensité de plus en plus appuyée : « Des borsalinos dans la nuit / des portes flingues tournent dans la ville / Du sang à éponger dans la cuisine / des billets qui flottent dans la piscine ».
Le film mafieux se met à dégénérer, et on entrevoit la brèche dans le récit glorieux du parrain, la tragédie du héros, et les vies détruites par la violence : « Tu veux tuer un homme, prends du sky et des faux espoirs. »
« Quelques baisers volés », Ciel Rouge
Car le héros est sombre et les effets comiques n’empêchent pas une sensibilité souvent proche du désespoir. Tandis que le récit progresse du marché noir au loup noir (premier et dernier titres du tome 2), la voix du vieil Al Pacino ouvre un moment d’intimité paradoxale, s’adressant à « vous » : nous, les auditeurs, l’interlocuteur fictif de ce narrateur fictif ; une fois encore, le portrait brossé est sanglant : « Ce que vous, vous appelez un massacre, lui il appelle ça le coup d’avance. »
Mais aussitôt après arrive la figure maternelle, et la reprise du chant connaît une forte inflexion, tant dans les BPM que dans les textes, vers l’émotion nostalgique et la confession. Cette période culmine avec « Plus rien à se dire », morceau faussement dansant sur un amour qui s’étiole.
Dans le dernier tiers de chaque volet de JVLIVS, le rappeur se transforme en crooner. On pense au Eddy Mitchell de « Tu peux préparer le café noir », ce qui n’est pas surprenant quand on sait que SCH entonne en interview « Et si tu n’existais pas » de Joe Dassin, référence de son enfance. La variété n’est pas loin, la variété lui plaît, il y reconnaît, dit-il, la possibilité de la couleur.
« Le temps se fout du prix de ma Rolex et de mes souliers Fendi » (Je t’en prie). Tempus fugit, poids de l’absence, blessures intimes. Le poète se fait élégiaque, et le gangster endosse le costume mélodramatique du bandit au grand cœur, occasionnant des jeux sonores à n’en plus finir : « Parano, j’peux pas donner trop d’amour / Mais par amour, j’crois qu’j’vais devenir parano / J’ai pardonné mais j’ai trop donné par amour » (Parano).
La synthèse est parfaite dans Ciel rouge où le stéréotype de l’expression « quelques baisers volés » est réactivé par le double sens : le gangster est amoureux.
« On a quitté l’école, tout pour le code », Le Code
Cette veine du retour sur soi ne s’arrête pas à l’élégie, même si elle fait la part belle à la mémoire des disparus, et au premier chef le père : « J’ai perdu des potos, j’ai même plus les photos / Mon daron s’appelait Otto, il aimait pas les putos » (Otto).
SCH en profite plutôt pour déployer une méditation sur le temps comme allié incertain : « Comment c’était loin Paris / Quand j’étais sous l’porche, que j’rêvais d’faire c’que j’fais d’ma vie / J’rêvais d’finir sur une île, nan, j’rêve de pas finir seul » (Rien à se dire). Mais le temps est aussi témoin des victoires, concrètes et pratiques : « Je dors sur un kingsize je dormais sur un BZ » (Facile).
Dans une scène de Scarface, Tony Montana, au faîte de la gloire, dîne au restaurant avec sa femme Elvira et son ami Many. Ils se disputent et ça dégénère, à tel point que Tony reste seul à table et qu’il commence à haranguer la respectable clientèle de l’établissement floridien : « Vous avez besoin de types comme moi pour pouvoir dire : voilà le méchant ! et est-ce que ça vous rend meilleurs ? Non. »
Ce que Tony tente ici de faire comprendre aux dîneurs bourgeois, c’est qu’il n’est autre qu’un reflet, paranoïaque et cocaïné, de leur image véritable. Montana le criminel met en doute la probité des riches et soi-disant honnêtes clients. Car l’itinéraire du gangster dit quelque chose de vrai de l’ordre politico-social dominant : le mafieux n’est après tout que le businessman avec juste un petit quelque chose en plus, sens pratique, violence ou organisation, peu importe…
La figure de Jvlivs porte elle aussi cette charge de vérité dans l’ordre économique et social actuel. La fin du clip de Marché noir se termine dans le bureau du maire de Marseille… « Bébé, Paris c’est magique, Bébé, Marseille c’est mafieux. »
La métaphore de la mafia est ainsi aussi à comprendre comme un système de valeurs : « J’dépose une rose noire sur ta tombe, mafia / J’dépose des fleurs à ta daronne, mafia » (Mafia). Ce code d’honneur n’est pas sans rappeler un autre code, celui du rap – fidélité à l’image de soi, sens du travail, recherche de la perfection.
Dans la chanson Le Code, tout entière consacrée à un autoportrait du chanteur en solitaire, le refrain da capo répète : « On a quitté l’école, tout pour le code. » Et ce n’est pas rien que de rapprocher ce pas de côté avec celui de la société parallèle de la mafia : le rap, prosodie codifiée, cours poétique, a son code qui est loin de ceux du sonnet qu’on apprend en classe ; et pourtant, il s’agit de la même connaissance des références, du même jeu de variation et de reprise que dans les écoles poétiques, de la même fidélité aux artistes alliés, producteurs ou interprètes.
« Dix forêts pour un trèfle », affirme l’artiste rap dans Tokarev : voilà l’absente de tout bouquet, la perle rare qui demande l’effort immense.
JVLIVS : Tome II – Marché Noir, SCH, label Maison Baron Rouge et Rec. 118, 2021
