Dénominateurs communs – à propos de « Civilization, quelle époque ! »
Comment comprendre cette tendance à l’exclamation qui semble clôturer sur une note allegro de plus en plus de titres d’expositions, et plus généralement de festivals ou autres manifestations culturelles (« Mouvements ! » à l’Institut Suédois, « Extra ! » au Centre Pompidou, « Chefs d’œuvre ! » au musée Picasso, etc.) ? Que pourrait signifier cette tendance curatoriale à l’exclamation : enthousiasme que l’on espère contagieux (méthode Coué), recette marketing ou simple gimmick ? Dans le cas de « Civilization, quelle époque ! », qui se tient jusqu’à la fin du mois de juin au MuCEM, on hésite : titre ambitieux et racoleur, cri fasciné ou saillie satyrique, l’expression a le mérite d’annoncer une ambiguïté que l’exposition maintiendra dans le point de vue déployé.
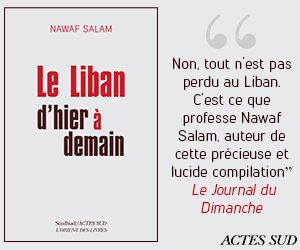
Cerner « notre » civilisation – celle du début du XXIe siècle – en une centaine de photos réalisées par une trentaine de photographes internationaux peut sembler démesuré. L’exhaustivité étant impossible, les commissaires se sont plutôt attachés à cartographier les traits les plus caractéristiques de notre époque, assumant le caractère partiel et partial, parfois même cliché, de leur sélection.
Car s’il fallait garder trace et mémoire de notre temps, que montrerions-nous ? Logement, travail, loisirs, transports, éducation, arts, sciences, techniques… l’exposition échantillonne, parcourt, survole et, sans nier les différences culturelles, elle les subsume sous une unique « civilization ». Cette dernière, héritière de la révolution industrielle, serait-elle le rejeton de la soi-disant « fin de l’histoire », issue de la victoire de l’idéologie néolibérale ? Songeons à cette enseigne de Starbucks illuminant un fastueux décor de mosquée persane, dans un centre commercial à Dubaï, capturée par Nick Hannes. Du pain et des jeux – et l’art du syncrétisme par le capitalisme.
Sans s’encombrer d’un appareil conceptuel trop lourd, ni même discuter en son sein des théories comme celle du « choc des civilisations » de Samuel Huntington, les curateurs ont préféré mettre en évidence les dénominateurs communs d’un monde rétréci. L’alliance de la technologie et de l’économie de marché globalisée accentuent la perméabilité des cultures : elles influent sur les modes de vie des habitants de toute la planète comme rien d’autre auparavant.
Quelle serait, alors, « notre » civilisation ? Les photos, rassemblées et perçues à travers cette grille de lecture, lui servent de définition souple et impressionniste, et la multiplicité des regards proposés neutralise tout manichéisme, suspendant le jugement hâtif – libre au spectateur de se faire sa propre opinion sur cette civilisation à laquelle il prend part.
La pandémie du Covid-19, tout comme les défis écologiques ou migratoires, en témoigne : désormais les enjeux prennent une dimension planétaire et le monde est devenu une entreprise collective, comme la plupart des inventions qui nous entourent. Sur les photographies choisies, le nombre domine l’individu, rappelant que nous n’avons jamais été aussi nombreux sur la planète.
À cette croissance exponentielle s’ajoute une révolution : depuis 2008, et pour la première fois depuis les 200 000 ans d’existence de l’homo sapiens, la majorité des êtres humains vivent en ville. Mais à quel prix ? La plongée par Benny Lam dans ce que l’on n’osera pas appeler un appartement, à savoir un placard de 4m2 dans lequel vit un famille hongkongaise, montre l’envers du décor. À côté, les jungles urbaines asiatiques s’étalent comme des tableaux abstraits sous l’œil de Micheal Wolf, et un panorama sur plusieurs panneaux déroule des favelas latino-américaines.
Seuls, mais ensemble. Ensemble, mais seuls. La foule grandit, mais l’individualisme aussi.
À cette horizontalité dévorante répond la verticalité de verre et d’acier qui gratte toujours plus haut le ciel depuis les déserts, capturée par Philippe Chancel. Citius, altius, fortius – on reconnaît bien là les humains, et leur besoin immodéré de battre des records. Si Rastignac s’exclamait « à nous deux maintenant ! » devant la ruche parisienne du XIXe siècle, Tom Wolfe reprenait cette image dans le Bûcher des vanités pour désigner cette fois New York, ville-monde du XXe. Les photographies réunies les éclipsent : la mégalopole du XXIe, elle, ne s’invente décidément pas en Occident.
Et les foules se massent dans les images, désordonnées ou géométriques, lignes symétriques ou imbroglios colorés, anonyme effervescence ou communion rituelle. Foule urbaine, foule en prière à Djakarta, foule réunie pour la mort de pape, foule dans des bateaux pneumatiques pour rejoindre l’espoir d’une vie meilleure, foule dans une manifestation nationaliste, foule de rangs militaires…
Nul homme n’est une île mais, pris dans les flots et les flux, secoué par le ressac de la foule, la houle et le fracas du monde le laissent parfois bien démuni. Là, des parents attendent un enfant : celui qui va bientôt entrer dans leur vie, celui qui a quitté le nid. Dans leur chambres, des adolescents prennent des poses aguicheuses sous l’œil panoptique de leurs téléphones portables ; des hommes en uniforme militaire, les traits rendus blafards par la lumière bleue de leur écran, éclairent les évolutions de la guerre ; un figure comprimée contre la vitre embuée d’un métro bondé prend une allure de saint en prière. Hagiographie moderne, absolution des migrations pendulaires dans l’enfer souterrain. Seuls, mais ensemble. Ensemble, mais seuls. La foule grandit, mais l’individualisme aussi.
Les autres sections s’égrènent, guidant le regard sans en imposer un, et l’on se promène, de « Persuasion » à « Contrôle », d’« Évasion » à « Après ? », parfois effarée, parfois subjuguée par cette archéologie du temps présent et de ses icônes. Au fil des salles, la question « quelle(s) image(s) avons-nous de nous-mêmes ? » s’articule à « quelle place pour la photographie dans notre civilisation de l’image ? ».
Il est vrai, c’est un truisme : nous habitons un monde de plus en plus saturé de pixels – des milliards d’images partagées chaque jour sur les réseaux sociaux –, avec un espace de la visibilité de plus en plus submergé. Chaque image nous apparaît cernée, polluée, invisibilisée par un nuage d’images hétéroclites, à la qualité plus ou moins médiocre, sanctionnées le plus souvent par une date de péremption rapide. Quel rôle échoie alors à la photographie d’art ? Dans quels interstices se glisser ?
Les photographies agissent comme un arrêt sur image : à l’ère du règne de l’image en mouvement sur nos écrans, elles forcent à la contemplation et à l’interprétation pour le regardeur ; à la condensation et à l’inventivité pour son créateur. Au-delà de sa fonction d’enregistrement, cet art capturant l’empreinte du réel opère une cristallisation ; par ses choix de mise en scène et d’angles, ses couleurs, son grain, son format, il joue avec et révèle les tensions de notre époque. Endossant des regards tour à tour critiques, élogieux, ou esthétisants, les œuvres rassemblées, certaines puissamment narratives, d’autres détournant les objets du monde pour en faire une matière plastique, déplacent notre regard sur des sujets connus.
Car les artistes ne cherchent (peut-être) plus à changer le monde, mais ils luttent dans leurs champs pour montrer aussi la puissance des images, en offrant l’acuité d’un regard, incisif et vigilant, et en jouant avec les potentialités d’un médium considéré comme le plus accessible et bien trop souvent asservi des fins marketing.
Paul Klee déclarait que l’art ne reproduit pas le visible, mais qu’au contraire il rend visible selon ses modalités propres (la science en a d’autres – pensons à la mise en évidence du boson de Higgs). Nouvelle carte du tendre, Le Baiser montre ainsi les connexions électroniques d’un datacenter. Cette mise à nu évoque une nouvelle Leçon d’anatomie de Rembrandt, tel un mystère posthumaniste à soulever : le terrain d’exploration du corps humain cède la place à ces boîtes noires qui rythment notre quotidien numérisé, mais dont pourtant on ne sait rien.
Les photographies montrent les coulisses et avouent les mises en scènes, offrant des contre-champs critiques ou simplement un regard perçant.
Frappantes aussi la récurrence de vues aériennes, nécessaires pour saisir la démesure et la beauté graphique des tarmacs, des paquebots ou l’euphorie de béton, devenant torsades psychédéliques, des grandes villes comme Bangkok. Tout est une question d’échelle, et notre civilisation ne semble plus avoir taille humaine.
D’autres photographies dévoilent quant à elles les chassés-croisés des regards. Dans une société surexposée, l’image de soi se construit à travers une multitude d’images : c’est le discret appareil photo pointant son objectif dans un portrait de Karl Lagerfeld ; plus ostensiblement la scène du shooting de la pochette d’album de Selena Gomez, star de Disney Channel ; ou encore une bande de jeunes Américaines se pimpant pour un concours beauté, capturées par Lauren Greenfield à travers un miroir sans tain. Les photographies montrent les coulisses et avouent les mises en scènes, offrant des contre-champs – comme, dans un autre genre, celui du champ de bataille reconstitué de Gettysburg – critiques ou simplement un regard perçant.
(Dé)jouant les clichés, si certains semblent regretter une uniformisation du monde, comme Roger Eberhard dans sa série « Standard » alignant des photos de ces différentes chambres d’hôtel à travers les grandes capitales, d’autres en soulignent les vertus abstraites, tel Alex Maclean qui transforme les containers en aplats de couleurs.
Mais la griserie provoquée par les prouesses humaines finit par donner la gueule de bois. Edward Burtynsky renforce ainsi l’allure dystopique d’une usine asiatique de transformation de poulets, où la standardisation du processus, des gestes et des postures, est aussi celle des ouvriers qui ne sont plus qu’une masse rose criarde sous les néons.
Privilégiant une facture douce, presque poétique mais néanmoins glaçante, Henrik Spohler insiste de son côté sur une nature définitivement effacée par un humain démiurge, avec des rangées de plants de tomate auréolés d’une patine évanescente, où tout aspect terrien a disparu. Contrecoups de tous ces « miracles », les conséquences de l’anthropocène se dessinent en creux – c’est une raffinerie, saisie par Mitch Epstein et le nuage de fumée comme un mauvais présage d’une centrale à charbon, ou les débris de nos appareils technologiques accumulés que Xing Danwen nomme « disCONNEXION ».
Dans ce monde trop blanc, trop clean, où le sentiment d’infini procuré par un ciel étoilé nous est de plus en plus dénié, les promesses d’évasion prennent une tournure bien risible. Reiner Riedler, dans sa série « Fake Holidays », intitule sa photo d’une rivière artificielle dans un parc d’attraction « wild river ». En face, une autre photographie montre un ours polaire dans un aquarium, comme prisonnier d’un écran azur. Il observe la foule massée dans l’ombre, à l’opposé, venue l’admirer. Entre eux, un regard et un grand vide. Pour le regardeur, un malaise dans la « civilization » qui grandit.
Les flux font place aux impasses : ce sont les ombres chinoises d’une mère et d’une fille dessinées sur des grilles, à la bordure mexicaine ; deux enfants, T-Shirts colorés et visages déchirants, pleurant à la frontière grecque alors que les adultes – policiers et migrants – se battent au-dessus d’eux, couleurs boue et échange de coups ; ce sont les échangeurs pharaoniques comme des cités fantômes ; c’est une terre qui se dessèche. « RUPTURE », indique le nom de la salle ; d’autres auraient en tête « EFFONDREMENT ».
Un lamento s’élève – nous autres, civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortelles… La pandémie a pu sonner comme un coup d’arrêt, au moins pour un temps, pour réfléchir et infléchir un changement radical de civilisation : rupture, schisme, brève éclipse ou ultime soubresaut ? Reste qu’il semblerait que le monde d’après ressemble pour bien des traits au monde d’avant.
Intéressant de percevoir dans cette perspective la dernière partie de l’exposition ouvrant sur l’avenir. Elle témoigne de l’hégémonie du discours technophile : rêve d’immortalité, conquête spatiale, modification génétique, barrages immenses, et là, l’œil bleu du « solénoïde compact à muons, installé sur le grand collisionneur de hadrons du CERN à Genève », que l’on fixe à la fois comme une promesse et un peu saisie de vertige.
Tout cela ne semble ouvrir que sur une vision du futur mais qui donne le la, grise et hygiéniste, où la chair et les éléments disparaissent au profit de surfaces uniformément planes et lisses, où la prospection semble toujours mener à l’abstraction, où l’humain et les autres vivants paraissent bien absents. Où sont alors les futurs désirables pour notre civilisation, qui s’inventent dès à présent ? La bataille des imaginaires a déjà commencé ; « Civilization » les met de côté. « Et après ? »
Exposition « Civilization. Quelle époque ! », à voir au MuCEM (Musée des civilisations, de l’Europe et de la Méditerranée) jusqu’au 28 juin 2021.
