Retour sur un emballage : ce que Christo et Jeanne-Claude ont vraiment fait à l’Arc de Triomphe
On connaît la célèbre proposition que fit Joseph Beuys dans le programme du Festival der Neuen Kunst : « Beuys recommande qu’on surélève le mur de Berlin de 5 cm (meilleure proportion) ! » Nous étions en juillet 1964, un peu moins de trois ans après le début de la construction du mur. Dans un rapport adressé deux semaines plus tard au ministre de l’Intérieur du Land de Rhénanie-du-Nord- Westphalie, il ajoutait : « L’observation du mur de Berlin devrait être permise d’un point de vue ne prenant en compte que les proportions de cet édifice. Désamorcé aussitôt, le mur. Par un éclat de rire intérieur. Détruit, le mur[1]. »
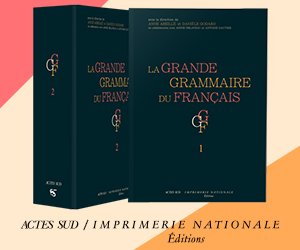
La force de cette action tenait à sa simplicité : elle n’exigeait rien d’autre qu’une conversion du regard. Si, nous dit Beuys, vous parvenez à contempler le mur non comme une frontière mais comme un élément architectural parmi d’autres, dont on est en droit d’attendre qu’il soit construit selon les règles de l’art, vous en changerez le sens. De symbole de la guerre froide, il se transformera en incarnation du beau académique. Plutôt que de chercher à l’abattre, resymbolisez-le.
Difficile, en contemplant l’Arc de Triomphe emballé par Christo et Jeanne-Claude, de ne pas songer à cette action de Joseph Beuys. Recouvert de cet immense drap gris, le monument perd l’essentiel de son contenu symbolique. Inscriptions, frises et groupes sculptés disparaissant sous l’opacité argentée, l’Arc n’offre plus au regard que son volume et sa forme.
« Ne brisez pas, emballez. »
Cet effacement ne le prive cependant pas de toute puissance symbolique. Pour reprendre les concepts du philosophe américain Nelson Goodman, auteur d’une célèbre théorie esthétique, l’Arc cesse de représenter l’épopée de la Grande Armée, mais non d’exemplifier ses qualités formelles, comme les proportions de son architecture. Il suffit d’un voile pour transformer une œuvre massivement académique – le programme des frises et sculptures fut entrepris sous la Restauration et achevé sous Louis-Philippe – en un objet d’art minimaliste (aussi immense soit-il).
Goodman cite « la pierre ramassée sur la route et exposée au musée[2] », possiblement en référence aux pierres de la Stone line de l’artiste anglais Richard Long, exposée pour la première fois en 1977 – mais dont celles, plus tardives, de Giuseppe Penone fourniraient un meilleur exemple. Déplacée d’un endroit où elle se différenciait à peine de ses entours dans un autre où elle devient un objet esthétique, la pierre cesse de renvoyer métonymiquement aux pierres en général pour exposer la singularité de ses forme et grain, couleur et texture.
L’originalité du geste de Christo et Jeanne-Claude est de resymboliser l’objet sans le déplacer. Réduits à l’épure de leur forme, les monuments emballés (il n’y en eut que trois) se retrouvent désarticulés de leur entourage urbain, comme s’ils venaient d’être posés là par un démiurge espiègle. L’effet était particulièrement frappant pour le Pont-Neuf (emballé en 1985), dont la présence nouvelle trouait le paysage familier d’un abîme jaune-orangé. Autour de lui, la ville semblait un dessin dont on aurait réservé la place exacte qu’occupe le pont.
À la différence de Joseph Beuys dont le geste ne pouvait qu’être « intérieur », celui de Christo et Jeanne-Claude ne désamorce rien. L’Arc de Triomphe est un monument ambigu, à la fois glorification de la guerre et critique de ses conséquences. La tombe du soldat inconnu fait plus que nuancer le programme politique sous-jacent de l’iconographie napoléonienne. Elle n’est d’ailleurs pas concernée par l’emballage. On pourrait dire la même chose du palais du Reichstag (emballé en 1995), symbole de l’empire allemand, puis de la barbarie nazie, avant de devenir celui de la république réunifiée.
L’entreprise du couple d’artistes n’a selon toute apparence rien d’un travail critique. En désignant certains monuments depuis trop longtemps présents pour être encore vraiment visibles, ils se contentent d’inviter une population à les voir à nouveau et autrement. Et s’ils réveillent ce faisant quelques spectres enfouis dans sa mémoire collective, ce n’est clairement pas dans le but de l’obliger à réinvestir son passé. L’effet est de distanciation et d’iconoclastie douce. Les polémiques autour de l’installation furent notablement faibles et les critiques périphériques. Le slogan d’une telle action pourrait être : « Ne brisez pas, emballez ».
Mais peut-être s’est-on trompé d’objet. Peut-être faudrait-il observer un peu moins les monuments et un peu plus l’emballage. On oublie un peu vite que la fonction de l’empaquetage est de protéger un objet qu’on s’apprête à transporter. Ainsi sanglé de belles cordes rouges, l’Arc de Triomphe a tout l’air d’attendre la grue qui le déposera sur un camion susceptible de l’emporter loin de la place de l’Étoile.
Si empaqueter à cette fin un monument parisien, ou même européen, peut paraître incongru, l’époque n’est pas si lointaine où la France, l’Angleterre et l’Allemagne emballaient par centaines les biens des pays conquis pour les transporter sur leurs places et dans leurs musées. Emballer l’arc « romain » d’un pays qui a lui-même emballé un obélisque afin de le transporter de Louxor à Paris (l’année même où l’on inaugura le susdit Arc) semble un juste retour des choses. Le geste de Christo et Jeanne-Claude aurait-il un sens postcolonial que ses auteurs n’auraient pas décelé ? On peut en douter mais, après tout, le regard du promeneur demeure en dernière instance le seul maître du sens qu’il donne à ce qu’il voit. Dans ce cas cependant, il aurait sans doute été plus approprié d’emballer l’Obélisque de la place de la Concorde ou, mieux encore, le musée du Louvre (et le British Museum).
Il est cependant une autre manière de regarder l’emballage : 25.000 m2 de toile tissée de polypropylène bleu et recouverte d’une fine couche d’aluminium vaporisé, le tout soigneusement et diversement plissé. À observer les moirages de la lumière sur l’aluminium et le jeu du vent dans les plis du tissu, on doit bien admettre que la toile habille au moins autant qu’elle emballe. Le corps de l’Arc apparaît vêtu.
Des trois actions que le geste accomplit, celle-ci me semble la plus prodigue d’effets. Resignifier, distancier, alléger. Le vêtement allège. La première réaction de celles et ceux qui le voient emballé est de dire qu’il est « plus petit ». Je pense qu’ils veulent dire « plus léger ». Christo et Jeanne-Claude ne s’attaquent pas au symbole, mais à plusieurs modalités de son fonctionnement. Exemplification plutôt que représentation. Distanciation plutôt que désamorçage. Et surtout allègement des lourdeurs physique et symbolique (qui est dans le cas qui nous occupe lourdement allégorique), l’une n’allant pas sans l’autre. Le plissé contribue beaucoup à cet effet. Le vêtement évoque la jupe, dont l’Arc rappelle à ceux qui l’auraient oublié le caractère notoirement non genré. L’Arc porte des jupes mais, à la différence du Reichstag et du Pont-Neuf, il repose sur des jambes.
Emballé, l’Arc n’est plus un monument. Il est devenu un objet.
L’Arc de Triomphe n’en était toutefois pas à son premier déplacement symbolique. En 1994, à l’occasion du cinquantième anniversaire du débarquement allié, l’artiste sonore américain Bill Fontana projeta depuis sa façade des sons captés en direct sur les côtes normandes : sons de vagues, de vent, sons sous-marins (grâce à des hydrophones), que 48 haut-parleurs habilement dissimulés faisaient entendre aux visiteurs de la place de l’Étoile. Je disais tout à l’heure que Christo et Jeanne-Claude resymbolisait l’Arc sans le déplacer. Il me semble que Bill Fontana fait exactement l’inverse : il le déplace par le son (et ce faisant l’allège) mais il lui ajoute une guerre (et ce faisant l’alourdit).
Un des effets notables de l’installation – qui s’intitulait Sound Island – fut de substituer aux bruits de la circulation automobile le paysage sonore des rivages marins, ce qui donna aux personnes présentes l’impression que les voitures étaient soudain devenues silencieuses (le bruit de la mer a tendance à produire un effet de masque sur les sons auxquels il se superpose). Le silence était également un des effets, collatéraux celui-là, de l’emballage de Christo et Jeanne-Claude. Pendant deux week-ends, la place de l’Étoile fut rendue aux piétons. On pouvait s’y promener à loisir sans craindre d’être percuté par un véhicule pressé d’en faire le tour.
À vrai dire, nous n’avions pas l’impression d’être sur la même place. Et l’absence de voitures ne suffisait à l’expliquer. Emballé, l’Arc n’est plus un monument. Il est devenu un objet, une sculpture si l’on veut, mais alors une sculpture de peau. Un monument est quelque chose dont la connaissance précède la vision. On ne va le voir que pour l’avoir vu, reconnaître qu’il existe bel et bien et qu’il est aussi impressionnant qu’annoncé.
L’emballage rend ce rapport impossible. On s’approche, on palpe le tissu, on s’éloigne, on fait le tour, on interroge un médiateur, etc., quoi qu’on fasse l’objet ne se rend pas. Il demeure lointain, inaccessible. Et son étrangeté contamine les entours. L’atmosphère change. Quelque chose se glisse dans l’air ambiant. Le ciel lui-même est différent.
On se met à regarder la ville à travers ses yeux, comme s’il l’avait précédée et qu’elle s’était bâtie autour de lui. Je retrouvai là une impression que je n’avais éprouvé qu’une seule fois auparavant. C’était en découvrant l’Araignée de Louise Bourgeois exposée sur une place de Copenhague. Je regardais Maman, tel était son nom, et je savais d’un savoir obscur qu’elle avait dévoré la ville tout entière.
