Réapparitions et avatars de Zapping Zone, installation fantôme de Chris Marker
À l’automne 1990, le Centre Pompidou accueillait l’exposition « Passages de l’image » conçue par Raymond Bellour, Catherine David et Christine Van Assche, qui mettait en évidence de manière visionnaire les processus alors en train d’affecter la photo, le cinéma et la vidéo – et déjà un peu l’image numérique.
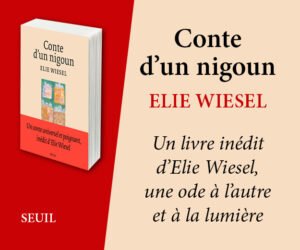
On y découvrait en particulier une installation qui, tout en synthétisant le propos de l’exposition dans son ensemble, marquait aussi une étape importante dans l’œuvre de son auteur, Chris Marker. Zapping Zone (Proposals for an Imaginary Television) – l’auteur tenait au titre complet – recomposait une grande partie de l’œuvre déjà réalisée par Marker depuis le début des années 1950, mettait en scène sa réflexion à ce moment sur l’état et les possibilités des images, et annonçait en même temps ses propres recherches à venir et les développements des usages des différents écrans tel que le passage vers le 21e siècle allait les activer. Pour Marker lui-même, cette réflexion créative, ou création réflexive, allait ensuite le mener du côté du CD-Rom Immemory, de l’espace sur Second Life L’Ouvroir ou du site Internet Gorgomancy, pour ne citer que les principaux exemples.
Zapping Zone est devenu un conservatoire d’un certain état des « nouvelles technologies », ensemble d’appareils et de dispositifs dont on sait la rapide obsolescence.
Concrètement, en 1990, on voyait ce qui était soigneusement organisé comme un capharnaüm d’écrans de télévisions et d’ordinateurs, sur lesquels apparaissaient des extraits de films déjà existants, des vidéos tournées tout exprès, des images générées par l’informatique, de manière contrôlée ou pas, des écrans interactifs et même la télévision en direct. Quelques photos et des séries de diapositives sur des caissons lumineux. Et, évidemment, un chat japonais qui dit bonjour de la patte – Maneki-neko pour les nipponisants. Installé dans une pénombre laissant deviner une structure en ferraille industrielle et un grand fouillis de
