Trouble dans les espèces – sur l’exposition « Science friction »
Un paradigme central s’est imposé ces dernières années dans le paysage tentaculaire de la pensée : l’abandon de l’anthropocentrisme au profit du biocentrisme. À une vision du monde centrée sur l’humain s’est substituée une vision où l’humain devient la simple partie d’un écosystème élargi.
Ce qui éclaire aujourd’hui nos consciences troublées, c’est ce modèle de l’enchevêtrement et de l’imbrication, de la « déhiérarchisation » des choses et des êtres, de la désagrégation des clôtures, en dépit de la résurgence de crispations identitaires.
La co-appartenance et l’interdépendance nous définissent désormais comme des êtres qui ne préexistent pas aux interrelations dans lesquelles ils émergent. Dans son dernier livre Le philosophe, la Terre et le virus[1], le philosophe Patrice Maniglier parle de « boucles de renforcement réciproques dans lesquelles les existants se constituent ».
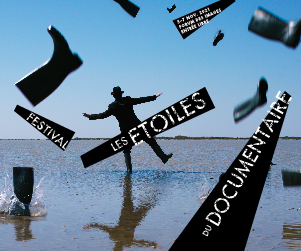
Les mondes ressemblent à des pelotes de relations embrouillées, elles-mêmes enchevêtrées les unes dans les autres. À la mesure de ce texte de Maniglier – né dans les colonnes d’AOC sous la forme de quatre articles consacrés à Bruno Latour –, aucune autre proposition théorique n’a généré depuis une vingtaine d’années un tel afflux de réflexions, qui traversent de nombreuses disciplines, de l’anthropologie à la métaphysique, de la philosophie à l’histoire environnementale, de la biologie au design…
Rien qu’en France, d’Isabelle Stengers à Bruno Latour, de Philippe Descola à Frédérique Aït-Touati, de Vinciane Despret à Emanuele Coccia, de Pierre Charbonnier à Baptiste Morizot, de Dominique Quessada à Camille de Toledo…, une pléthore de textes divers creusent les voies possibles de ce biocentrisme.
L’un des effets les plus visibles de ce tournant intellectuel autour de la fin du grand partage (entre nature et culture, dedans et dehors, soi et l’autre, humain et animal….) se manifeste dans la profusion de formes esthétiques qui procèdent de cette prise de conscience autant qu’elles en préfigurent le devenir.
Depuis des années, les artistes s’attachent aux liens entre humains et non-humains, nourris par ces théories de l’interdépendance. Dans son dernier livre, Inclusions. Esthétique du capitalocène (PUF), Nicolas Bourriaud défend ainsi une théorie de l’art prenant acte du dépassement de la division nature-culture : une « esthétique inclusive » appelant à un apprentissage du regard, replacé dans un univers plurivoque incluant les non-humains.
Prenant acte de la fin de la grande séparation entre des sphères longtemps opposées – le végétal, l’animal, le minéral, le moléculaire, le robotique et le social – , Nicolas Bourriaud vise à « réconcilier l’objet et le phénomène, le peintre et l’apiculteur ».
Une magistrale illustration de ce que cette pensée de la symbiose fait à l’art.
Symptomatique de ce nouveau moment intellectuel et artistique, l’exposition proposée par le CCCB (Centre de culture contemporaine de Barcelone, dirigé par Judit Carrera), « Science friction. Vivre parmi les espèces compagnes », fournit une magistrale illustration de ce que cette pensée de la symbiose fait à l’art.
Conçue par Maria Ptqk, l’exposition s’inscrit au cœur de ce mouvement de pensée, en s’appuyant sur le travail séminal de deux figures clés de la culture scientifique contemporaine : Donna Haraway et Lynn Margulis, qui l’une et l’autre n’ont cessé d’insister, dans leurs travaux respectifs (la philo pour l’une, la biologie pour l’autre), sur la symbiose et la collaboration entre les espèces. Leurs écrits ont nourri les œuvres des artistes ici exposés – Louis Bec, Paula Bruna, Ernesto Casero, John Feldman, Dominique Koch, Christie Lyons, Terence McKenna, Max Reichmann, Jaime Serra Palou, Diana Toucedo, Pinar Yoldas…
Le parcours de l’exposition et le récit qui l’accompagne se fonde sur cette croyance généralisée dans l’évidence des relations symbiotiques entre les espèces terrestres. D’un microbe à un grain de sable, d’une orchidée à une danseuse, d’une bactérie à un récif de corail, d’un virus à un papillon, d’un chêne à un cyborg…, la métaphysique de notre temps a remis l’humain à sa place, dans une sorte d’anarchisme ontologique, d’anti-humanisme assumé.
Dans leur diversité même (vidéos, sculptures, dessins, photos, installations, œuvres immersives…), les œuvres explorent toutes ces relations décloisonnées, au-delà de tout principe hiérarchique. Pour la curatrice Marie Ptqk, seules des histoires spéculatives, élargissant nos perceptions habituelles, peuvent nous aider – nous outiller – à nous situer dans le paradigme interspécifique. De ce point de vue, la promesse de Science friction.Vivre parmi les espèces compagnes est tenue : le visiteur élargit bien ici ses perceptions habituelles.
« Dans la nature, il n’y a pas d’organismes autonomes ou indépendants », explique Maria Ptqk qui s’intéresse depuis des années au biocentrisme ; « nous faisons tous partie d’écosystèmes mutuellement intégrés. Les espèces constituent un réseau de collaborations, de mutations et d’échanges dans lequel nous cohabitons en compagnons ».
Amorcée dans un projet virtuel exposé au Jeu de Paume à Paris en 2017, son exploration des formes artistiques indexées à ce biocentrisme fécond se déploie à Barcelone sous des formes éclatées, parfois opaques, mais toujours édifiantes dans cette affirmation d’un nouveau paradigme existentiel. Un paradigme selon lequel l’espèce humaine n’est pas exceptionnelle ou supérieure.
Dès l’ouverture de l’exposition, une salle consacrée au travail pionnier de la microbiologiste américaine Lynn Margulis donne le ton général du parcours qui, à la mesure de son programme d’enchevêtrement, mélange les supports et les matériaux, les idées et les affects, les images et les textes, le chaud et le froid, l’organique et le minéral.
Filmée à la fin des années 1960, la microbiologiste, coauteure avec James Lovelock de « l’hypothèse Gaïa », propose sa théorie des interactions symbiotiques entre organismes.
Une vidéo magnétique (« Holobiont society ») de l’artiste suisse Dominique Koch suggère, par le biais d’un montage tendu entre images d’océans et de matières organiques, plans d’un monde en décomposition et extraits d’entretiens avec Donna Haraway et le philosophe Maurizio Lazzarato, que nous vivons à l’ère des hybrides et des inter-espèces. Rien ne se passe tout seul, tout fait toujours partie d’autre chose.
L’idée d’une « planète d’holobionts » (terme inventé par Lynn Margulis en 1991, qui décrit l’approche fondée sur la symbiose, et considère l’hôte et la totalité des microbes, bactéries et virus qui le colonisent comme une seule entité) se percute dans l’image d’un état de guerre activé par le néo-libéralisme (la logique du profit, la croissance économique soutenue par la guerre, le chaos climatique et l’extinction culturelle et biologique).
Dans ce balancement entre des registres de discours distincts, où l’économie et la biologie se superposent, entre des formes visuelles et sonores contrastées, Dominique Koch plonge le spectateur dans une abysse de questions, dont la résolution se trouve autant dans un registre politique (sortir du capitalisme débridé) que dans une conviction philosophique (refuser toute forme de dualisme).
Une autre vidéo, « Camille & Ulysse » de Diana Toucedo, d’une durée de 46 minutes, coproduite par le CCCB (Research Centre of Communication and Culture) et le Centre Pompidou, remet Donna Haraway au cœur d’un récit fantastique aux côtés d’une autre philosophe inspirée : Vinciane Despret. Filmées en pleine lecture de leurs textes récents – « The Camille Stories », chapitre de son livre Vivre avec le trouble[2], et Autobiographie d’un poulpe[3] –, les deux philosophes imaginent l’avènement, dans un futur proche, des premières générations de communautés symbiogénétiques d’humains et de non-humains : la Camille d’Haraway devient le symbiote de papillons migrateurs ; l’Ulysse de Despret fait l’expérience de vivre en présence de poulpes désormais disparus, par l’apprentissage de leurs langues et gestes.
Vivre avec le trouble, c’est entrer dans un monde étrange – le nôtre –, où les pensées émanent de symbiotes à corps multiples, visqueux et tentaculaires.
Sous forme de fable et de correspondance entre ces deux voix, qui se jouent elles-mêmes des frontières entre théorie et fiction, Diana Toucedo filme les philosophes concentrées sur leurs lectures, errant dans la nature, suivies, comme leur ombre portée, par des êtres tentaculaires et métamorphiques. « Je pense que la théorie et la fiction sont deux éléments très forts, ce sont deux faces de la même pièce. (…) Toute théorie n’est pas narration et toute narration n’est pas théorie, mais leur surface de contact est très vaste », confie Donna Haraway dans le film de Dominique Koch.
Celui de Diana Toucedo est tout aussi fascinant, en mettant admirablement en forme l’idée forte les deux auteurs : l’idée d’un trouble, d’une confusion, d’une « symbiogénèse », d’entrecroisements fortuits. Vivre avec le trouble, c’est entrer dans un monde étrange – le nôtre –, où les pensées émanent de symbiotes à corps multiples, visqueux et tentaculaires. Où l’Humain, décomposé en humus, composte avec les autres espèces.
Le texte d’Haraway dialogue « naturellement » avec celui de Despret, qui défend une « thérolinguistique » (discipline scientifique du futur qui étudie les histoires que les animaux écrivent et racontent). En brouillant les pistes entre science et fiction, elle crée à sa manière ce trouble « harawayien » : et si les poulpes, adeptes de la métempsychose, se désespéraient de ne plus pouvoir se réincarner du fait de la pollution des océans ?
De salles en salles, thématisées comme autant de chapitre d’un grand récit continu – « symbiose, espèces de compagnie, biochimie, histoires d’origine, contrat naturel » –, ce sont de multiples zones de contact qui troublent le spectateur, invité à faire des confusions et des hybridations qui s’offrent à lui la condition même de son existence.
La conscience de soi se fond dans la conscience de vivre parmi d’autres espèce, à travers ces « frottements » et « frictions ». Des frictions dont la « fiction » permet souvent de prendre la mesure, jusqu’à la nécessité d’un éveil politique. Un éveil politique appuyé par l’installation de Jaime Serra Palou, « Time-Life-Time », dédiée au mouvement Rights of Nature, épilogue du parcours, qui sous forme d’un grand collage d’images et de textes, appelle à protéger toutes les espèces animales, végétales, ainsi que tous les écosystèmes, rivières ou montagnes.
Dominantes dans le champ intellectuel, ces relations de dépendance circulaire et d’imbrication mutuelle ne font pas pour autant l’unanimité. Des lignes de fracture persistent autour de la place accordée à l’interdépendance, dont certains théoriciens estiment qu’elle a le défaut d’occulter un peu trop rapidement les questions de rapports de force politiques et économiques en cours.
Un texte récent de Frédéric Lordon paru dans Le Monde Diplomatique, « Pleurnicher le vivant », traduisait la méfiance que suscitent encore les réflexions sur le vivant, inspirées de Latour et Haraway. « Nous sommes aux mains de fous dangereux. Alors de deux choses l’une : le latourisme peut continuer de ratifier ce délire, ne serait-ce que par l’implicite du mutisme, ou bien il peut envisager de proférer une réponse enfin sérieuse à la question de savoir, non pas « où », mais sur quoi atterrir – et pour bien l’écraser : sur le capitalisme », concluait Lordon.
N’excluant en rien la question du capitalisme, la reliant à la fin des dualismes et à la préservation des écosystèmes et de la biodiversité, l’exposition du CCCB réussit ce miracle de faire de son programme symbiotique l’horizon de nos gestes et pensées à venir : relier l’art et la pensée, le biologique et le politique. Nous relier à tout, y compris à la nécessité de transformer nos manières de vivre.
« Ciencia fricción. Vida entre especies compañeras » / « Science friction, vivre parmi les espèces compagnes », CCCB de Barcelone (Centre de culture contemporaine de Barcelone), jusqu’au 28 novembre 2021.
