L’âge des possibles – sur Qui à part nous de Jonás Trueba
Sur les écrans tout récemment déconfinés de l’été 2020, Eva en août nous a fait découvrir, le cinéma délicat de l’espagnol Jonás Trueba. Dans son cinquième long métrage, une trentenaire en vacance dans tous les sens du terme empruntait un appartement pour se couper de son passé et redécouvrait les sensations d’une Madrid estivale et festive en essayant de se réinventer. Écrit et improvisé avec son interprète principale Itsaso Arana, La Virgen de agosto, pour reprendre le titre original empreint de mysticisme, rejouait la partition rohmérienne de l’héroïne irrésolue qui cherche des réponses sur elle-même en allant à la rencontre du monde.
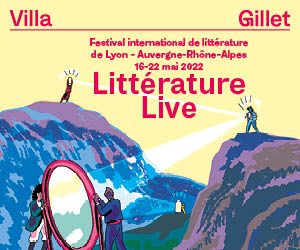
On pourra revoir ce film à l’occasion du Festival La Rochelle Cinéma (Fema) qui consacre lors de sa prochaine édition, du 1er au 10 juillet 2022, une rétrospective des longs métrages du cinéaste espagnol, dont 4 inédits en salle en France avec Todas las canciones hablan de mí (2010), Los Ilusos (2013) Los exiliados romanticos (2015) et La Reconquista (2016). Avec son mode de fabrication artisanal et spontané, la filmographie de Jonás Trueba s’appuie sur la personnalité des acteurs, leur alchimie et sur la réalité du tournage pour produire de la fiction.
D’ici juillet et La Rochelle sort un nouveau long-métrage, Qui à part nous (Quien lo impide), qui se place en héritier de La Pyramide humaine (1959) écrit par Jean Rouch au fil du tournage avec des lycéens d’Abidjan comme une fiction proche de leur quotidien et des questions ethniques qui s’interfèrent entre eux. La méthode intuitive de Trueba reprend le principe d’anthropologie partagée de l’ethnologue français face au même sujet (un groupe de jeunes gens qui mettent en scène leur réalité et leur pensée sur le monde) pour le tirer davantage vers un versant contemplatif et poétique dont il revendique jusqu’à la maladresse et qui s’exprime dans sa durée hors norme : celle du tournage (près de cinq ans) et celle du long métrage (3h40).
Tendresse du teen movie
Grand cinéaste de la violence, Nicholas Ray a cherché en James Dean, dans La Fureur de Vivre (1955), un héros romantique de son temps, au corps élastique, au tempérament ombrageux, à la sensibilité exacerbée qui s’oppose rageusement à ses parents, à la virilité dominante de la bande qui règne sur le lycée. Près de 70 ans après cet acte de naissance du teen movie comme quintessence de l’intensité exacerbée des émotions, alors que le coming of age movie est devenu un genre cinématographique à part entière, Jonás Trueba, réalisateur de la douceur, prend l’exact contrepied de son aîné hollywoodien.
Dans son portrait de groupe d’une jeunesse espagnole du tournant des années 2020, le conflit et la révolte cèdent la place au désir opiniâtre de se lover le plus confortablement possible dans le monde et dans les groupes humains. La génération de Qui à part nous n’est plus celle de la rébellion sans cause mais de l’apprentissage, des choix, des erreurs et des repentirs. Qui à part nous n’est pas une œuvre-cathédrale, mais un grand film discret, qui crée discrètement, sur la pointe des pieds une chose rare et immense : donner à voir l’éveil d’une conscience, en faisant chaque année avec tendresse la photo de classe d’un collectif changeant.
Retourner le regard
Quien lo impide (qui l’empêche ?), le titre original provient de la chanson de Rafael Berrio qui clôturait La Reconquista, fiction dans laquelle Trueba convoque les retrouvailles de trentenaires qui se souviennent le temps d’une nuit à Madrid de leur idylle adolescente. Le projet de Qui à part nous est né de la volonté du cinéaste de continuer le travail avec ceux qu’ils avaient rencontrés à la toute fin de l’enfance, de les regarder grandir. Après avoir fait rejouer ses propres souvenirs d’adolescence à Pablo Hoyos et Candela Recio qui interprétaient les protagonistes jeunes, il leur donne l’opportunité de retourner le point de vue sur eux, et de donner voix à leur regard sur leur jeunesse.
De cet indécidable nœud entre réel et fiction est né l’idée d’une collaboration à mi chemin entre les deux registres. « J’ai imposé des gestes et des manières à Candela et Pablo qui venaient de mon adolescence dans La Reconquista et j’ai voulu avec Qui à part nous leur rendre leurs gestes », explique le réalisateur à Alex Vicente dans le dossier de presse. L’histoire de la fabrication du film s’intègre dans l’œuvre elle-même : Trueba qui a l’habitude de mener des ateliers en lycée va organiser un vaste casting où il rencontre des dizaines de jeunes qu’il choisit par les affinités qu’ils créent avec Candela et Pablo. La structure du film s’appuie sur cette genèse improbable et la fabrication se fait au jour le jour, sans équipe, sans scénario, au gré des rencontres et des envies, comme si la patience documentaire du High School de Frederick Wiseman éclatait les bords du réel pour s’ouvrir à d’autres formes.
On pourrait changer son nom
Dans les discussions menées à plusieurs face à la caméra, les adolescents parlent librement des sujets qui leur tiennent à cœur (la politique, la religion, l’enseignement, le harcèlement…). Sancho Javierez y apparaît, le côté gauche de la chevelure peroxydé aux pointes bleues, la face droite brune et bien taillée. Une partie de son menton est barbue, l’autre glabre. Même sa chemise est pour moitié à carreaux, mais unie de l’autre côté. Il explique que ce look est venu d’un souhait de ne pas contrarier sa mère, qui aimait sa coupe classique mais de pourtant se teindre comme il en avait le désir.
Dans Breakfast Club (1985), John Hugues attribuait à chacun de ses lycéens collés pour une journée un emploi bien défini qui le caractérisait dans le groupe, qui faisait sa singularité : l’intello, le rebelle, la bourgeoise, l’asociale … Jonás Trueba attrape ce code pour lui tordre le cou : qui empêche ses huit adolescents d’être tout et son contraire, de préférer être éternellement indéfinis ? D’être timide dans un groupe d’amis, mais extraverti dans un autre, de passer par des phases capillaires diverses et audacieuses, d’être bon élève et de désobéir. Le changement, la contradiction font partie du changement à vue qu’observe le film.
« On pourrait changer son nom / pour un nom qui sonne mieux », dit la chanson de Rafael Berrio. Dans cette jeunesse vue comme un grand réinventement permanent, Jonás Trueba confesse qu’il se sent lui même comme un adolescent depuis vingt ans, un adolescent qui prendrait de l’âge, de l’expérience, mais continuerait d’éprouver le monde de la même façon. Cette empathie du cinéaste envers son sujet l’amène à chercher au film une forme qui serait elle-même adolescente en tournant sans moyens, quand les circonstances le permettent, il a la vivacité d’un premier geste de cinéma. Mais aussi en laissant l’œuvre se reconfigurer à chaque scène, tout comme ses personnages nous envoient, à chaque changement d’époque des mises à jour de leurs idées, de leur apparence, de leurs affinités, de leurs centres d’intérêts.
Quand Candela rencontre Silvio, la romance entre eux fait basculer le documentaire urbain de groupe dans une escapade bucolique qui abolit le temps et le reste du monde. Devant l’église du village d’Estrémadure où elle passe quelques jours de vacances, Candela aperçoit son nouvel amoureux qui a fait des heures de voyage pour la rejoindre le temps d’une après midi. Leur fugue entre les herbes hautes et naviguent sur la rivière jusqu’à la rive du Portugal se propage au film qui se permet cette escapade hors de son centre de gravité, comme si le sentiment amoureux avait le don de tout transformer en conte merveilleux et d’abolir le temps et l’espace.
Ce « caprice » n’est que l’une des multiples formes qu’adopte Qui à part nous, dont l’un des avatars est une performance où les personnages ne se contentent pas de jouer leur rôle, mais viennent produire sur scène des chansons qu’ils ont composées en lien avec les sujets abordés pour le film et donne du rythme, du son qui contrebalance la grande présence de la parole. Ainsi, la complicité entre les deux amoureux se raconte au travers des paroles de chanson qu’ils composent à distance, au téléphone : une situation créée spécialement pour le film vient dire leur sentiment autrement qu’ils n’auraient pu l’exprimer en interview face à la caméra. Les moments de castings deviennent des blocs de parole qui nourrissent la part théorique du film, les personnages participent à l’écriture du film, à la réflexion sur sa forme. De ces discussion surgit l’aporie de la parole qu’est la solitude : un garçon parle d’un sentiment profond de retrait du monde qui, si on se contentait de le dire avec des mots, ne pourrait s’éprouver réellement. Il invente alors les images qui donnent corps à son émotion.
Flash back sur le présent
L’un des enjeux est évidemment la façon dont l’identité se construit juste avant l’âge adulte, et comment elle se dilue ou se renforce au contact de l’amitié, du couple, des affinités électives ou de la classe non choisie. Être seul ou être en groupe sont des modalités sans cesse retravaillées du film, qui se peuple ou se vide au gré des séquences. Mais l’une des obsessions est aussi de savoir comment l’on est perçu, quelle image on renvoie de soi, comme dans cette séquence où le mutisme de Pablo est commenté par les voix de ceux qui l’entourent. Les questions qui animent ceux qu’ils filment sont sans cesse traduites en termes cinématographiques. Ainsi, la question de la représentation de l’adolescence à l’écran est évoquée dans une scène où l’on déplore que la jeunesse soit souvent montrée dans ses problèmes, dans un aspect précis. Personnages et films suivent des chemins voisins qui se croisent à intervalles réguliers.
Le premier vote de la petite bande consacre le rapport au groupe, à la société évoquée en filigrane dans ce monde presque sans adultes (les quelques silhouettes de parents ou de profs restent très en retrait). L’élection est suivie de très près par le premier confinement, au printemps 2020, qui renvoie tout le monde chez soi, met fin à l’expérience collective (celle du film comme celle du vraie monde) ou du moins la reconfigure dans un mode de parole différent. « Avant, quand on ne savait pas quoi se dire, on se touchait, s’amuse Marta, l’une des jeunes filles. Maintenant, au téléphone ou sur zoom, on se parle différemment, plus qu’avant ». Ces élections constituent un flash back par rapport au confinement, sur lequel le cinéaste revient, lors d’une discussion sur Zoom, avec d’une part Candela, de l’autre Pablo. L’un après l’autre, ils commentent ce qui a changé d’imperceptible entre le moment où le film a commencé, lorsqu’ils avaient 15 ans, leur premier bulletin dans l’urne, puis la pandémie mondiale.
Dans Gimme Shelter (1970) de Charlotte Zwerin et David et Albert Maysles, les trois cinéastes s’asseyaient à la table de montage avec les Rolling Stones pour revenir sur les images de leur concert d’Altamont lors duquel un jeune homme noir mourut sous les coups du service d’ordre. En scrutant dans l’image le fantôme du spectateur assassiné, ils questionnent aussi le basculement imperceptible des mouvements de libération vers une violence incontrôlée. Jonás Trueba rembobine avec ses protagonistes ce qu’il y a d’invisible dans les images tournées ensemble. Le mouvement perpétuel du film, du groupe à l’individu ou inversement se concentre dans la réunion zoom qui commence avec un invité, puis dont l’écran se remplit, pour revenir à une seule image. Celle filmée par le cinéaste, qui au bout du compte est seul à monter ces images créées collectivement et à en chercher le sens et qui, à l’approche de la quarantaine, interroge lui aussi la fin de sa jeunesse en observant obstinément le présent.
Qui à part nous (Quien lo impide) de Jonás Trueba est sorti en salles ce mercredi 20 avril
